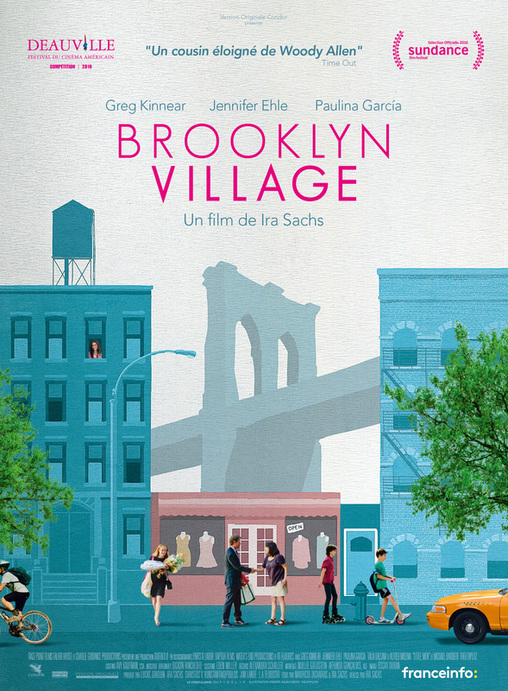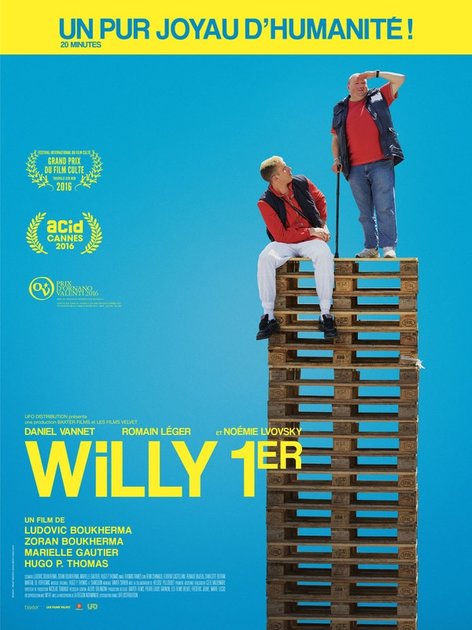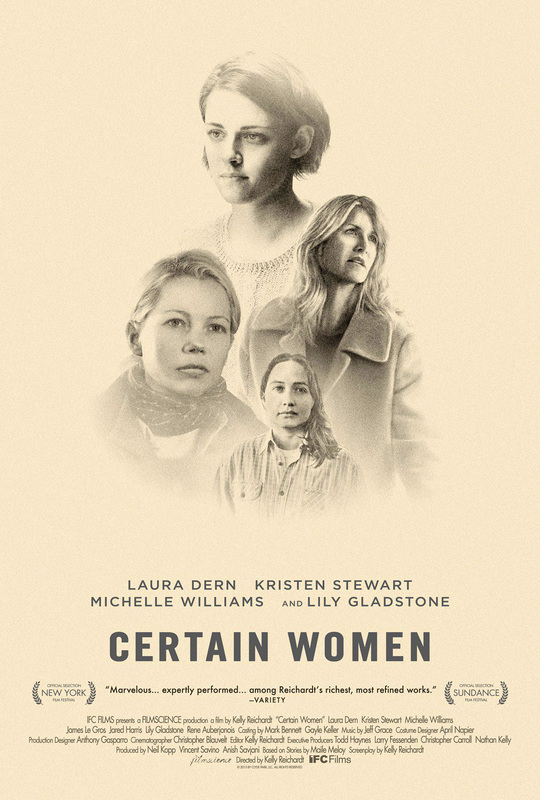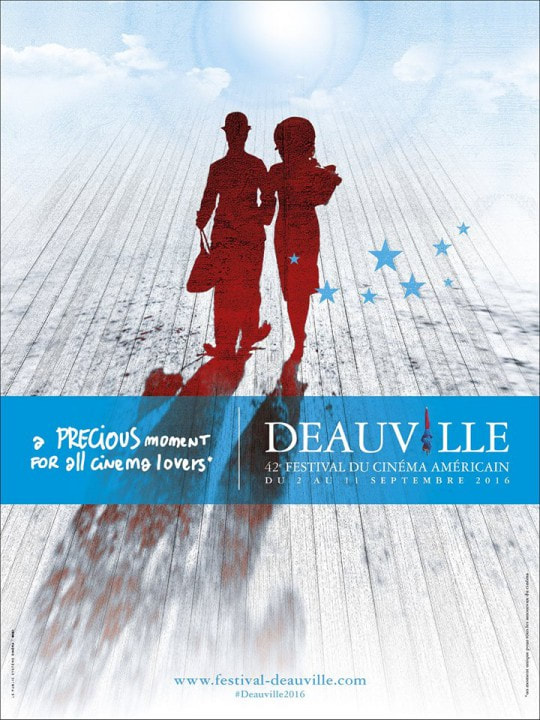|
Note du film : 10/10 (par François) En compétition – 6 septembre 2016 Résumé du film : The Cure, Duran Duran, The Smith, A AH font danser des millions d’adolescents dans le monde, et parmi eux, Conor. Lycéen dans le Dublin des années 80’, son univers est en proie à un bouleversement de taille. En effet, non seulement ses parents sont sur le point de vivre chacun de leur coté, mais en plus il se voit contraint de quitter le calme de l’enseignement privé pour la turbulence de l’école publique dirigée par des religieux. Et dans ce mouvement incontrôlé, il faudra composer avec l’autorité des « pères enseignants », les brutes des couloirs et la violence affichée par certains camarades. Heureusement, dans ce tourbillon plutôt gris, l’existence de Conor se colore grâce à sa rencontre avec Raphina. Pour impressionner cette adolescence, femme en devenir, il envisage de monter un groupe de « pop/rock/new wave » à tendance « futuriste » et de tourner un clip dans lequel Raphina apparaîtra. Pour ce faire, il pourra compter sur l’aide de ses amis (et membres du groupe nouvellement formé) et de son frère, véritable connaisseur de ces tubes dont les clips enflamment continuellement « Top of the Pop ». Let’s Rock baby ! Avis : Véritable coup de cœur personnel au dernier Festival du cinéma américain de Deauville, « Sing street » est ce qu’on peut appeler un film réussi ! Véritable feel good movie à tendance musicale, ce film insuffle un vent de légèreté, d’audace et de valeurs qui nous font du bien ! Mélange improbable de films d’adolescents qui sent bon « Breakfast Club » et porté par une bande originale des plus réjouissante, ce film place la ville de Dublin au centre de notre attention. D’ailleurs, les années 80’ riment avec récession économique et nombreux sont les Dublinois qui partent par bateau pour tenter de trouver du travail en Angleterre. C’est dans ce contexte difficile que nous retrouvons Conor, interprété par le jeune irlandais Ferdia Walsh-Peelo. Eblouissant dans son rôle, ce jeune musicien et chanteur de 16 ans nous livre ici sa première performance cinématographique. Quel naturel ! Gageons que nous entendrons encore parler de lui ! Accompagné à l’écran d’une bien belle façon, Lucy Diana Boynton (Raphina à l’écran), jeune britannique de 22 ans, ne laissera pas Conor indifférent. D’ailleurs ce dernier s’est lancé comme défi de constituer un groupe de musique afin de se rapprocher de la belle, de lui dédier ses chansons et de la faire apparaître dans ses clips ! Vous l’aurez compris, le véritable challenge ne sera pas tant de savoir si elle sera conquise… Nous par contre, nous le sommes ! Forcément, pour monter un groupe, il faut des musiciens ! Et c’est avec beaucoup d’optimisme que Conor caste ses acolytes dont la plupart sont à son bahut. Chacun apporte son expertise, sa vision du rock : d’ailleurs ils se chercheront beaucoup pour évoluer et trouver peu à peu « leur son » que Conor appellera « futuriste ». Ces scènes sont l’occasion pour le spectateur de se régaler tant l’humour est omniprésent ! Nombreux sont les acteurs « locaux » (entendez par là Irlandais) qui composent le casting. Nous ne pouvons taire leurs noms tellement leur performance est remarquable. Mark McKenna incarne l’ami de Conor, ainsi que les autres « musiciens » et proches apparaissant dans le film : Conor Hamilton, Karl Rice, Ian Kenny, Percy Chamburuka pour n’en citer que quelques uns. Pourtant, tous concourent à faire de ce film une petite pépite d’humour et de bonne humeur très contagieuse. Ce long-métrage nous rappelle nos films d’enfance qui sentent bon l’amitié vraie, les premières amours, l’insouciance des débuts et une musique au service de l’ensemble. Néanmoins ce serait réducteur que de ne parler que de ces éléments, certes très agréables, sans évoquer d’autres, plus sombres, qui apportent une belle densité à l’ensemble. L’œuvre proposée est l’occasion pour le réalisateur de régler ses comptes avec ce qu’il a connu : une éducation catholique psycho rigide et dépassée, en décalage total avec la jeunesse. Aussi, l’éclatement familial est traité avec beaucoup de finesse : Comment continuer à vivre ensemble lorsque l’on ne s’aime plus ? Rappelons qu’à cette époque, le divorce était tout bonnement interdit (il sera autorisé en 1996 !). Les enfants sont souvent livrés à eux-mêmes et ne se retrouvent véritablement que devant la tv et l’émission « Top of the Pop » dont est fan le grand frère. Parlons-en justement ; celui-ci est interprété par le très touchant Jack Reynor (à l’affiche de « Transformers 4 », « Macbeth », et « Glassland ») et sera là pour soutenir la famille. Plus qu’un second rôle, il sera véritablement le mentor du héros. Sa performance est éclatante, émouvante et très sincère. Il sera celui qui a arrêté de se battre pour sa liberté, qui n’a pu trouver la force de fuir ce quotidien pour embrasser ses rêves. Désormais son but est de les vivre par l’intermédiaire de son jeune frère, Conor. Il l’initiera au Rock, partagera ses opinions et plus important que tout…sera toujours là pour son petit frère. Vous l’aurez compris, plus encore qu’un film d’adolescent, il s’agit aussi d’un film sur la famille. Saluons d’ailleurs les performances très crédibles des parents du héros joués par Maria Doyle Kennedy et Aidan Gillen (qui interprétait l’excellent Maire de Baltimore Thomas Carcetti dans la série culte « The Wire », mais aussi Lord Petyr "Littlefinger" Baelish dans « Game of Thrones »). Le réalisateur irlandais John Carney n’en est pas à son premier coup d’essai puisqu’il nous a déjà livré le très pétillant « New-York Melody » avec Keira Knightley et Mark Ruffalo. Pour autant, c’est la première fois qu’il tourne avec des acteurs aussi jeunes. Il leur laissera d’ailleurs tout le champ de jeu possible en favorisant l’improvisation de ces jeunes talents. Puisque les lieux de tournage ont très peu évolué depuis les années 80, il était facile de reconstituer cette temporalité. John Carney a eu cependant l’intelligence de proposer une patte moderne à sa réalisation afin de ne pas perdre le spectateur dans un décalage trop important et ainsi le laisser sur le bord de la route. Pour l’heure, avec son nouveau film, le metteur en scène dépasse le film musical et même le stade du microcosme d’un teenager chantant l’amour. Il nous livre ici une ode à l’enfance qui s’en va, aux liens du sang, à l’amitié et à l’amour qui naît. Et plus important que tout… un film centré sur la poursuite de nos rêves. Date de sortie en France : 26 octobre 2016 Durée du film : 1h46
1 Commentaire
En compétition – 8 septembre 2016 Note du film : 6/10 (par Sally) Résumé du film : Annie vient de changer de lycée quand elle rencontre Jules. Très vite, les deux jeunes filles se lient d'une profonde amitié. Complices, elles entretiennent le rêve de rejoindre New York et y faire leur vie. Pour le mener à bien, les deux lycéennes ont trouvé une manière rapide de se faire de l'argent… Une fausse bonne idée qui leur apportera bien des ennuis. Avis : « Teenage cocktail » n'est a priori pas un immanquable de « Festival du cinéma Américain de Deauville ». Néanmoins, en compétition pour l'édition 2016, il est bon de se pencher sur le travail de John Carchietta et se faire sa propre idée. Avec son « Teenage Cocktail », le jeune réalisateur de « Late Fee » se lance seul derrière là caméra. Habitué à co-réaliser des courts-métrages, parvient-il à imposer sa patte et faire de son dernier long-métrage une réussite ? Pas totalement. Loin d'être un bide, son film ne marque cependant pas les esprits. Bien interprété, bien scénarisé, bien filmé, on a peu de choses à lui reprocher mais le constat est sans appel, une semaine après sa vision, nous n'en gardons pas de souvenirs mémorables. Pourtant, le sujet central de l'intrigue interpelle. Annie vient de changer de lycée. Ses nouveaux camarades de classe ne sont pas très accueillants et les ennuis déjà présents. Aussi, lorsqu'elle croise la route de Jules, Annie revit. Impressionnée par sa nouvelle copine, elle la suit dans ses péripéties et découvre les joies de l'adulescence. Oui mais.,. Jules, dont le père est absent, a une influence grandissante sur la vie de la jeune fille qui en tombe très vite amoureuse. Plus qu'une histoire d'amour homosexuelle, « Teenage cocktail » montre combien les rencontres que l'on fait peut profondément nous changer. Jules rêve de gagner New York et y démarrer une nouvelle vie. Enmourachée, Annie est prête à la suivre mais pour cela, il leur faut beaucoup d'argent. Jules a un plan : s'inscrire sur un site de webcam en ligne où les hommes paient pour les voir quelques instants. La situation peut paraître contrôlable mais l'appât du gain va forcément donner une toute autre suite à l'idée de base… Sorte de « Puppy Love » à l'américaine, (auquel on ajoute une touche de « Knock Knock ») « Teenage Cocktail » traite de l'influence, l'adulescence, l'expérience homosexuelle, le sexe virtuel, la déviance des réseaux sociaux… Très actuel, le scénario interpelle et « choque ». Pas les âmes puritaines non, loin de là. Il choque car il montre combien la démission des parents, la facilité de se vendre sur le net peuvent causer des dommages irréparables. Ici, les héroïnes ont une force de caractère impressionnante et rien ne semble pouvoir affecter le couple récemment formé mais les conséquences n'en resteront pas moins surprenantes. Ce qui est étonnant aussi, c'est le switch apporté par John Carchietta : on perd un peu les pédales et on ne comprend totalement le choix opéré dans le dernier quart du film… L'histoire, Nichole Bloom et Fabianne Therese se l'ont véritablement appropriée. Loin d'être des débutantes, les deux jeunes femmes revêtent ici deux rôles difficiles et parfaitement maîtrisés. L'amour entre elles naît dans les regards, la complicité est réelle… les attitudes et les mots s'allient pour révéler des prestations assumées. Elles ne semblent pas déstabilisées par les scènes d'amour lesbiennes et s'investissent totalement sans retenue palpable. Le sujet, déjà très exploité dans le cinéma contemporain, n'a pas fini de nous livrer des histoires engagées et ce film en est la preuve. Néanmoins, « Teenage Cocktail » est un peu comme un roman de plage. A peine l'a-t-on fini qu'on le range dans un coin sans pour autant se le remémorer. Noyé dans les flots de ce festival aux films de genres très diversifiés, il ne gagne pas sa place parmi ceux qu'on aura le plus apprécié. Durée du film : 1h28 Genre : Drame Note du film : 6,5/10 (par Véronique) En compétition - 3 septembre 2016 Résumé du film : Christine, journaliste pour la chaîne WRZB doit faire face à de nombreux changements dans sa vie personnelle et professionnelle. Aura-t-elle la force de les affronter ou se laissera-t-elle complètement dépasser ? Le dernier film d’Antonio Campos nous raconte l’histoire vraie d’une chroniqueuse tourmentée. Avis : Le film d’Antonio Campos a attiré notre attention lors de cette compétition car il présente l’histoire vraie de Christine Chubbuck, journaliste pour une petite chaîne télé américaine des années 70. Si le sujet est intéressant sur bien des points, le rythme choisi pour nous le conter est par contre bien moins efficace. Rempli de longueurs et de sensations de lenteur, le long métrage (qui dure presque 2h), peut par moment sembler soporifique. Dommage car hormis ce souci de dynamique, le dernier film du jeune réalisateur a vraiment de quoi satisfaire les cinéphiles. Adepte des sujets dramatiques, le metteur en scène de 33 ans, nous offre, après « Afterschool » et « Simon Killer » une nouvelle dénonciation des travers de notre société et les conséquences que cela peut entraîner. Avec « Christine », nous entrons de plein pied dans l’univers de la télévision des années 1970. WRZB est une petite chaîne locale où chaque journaliste est libre d’amener ses sujets, son traitement, sans censure. Christine Chubbuck fait partie de cette équipe depuis quelques années et part régulièrement à la rencontre des populations régionales pour présenter leurs savoir-faire et leurs histoires. Mais lorsque les audiences ne suivent plus et que le grand patron débarque dans les studios, c’est toute la philosophie de la chaîne qui est remise en cause : pour faire de l’audience, il faut du trash ! Réticente à changer sa façon de faire, Christine n’a pas d’autres choix que de se plier à cette nouvelle ligne de conduite si elle veut gravir les échelons. Christine, c’est l’excellente Rebecca Hall ! Vue tout récemment dans « Le bon gros géant », l’actrice jongle avec les genres cinématographiques, passant ainsi de « Vicky, Christina, Barcelona » à « The gift» avec un talent constant. Ici, elle a la lourde tâche d’interpréter une journaliste à fleur de peau qui voit sa vie basculer d’un jour à l’autre : la relation qu’elle entretient avec sa mère (J. Smith-Cameron), récemment casée, n’est plus au beau fixe ; son boulot ne correspond plus aux valeurs qui lui sont propres ; sa vie amoureuse est d’un vide ennuyeux et sa santé lui fait défaut puisqu’on lui diagnostique un kyste à l’ovaire (qui risque de ne pas lui permettre de grossesse). Christine a trente ans et tout semble lui filer entre les doigts. Esseulée, elle n’a finalement que peu de personnes à qui parler et cette succession de mauvaises nouvelles tendent à la pousser vers un drame inévitable… Le monde de la télévision est particulièrement bien représenté : ses exigences, le jeu des audiences, la cruauté de la temporalité, la course à la notoriété, l’individualité… permettent de nous rendre compte combien travailler dans les médias (à cette époque) n’a rien d’enviable. On entre de manière privilégiée dans les coulisses d’un univers où il n’est pas bon être fragile. Dans cette équipe médiatique, on retrouve tous les clichés auxquels on ne peut que penser et qui font pourtant partie de la réalité. Le journaliste vedette de la chaîne (interprété ici par Michael « Dexter » C Hall), un rédacteur en chef peu conciliant (Tracy Letts), un producteur financier qui n’y connaît rien au monde de la télé (John Cullum), une bienveillante assistante de plateau (Maria Dizzia), une belle chroniqueuse sportive opportuniste (Rachel Hendrix), un présentateur météo foireux (Timothy Simons), nul besoin de faire dans la caricature, les personnages qu’ils incarnent en sont déjà les dignes représentants. Véritable immersion (presque documentaire) dans la vie de Christine Chubbuck, « Christine » ne laissera personne indifférent. Certains se seront enlisés dans la lenteur du film, d’autres auront apprécié l’exercice de style et l’interprétation impeccable de Rebecca Hall. Pour notre part, nous sommes partagés entre ces deux impressions mais nous assumons pleinement ce choix de voir que les Américains proposent encore un cinéma épuré, engagé et assumé. Durée du film : 1h55 Genre : Drame Film en compétition – 3 septembre 2016 Note du film : 6/10 (par François) Résumé du film : Voyage d’un teckel qui sera responsable de brefs moments de bonheur auprès des personnes qu’il rencontrent.. Avis : Sur le papier, le pitch intrigue mais venant de ce réalisateur, nous ne sommes aucunement surpris qu’il puisse en faire un long métrage. Est-ce pour autant le pari réussi (pro)clamé par le Jury de Deauville ? Rien n’est moins sûr… Todd Solondz c’est bien sûr deux prix reçus cette année au 42e Festival du Cinéma Américain de Deauville (prix du Jury et Prix Kiehl's de la Révélation) mais c’est aussi 22 nominations dans les plus prestigieux festivals. C’est dire si le bonhomme à des histoires à nous raconter… Découvert avec le très singulier « Dark Horse » à Deauville en 2011, puis rétrospectivement avec le politique incorrect mais très réjouissant « Storytelling » Todd Solondz fait partie de ces réalisateurs inclassables, nous offrant une vision désenchantée et délurée de notre quotidien. Le réalisateur, lui-même, semble venir d’une autre planète : son attitude gauche, son humour pince sans rire et son phrasé si particulier est à l’image de ses films : troublant. Certains crieront au génie (c’est le cas de votre serviteur pour certains de ses films précédents), d’autres seront choqués, secoués et ne reviendront plus le voir en salle. Ce qui est sûr, c’est qu’il ne laisse personne d’indifférent. Mais revenons au film. Film relativement court (1h28min) présentant un casting alléchant (Julie Delpy et Danny Devito en tête), « le Teckel » se voit comme une succession de sketches dont l’animal semble être le fil conducteur. En effet, le chien est bien présent dans la première partie du film pour être abandonné puis sauvé par une autre personne avant d’être également délaissée et reprise par un couple de trisomiques en quête d’affection et ainsi de suite. C’est dire si cette saucisse sur pattes voyagera (et nous avec). Seule la dernière partie verra son absence jusque dans la scène finale qui choquera assurément toute l’audience. Pour autant, le réalisateur confiera que ce n’est pas sa volonté et ne voit pas dans l’œuvre tournée une succession de saynètes mais bien un tout cohérent dont le fil rouge ne serait pas le chien mais bien la mort qui plane dans chacune des histoires racontées. Il serait alors un transmetteur, une sorte de fil rouge permettant au réalisateur de développer une thématique que nous n’avions pas perçue lors de la projection. Et c’est bien dommage ! Néanmoins, cette présence canine et son influence sur les personnages va bousculer leur quotidien et leur faire aller de l’avant. Alors bien sûr, nous retrouvons l’univers de Solondz avec l’importance de la lumière, des couleurs et des plans fixes qui permettent de faire un instantané sur ce qui se joue à l’écran. Nous rions malgré nous de l’audace des répliques, des silences gênants, du surréalisme de certaines scènes. Nous prenons la route aussi grâce aux musiques entêtantes fredonnées. Et même si la destination ne nous a pas plu, le voyage était surprenant. Pour autant, le réalisateur, de par ses choix de découpages scénaristiques, ne pourra pas fédérer tout le monde à sa cause. Quant à nous, cela nous donne l’envie de nous replonger dans sa filmographie en quête de pépites, bien éloignées de celle du « Teckel ». Date de sortie en France : 19 octobre 2016 Durée du film : 1h28 Genre : Comédie dramatique Titre original: Wiener Dog Note du film : 6/10 (par Véronique) Résumé du film: Newton Knight, fermier mobilisé pour la guerre de Sécession, décide que ce conflit n’est pas le sien. Aussi, lorsqu’il fuit le champ de bataille, il rencontre d’autres déserteurs (dont certains de couleur) avec qui il mènera de front, un combat contre l’abus et l’injustice de son époque. Avis: A mi-chemin entre “12 ans d’esclavage” et “The patriot”, “Free states of Jones” est un joli film d’époque. Magistralement interprété par Matthew Mc Conaughey, le long métrage de Gary Ross manque de liberté et ne parvient pas à se hisser au dessus de la mêlée des films du genre. Peut-être parce que le choix de la période filmée est un peu trop long. Peut-être parce que la double intrigue (se passant à 80 ans d’intervalle) saccade le rythme. Peut-être parce que le travail de post-production n’a pas été assez profond. Difficile d’identifier la cause mais ce qui est certain, c’est que s’il ne fait qu’une bonne heure quarante, la vision semble durer le double. La première partie, très intéressante, suffisait à elle-même. Basée sur des faits réels, l’histoire a de quoi surprendre ; présentant un pan de la Guerre de Sécession oublié de tous, elle met en exergue les abus de pouvoir de l’armée, le pillage honteux des troupes auprès des villageois du coin, la traque des déserteurs et le racisme outrancier de l’époque. Dès lors, Newton Knight décide de cesser de se battre dans une guerre qui n’est pas la sienne (il ne possède pas de grandes terres et n’emploie pas d’esclaves) et de défendre les fermiers du coin, victimes de l’armée des confédérés. Pour mener à bien son combat, il gagne la sympathie d’anciens esclaves, de paysans ou d’autres déserteurs et ensemble, ils constitueront un groupe bien plus déterminé que ceux qui les avaient enrôlés. Le message est fort, le combat honorable. Le racisme, tantôt insidieux tantôt ouvertement proclamé (malheureusement toujours présent dans le pays de l’Oncle Sam), écoeure et montre qu’il a toujours fait partie de l’Histoire, aussi méprisable soit-il ! En tête du groupe (et du casting), l’extraordinaire Matthew Mc Conaughey ! Si l’acteur n’a plus à prouver qu’il a tout des Grands, il nous offre à nouveau une prestation incroyable. Totalement impliqué, il devient un Newton Knight plus vrai que nature ! Il faut dire que le comédien n’a jamais hésité à se transformer pour les besoins de ses rôles. Ici encore, on le voit aminci, barbu, marqué par les épreuves endurées. Véritable caméléon, il réalise à nouveau un exercice de style impressionnant. Dans sa suite, on trouve une longue série de comédiens et de figurants (on a pu lire qu’ils avaient été près de 7000 à postuler pour le film) parmi lesquels Mahershala Ali (Boggs dans « Hunger Games » du même réalisateur, « L’étrange histoire de Benjamin Button ») et Gugu Mbatha-Raw (qui tenait le rôle principal dans le film « Belle »). Les décors (installés en Louisiane), les costumes, l’atmosphère du film sont au service de ces prestations mémorables au contraire d’une approche scénaristique qui semble parfois bancale. Gary Ross n’en est pourtant pas à son premier coup d’essai puisqu’il signe ici sa quatrième réalisation (« Pleasantville», « Seabiscuit » et « Hunger Games » sont de lui) : ce genre lui réussit-il moins ? On se pose véritablement la question… Toujours est-il que si nous avons apprécié découvrir ces faits historiques méconnus et la qualité d’interprétation de ses acteurs, « Free States of Jones » risque de tomber dans l’oubli dans nos souvenirs cinématographiques bien plus vite qu’on ne le pensait… Date de sortie en Belgique/France: 14 septembre 2016 Durée du film : Guerre/drame Genre : 1h47 Grand prix du Festival – en compétition le 9 septembre 2016 Note : 7/10 (par Véronique) Résumé du film : Jake et ses parents s’installent dans l’ancien appartement de son grand-père suite à son décès. Au rez-de-chaussée, on trouve une petite boutique de mode, tenue par Leonor, la maman de Tony pour qui Jake se lie d’amitié. Cette nouvelle vie semble idyllique jusqu’à ce qu’un événement vienne mettre à mal leur récente complicité. Avis : Gagnant du Grand prix du 42ème Festival du cinéma américain de Deauville, « Brooklyn Village » ne comptait pas parmi nos favoris. Néanmoins, le dernier long-métrage d'Ira Sachs contient quelques belles qualités et propose un beau moment ciné. Parfois comparé (à tort ?) à l’univers de Woody Allen (décidemment, on cherche toujours le digne successeur du réalisateur), « Brooklyn Village » nous immerge dans le quartier très prisé de Brooklyn. L’atmosphère dépeinte montre combien il fait bon vivre en dehors de l'animation du centre ville de New York, là où la liberté de mouvement est plus aisée que dans le quadrillage infernal de la CBD. Aussi, nos deux jeunes amis s'adonnent à des plaisirs simples comme les longues balades en rue, les séances de jeux vidéo, les matchs dans le square du coin. Ils redécouvrent à deux les plaisirs de l’amitié et ceux de l’indépendance juvénile. Mais sont-ils encore si jeunes que cela ? Leurs idéaux, leur discussion tentent à démontrer qu’ils sont déjà ancrés dans une vie de projets et non plus dans celle de l’insouciance. Tony n'a qu'un objectif en tête : devenir acteur. Aussi, il n’hésite pas à entraîner son ami dans un groupe d'improvisation où ils laissent libre cours à leurs émotions. Jake, lui, a toujours aimé le dessin et veut entrer dans une célèbre école d'art. Leurs rêves, leur amitié sont bénéfiques l'un pour l'autre. Mais tous les projets, tout l’univers qu’ils se sont construits risquent de s'écrouler quand les parents de Jake décident d’augmenter le loyer de la boutique de Leonor. Tout à fait légitimes, les nouveaux propriétaires des lieux ne font pas ce choix par profit égoïste mais parce qu’ils n'ont pas d'autres alternatives... Brian, le père, est acteur de théâtre alors que Kathy, psychologue, travaille tard pour faire vivre sa famille. Face à ce couple, Leonor, leur locataire du rez-de-chaussée, installée là depuis de nombreuses années, manque de ressources au point de ne pouvoir assumer cette augmentation inopinée. Pour éviter de se faire expulser, la coutière n’hésitera d’ailleurs pas à rappeler qu’elle s’est longuement occupée du père de Brian et que celui-ci était contre l’idée de voir son magasin fermer. Le dialogue est rompu, le conflit d’intérêts réel et l’amitié de nos deux héros est compromise. Ce thème, relatif aux problèmes d’argent, Ira Sachs l’a déjà exploité dans son cinéma. Dans « Love is strange », présenté il y a deux ans dans le même festival, il évoquait la difficulté d’un couple homosexuel à faire face à un problème économique. Qu’il s’agisse de celui-ci ou de sa réalisation précédente, le réalisateur parvient à chaque fois à nous faire entrer au cœur de la vie de ses personnages et fait de nous des spectateurs privilégiés. Le titre original, « Little Men » est relativement explicite. Ce ne sont pas les adultes qui sont au cœur de l’intrigue, mais bien ces adolescents qui, par les bouleversements de leur quotidien, vont peu à peu entrer dans le monde des adultes. Ces gamins, ce sont Jake (interprété par Théo Saplitz, scénariste et réalisateur de courts-métrages à seulement 13 ans !) et Tony (le débutant Michael Barbieri). Si leur jeu est parfois inégal, surtout en ce qui concerne Michael, ils parviennent toutefois à nous faire croire à leur amitié et nous à entraîner dans leur univers avec une décontraction et une assurance évidentes. Sans doute aussi parce qu’ils ont des coachs de rêve : les parents du premier ne sont autres que Greg Kinnear (l’extraordinaire père dans « Little Miss Sunshine ») et Jennifer Elhe (« Le discours d’un roi », « Les jardins du roi ») alors que Leonor, la peu commode maman de Tony, est Paulina Garcia, grande comédienne chilienne. Intrusif, bien interprété, le huitième long-métrage d’Ira Sachs manque parfois de cohérence. Agréable à voir, il ne nous a pourtant pas marqué au fer rouge et méritait peut-être de laisser sa place honorifique à d’autres films de la compétition bien plus innovants. Date de sortie en France : 21 septembre 2016 Durée du film : 1h25 Genre : Drame Titre original : « Little men » Prix D'ornano-Valenti – avant-première 11 septembre 2016 Note : 7,5/10 (par Véronique) Résumé du film : Peu de temps après la mort de son frère jumeau, Willy décide de tout plaquer pour vivre sa vie. Déterminé à avoir son propre appartement, son scooter et des amis, il quitte ses parents et part vivre sa plus grande aventure : celle qui le mènera vers son indépendance. Avis : Présenté lors du « Festival du film culte » de Trouville, « Willy 1er » passe le pont des Belges et se retrouve projeté dans la plus grande salle de la ville de Deauville dans le cadre de son célèbre Festival du film américain. Avec son angle si particulier, son personnage singulier et sa réalisation marginale, le film marquera forcément les esprits. A mi-chemin entre la biographie et la comédie- dramatique, « Willy 1er » est librement inspiré des histoires vécues par son interprète principal : Daniel Vannet. Le terreau de base n'est autre que les anecdotes de ce personnage atypique en quête de reconnaissance et de liberté. Bien sûr, les réalisateurs (et scénaristes) ont ajouté leur petite graine afin d'offrir une continuité à sa réalité. Daniel n'a jamais croisé la route de Willy (le deuxième, son collègue dans le film), il n'avait pas de frère jumeau mais il fallait une certaine cohérence et les auteurs en ont trouvé une. A tel point que le résultat est appréciable et hautement original ! Noémie Lvovsky (la réalisatrice/actrice entre autre de « Camille redouble ») est le seul visage connu du casting. Tous les autres comédiens sont issus du terroir prolifique de Normandie ! A commencer par Daniel Vannet, le héros du film, celui sur qui tout repose. Cet acteur amateur a déjà tout d'un grand : une attitude, une présence, une capacité d'interprétation que beaucoup peuvent lui envier. Et ce, de façon innée. Il en va de même pour Romain Léger (Willy II) qui offre un jeu tout aussi performant, n'hésitant pas à jouer les victimes ou les transformistes. Le duo est touchant, la rencontre délectable et les talents se conjuguent pour rendre ce tandem plus vrai que nature. Derrière la caméra et au scénario, ils sont quatre : Ludovic Boukherma, Zoran Bouckherma, Marielle Gautier et Hugo Thomas (tous sortis en 2012 de l'Ecole de la Cité de Luc Besson). C'est en toute décontraction que notre quatuor vient présenter le film et chercher son prix. Prix qui permettra à « Willy 1er » de fouler le sol américain et d'être projeté à des milliers de kilomètres de là où tout a commencé. Tout cela semble surréaliste et est à l'image du film : cocasse ! L'humour côtoie de près la détresse. On rit de bon coeur de certaines situations (celle du recrutement, de la tombe, du panorama de Cauderec), mais au fond, est-ce vraiment drôle ? On culpabilise parfois, on maudit les rencontres malveillantes et on évolue dans la vie de Willy comme si nous le connaissions véritablement. Parfois lent, le film se veut « hors norme » et çà marche ! Même la musique (composée par Hugo Thomas l'un des réalisateurs et Sofiane Kadi) vient appuyer l'originalité du propos et de la mise en scène Touchant et authentique, « Willy 1er » est un OFNI (Objet filmique non identifié) dans le ciel cinématographique contemporain. Une bouchée d'oxygène qui montre une réalité, une volonté de s'affranchir, une ambition que beaucoup fuient. Pas Daniel, pas Willy. Comme le dit si bien le personnage « Pour beaucoup, le quotidien, çà les emmerde. Moi, j'aurais bien voulu qu'il continue un peu ». Heureusement pour nous, l'équipe du film nous a fait sortir du nôtre pour nous offrir un moment de ciné sans fioriture, sans artifice, juste avec une humilité et un regard décalé sur la vie d'un personnage qui ne pourra que vous toucher! Date de sortie en France : 19 octobre 2016 Durée du film : 1h22 Genre : Comédie dramatique Note du film : 7,5/10 (par Véronique et François) Avant-première – 2 septembre 2016 – Résumé du film : Robert Mazur, agent spécial, est proche de la retraite. Néanmoins, il voit une occasion unique d’exercer ses talents une dernière fois et d’infiltrer les cartels de la drogue colombiens, dont celui de Pablo Escobar. En chemin, Bob se rend compte que ces trafics ne seraient pas possibles sans l’aide d’une banque internationale de renom. Déterminé à faire tomber ces malfaiteurs de renom, il n’hésitera pas à mettre sa propre vie (et celle de sa famille) en péril. Avis : Un film avec Bryan Cranston, çà ne se refuse pas. L’excellentissime « Dalton Trumbo » ou Walter White (personnage central de la série « Breaking Bad ») change radicalement d’univers puisque cette fois, il s’infiltre dans le monde des cartels de la drogue, espérant remonter jusqu’à Pablo Escobard himself ! S’il cumule les rôles au cinéma depuis les années 90, ces derniers temps ont été plus prolifiques et nous ont permis de (re)connaîre le talent de ce caméléon hors pair ! Une fois encore, avec « Infiltrator », il nous donne une belle leçon de cinéma ! Plus vrai que nature, l’agent Robert Mazur aura fort à faire pour gagner la sympathie de ces trafiquants de grande ampleur et usera de stratégies diverses pour entrer au sein de ces cartels imposants. L’acteur et son personnage se confondent et ne forment plus qu’un au point qu’on en oublierait presque les traits de l’interprète. Il paraît que Bryan Cranston a passé beaucoup de temps avec l’agent spécial pour être au plus près de la réalité : pari relevé ! Le héros central dont est tirée cette biographie était d’ailleurs présent dans la salle ce 2 septembre parait-il… vrai ou pas, cela ajoute une petite touche particulière à sa diffusion. Le protagoniste doit être fier d’être interprété ainsi de main de maître par un Bryan Cranston impeccable mais nous n’avons pas pu le lui demander, anonymat exige ! Seule représentante de l’équipe du film, Diane Kruger nous confie, dans un français impeccable, qu’elle a d’ailleurs été très intimidée par son partenaire de jeu. Très fan de la série « Breaking Bad », elle n’osait quasiment pas l’aborder le premier jour du tournage. Après, c’était plus facile. Elle a été particulièrement impressionnée de voir combien l’acteur s’efface totalement devant son personnage. Il a énormément travaillé pour préparer ce rôle et cela se voit. Le comédien n’a malheureusement pas pu être là le jour de l’avant-première car il est actuellement en tournage en tant que réalisateur : on lui souhaite d’ailleurs autant de succès derrière la caméra que devant ! Mais revenons sur la jolie blonde qui se révèle elle aussi dans ce film. La comédienne, habituée aux grands écarts filmographiques (passant de Marie Antoinette chez Benoit Jacquot à Hélène de Troie ou de « Michel Vaillant » à « Benjamin Gates »), assume un rôle délicat avec brio. Complice de Robert Mazur, elle n’hésite pas à mouiller sa chemise et à partager les délicates missions de son partenaire. Ils ne sont pas les seuls à assurer dans leur prestation, le casting secondaire est lui aussi costaud : John Leguizamo (« John Wick », « #Chef »), Benjamin Bratt ou Yul Vazquez en sont quelques exemples. Basé sur une histoire vraie, le scénario de « Infiltrator » est bien pensé et assure bien plus que la réalisation de Brad Furman. Le jeune américain a déjà quelques films à son actif : « Players », « La défense Lincoln », c’était lui. Ici, il nous propose une histoire rythmée mais inconstante. Les premières minutes nous fournissent une multitude d’informations dans lesquelles on peut aisément se perdre pour finalement nous entraîner au cœur d’une affaire de grande envergure. Si le temps peu sembler long à certains moments, notons que la performance des acteurs sauve ce manque de structure rythmique. Sans trop dévoiler l’intrigue du film, on peut dire que l’idée de Robert Mazur est vraiment efficace. Plutôt que de remonter les traces de la drogue, pourquoi ne pas suivre celles de l’argent qui fait vivre les cartels ? Ainsi, Bob s’infiltre progressivement dans le monde des barons de la drogue en proposant des blanchiments d’argent. Le risque n’est-il pas trop grand ? Parviendra-t-il à faire tomber toutes ces têtes dangereuses ? Comment ne pas se faire démasquer lorsqu’on est en permanence traqué ? Le suspense et l’action sont au rendez-vous ! Présenté dans le cadre des « avants premières » du Festival de Deauville, le dernier film de Brad Furman offre un bon divertissement et un casting excellent. S’il démontre quelques petites faiblesses, on saura vite le lui pardonner et on se laissera emporter dans cet univers fermé avec un plaisir incontesté. Date de sortie en Belgique : 14 septembre 2016 Date de sortie en France : 7 septembre 2016 Durée du film : 2h05 Genre : Thriller Titre original : The infiltrator Note du film : 8,5/10 (par Véronique et François) Avant-première – 4 septembre 2016 – Résumé du film : Toby et Tanner Howard, deux fermiers texans, s’adonnent à une série de braquages dans différentes agences de la même banque. La raison ? Cette banque a saisi la propriété de leur mère récemment décédée et ils sont déterminés à la récupérer. Leur plan bien échafaudé semble se dérouler comme prévu mais c’était sans compter sur Marcus Hamilton, un ranger proche de la retraite… Avis : « Comancheria » est sans aucun doute notre coup de cœur de la sélection « Avant premières » du 42ème Festival du film américain de Deauville. Efficace, dynamique et drôle, le dernier film de David MacKenzie est une valeur sûre que nous vous recommandons de voir. L’Ecossais n’en est d’ailleurs pas à son premier film puisqu’il signe ici sa neuvième réalisation. Mais nul doute qu’avec « Comancheria », son talent de metteur en scène sera (enfin) reconnu. C’est avec une sensibilité à fleur de peau que David MacKenzie vient nous le présenter, d’autant plus que c’est la première fois que sa famille découvrira ce film (ses deux jeunes enfants et sa femme étant dans la salle). D’une humilité et d’une sympathie réelles, le réalisateur explique qu’il est ravi que le titre de travail ait été gardé pour la distribution en France alors qu’elle se fait généralement sous son titre original « Hell ou High water ». Mais pourquoi « Comancheria » ? Parce que le titre désigne la région qui se situe, en gros, entre le Texas et le Nouveau Mexique et appartenant autrefois au peuple indien comanche. Cette contrée a une importance capitale dans le film et devient presque un personnage à part entière. David MacKenzie sait d’ailleurs la sublimer et nous offre des vues de ces grands espaces arides à couper le souffle. Le Texas est donc au centre de cette intrigue, issue d’un savant mélange entre polar, roadmovie et western moderne. Les codes sont respectés et les spectateurs se retrouvent en deux temps trois mouvements en plein cœur de cet état où rednecks, dinners, cowboys, nationales droites, whisky, poussière, armes et rangers font partie de la culture locale. Tout y est, sans clichés, juste avec une authenticité réelle et savoureuse. Le décor planté, il nous faut évoquer le travail d’écriture singulier. Le scénario, écrit par Taylor Sheridan (auteur de « Sicario » de Denis Villeneuve qui s’était également fait remarqué lors du 41ème Festival de Deauville), est d’une intelligence et une profondeur inégalées. Les dialogues sont exquis, les répliques cultes, le propos brillant et incontestablement équilibré. L’humour y tient une place prépondérante et fait éclater la salle de rires à plusieurs reprises : c’est un pur régal ! La bande originale est elle aussi très intéressante et se calque sur les images et les agissements de nos héros avec une pertinence évidente. Warren Ellis et Nick Cave ont fait du bon travail et ajoutent une pierre angulaire à cette réalisation qui frôlait déjà le sans faute. Qu’en est-il du casting ? Là aussi, on ne peut qu’acquiescer face au choix des comédiens qui prennent une place de choix dans ce film de qualité. Leurs talents sont mis en exergue et leur jeu offre une prestation irréprochable. MacKenzie met en scène deux tandems distincts et hautement remarquables. D’un côté Chris Pine (« Star Trek », « Comment tuer son boss 2 », et Ben Foster, (Lance Armstrong dans « The program », « Kill your darlings », « Warcraft »), déjà vus côte à côte pour le film « The finest hours ». Ici, ils incarnent les deux frères braqueurs au plan bien huilé. S’ils agissent en vrais criminels, peut-on pour autant dire qu’il s’agit de vrais bandits ? Pas vraiment puisqu’ils pillent les banques qui les ont préalablement plumés. Leur braquage serait presque légitimes, surtout qu’ils réinjectent l’objet de leurs modestes larcins dans la société qu’ils ont volé. Nous ne cautionnons bien évidemment pas leurs agissements mais le propos prête à réfléchir et montrent combien leurs actes ne sont pas gratuits. Toby (Chris Pine) ne souhaite pas avoir recours à la violence et s’en tient au programme prévu. Tanner (Ben Foster) est davantage une tête brûlée et ajoute une pointe de fun dans leurs descentes, au risque de tout faire foirer. Deux caractères radicalement différents, deux personnages hauts en couleurs pour deux comédiens d’envergure ! De l’autre côté, Jeff Bridges (inoubliable dans « The Big Lebowski ») et Gil Birmingham (Billy Black dans la saga « Twilight »), deux rangers texans dans ce qu’ils ont de plus authentiques. Marcus Hamilton (Bridges) ronchon incontesté, est proche de la retraite. Fin limier, il décide de traquer les deux braqueurs de la région et les empêcher de sévir à nouveau. Son caractère bourru et ses vannes racistes envers son coéquipier Alberto (Birmingham) aux origines indiennes et mexicaines, font de lui le personnage le plus délectable du film. Sorte d’inspecteur Harry des plaines, il offre des scènes d’anthologie et prouve l’étendue de son talent ! La maîtrise de sa réalisation, son amour des paysages, son souhait d’offrir une intrigue costaude et intelligente font du dernier film de David MacKenzie, une vraie pépite cinématographique ! A découvrir de toute urgence ! Date de sortie en Belgique : 21 septembre 2016 Date de sortie en France : 7 septembre 2016 Durée du film : 1h42 Genre : Thriller/Policier Titre original : Hell or high water Note du film : 8/10 (par Véronique)
Film en compétition – 4 septembre 2016 – Résumé du film : Mo, tout juste sorti de prison, tente de mener une vie tranquille en vivant dans un petit appartement et en travaillant dans un refuge pour chiens. Mais lorsque Doris débarque subitement dans sa vie, c’est sa liberté et sa tranquillité qui risquent d’être mises à l’épreuve. Avis : « The free world » n’a de prime abord, rien de bien novateur. Un ex-détenu qui tente de se réintégrer dans la société mais qui s’attire des problèmes, c’est du déjà vu. Mais, c’était sans compter sur la patte de Jason Lew qui, pour un premier long métrage en impose pas mal en la matière ! Le trentenaire est cependant loin d’être un novice dans l’univers du cinéma. Après avoir consacré une bonne partie de sa carrière au théâtre, il travaille comme scénariste avec Gus Van Sant pour le film « Restless », une adaptation de l’une de ses propres pièces. Avec « The free world », le jeune réalisateur réitère l’exercice et offre un scénario original qu’il a mis près de cinq ans à écrire. Le résultat vaut la peine d’être vu, tant pour son approche que pour sa direction d’acteurs. Jason Lew aime ses comédiens et cela se voit : il les sublime, donne une ampleur à leur personnage et ne cesse de les mettre en valeur, que ce soit dans l’affrontement, la complicité ou la fuite. Au centre de l’intrigue Mo (Mohammed), nouveau nom que s’est choisit ce jeune sorti de prison en quête de rédemption. Pour l’aider à réintégrer la société, il a choisi de se convertir à l’Islam et de travailler dans un refuge pour chiens aux côtés de Linda (remarquable Octavia Spencer). Bienveillante, elle le protège des petites agressions mesquines extérieures sans jamais juger son potentiel passé criminel. D’autant plus que son assistant peine à accepter la souffrance et la maltraitance des petits animaux et semble bien sensible pour quelqu’un qui aurait commis d’atroces crimes… Mo est très justement interprété par Boyd Holbrook, acteur dans la série « Narcos » ou dans quelques longs métrages tels que « Entre les tombes », « Night Run » et prochainement à l’affiche du très attendu « Morgane ». Marqué par son passage en prison, son personnage est devenu méfiant, s’est replié sur lui-même et supporte peu les grands espaces. Sa vie tranquille explose en mille éclats lorsque qu’il décide de prendre Doris sous son aile. Pourquoi cette jeune femme se retrouve-t-elle au beau milieu de la nuit dans le refuge? Pourquoi est-elle couverte de sang ? Que s’est-il passé de tragique dans sa vie ? Mo ne cherchera pas à le découvrir. Seule l’aide qu’il peut apporter à Doris compte. La jeune femme est incarnée par une Elisabeth Moss fabuleuse. Héroïne de la série « Mad Men » (Peggy Olson), elle opte pour une interprétation très différente de ce qu’on lui mais tout aussi concluante. De la panique à l’apaisement, elle fait siennes toutes les émotions de son étrange personnage. Les deux comédiens évoluent dans une réalité de jeu probante au point de nous faire oublier que ce ne sont pas leurs propres vies qui se déroulent sous nos yeux. Le sujet du film est doublement intéressant. Tout d’abord parce qu’il réhabilite les valeurs nobles de l’Islam (bien mal jugé en ces temps de radicalisme et d’amalgames) et montre combien Mo puise dans cette religion (et sa philosophie), des ressources lui permettant d’aller de l’avant, de trouver la rédemption et permettre d’aider Doris au mieux sans hésiter une seule seconde à sacrifier ce qu’il a mis des mois à reconstruire. L’autre intérêt réside dans la façon dont les personnages principaux (l’employeur de Mo, Doris et lui-même) parviennent à faire abstraction du passé de chacun, de ne pas vouloir savoir à tout prix ce qui les a conduit à la situation qui les occupe mais de s’accepter tels qu’ils sont au moment présent, sans jamais se juger les uns et les autres. Cette vision des choses est à l’opposée de celles des policiers de la ville qui n’ont de cesse d’accabler Mo de tous les maux régionaux. La réalisation est bien maîtrisée et la dynamique du film nous tient en haleine tout au long de cette heure quarante. De nombreux twists viennent ponctuer la trame générale au même titre que cette ambiance tendue qui cueille le spectateur avide d’aventure. Les émotions divergent nous offrant tantôt de la tendresse, tantôt de l’adrénaline ou de la colère. Là où Jason Lew fait preuve d’intelligence, c’est qu’il nous conduit peu à peu vers une fin attendue… qui virevolte vers une issue moins prévisible. Difficile de se prononcer sur la possible récompense de ce film. Rempli de valeurs, formidablement interprété par ses acteurs, « The free world » recèle de belles qualités et mérite de s’y attarder. Durée du film : 1h40 Genre : Drame Note du film : 5/10 (par Véronique) Film en compétition – 3 septembre 2016 - Résumé du film : Beth, Gina, Laura et Jamie. Quatre femmes radicalement différentes : deux d'entre elles sont avocates, une autre tient un ranch à l’écart de la ville et la dernière se lance dans le projet de construction d’une maison en pleine nature. Un seul point commun les caractérise : la solitude de leur vie. Ce sont des extraits de leur quotidien que Kelly Reichardt nous présente dans « Certain Women ». Avis : Il n’est pas toujours évident de donner un avis sur film tel que « Certain Women », non pas qu’il nous inspire peu mais parce qu’à la sortie de la projection, nous ne savons toujours pas quelle était l’intention de la réalisatrice ni l’intérêt réel du film. C’est d’ailleurs le sentiment général qui anime bon nombre de spectateurs. Pour comprendre l’univers présenté dans ce film par Kelly Reichardt, nous nous sommes intéressés à la biographie de sa metteur en scène. Passionnée par la photographie, elle l’étudie à l’université de Boston avant de son plonger dans le monde du cinéma. Ses cinq premiers long-métrages (« River of Grass », « Old joy », « Wendy & Lucy » « La dernière piste » et le remarqué « Night Moves ») montrent par ailleurs son intérêt pour les grands espaces américains et pour la nature humaine. Scénariste de plusieurs de ses films, elle adapte une nouvelle de Maile Melo (tirée du livre « Ways Is the Only Way I Want It: Stories ») pour son dernier long-métrage « Certain Women ». La photographie de ce film est d’ailleurs très importante (on comprend mieux pourquoi à présent). Les personnages, leur environnement, les espaces naturels qui les entourent sont au centre de son sujet. Kelly Reichardt prend le temps de planter le décor et laisse davantage de place aux images qu’aux mots. L’action se passe en hiver, dans une région des USA relativement peu peuplée, ce qui ajoute une désolation visible à celle présente dans la vie de ses personnages. Les dialogues sont peu nombreux et concis et la psychologie des héroïnes se comprend davantage au travers de leurs gestes et de leurs états d’âmes. Les femmes qu’elle choisit de nous présenter appartiennent à trois histoires distinctes : Beth (Kristen Stewart) est une jeune avocate qui cumule le métier de professeur de droit scolaire en promotion sociale à 4h de route de chez elle. Grâce à ce job, elle se lie d’amitié avec Jamie (Lily Gladstone), une « élève libre », propriétaire d’un ranch où elle élève des chevaux. Le seul lien social de cette dernière est le cours de droit qu’elle suit totalement par hasard et les repas pris avec son jeune professeur. Laura (Laura Dern) est une avocate expérimentée à la vie plutôt morose qui défend un client quelque peu intrusif. Victime d’un accident sur un chantier où il travaillait, celui-ci estime qu’il a été lésé par son employeur. Près à tout pour être entendu, il n’hésite pas à prendre sa propre avocate en otage. Enfin, Gina (Michelle Williams, comédienne récurrente dans le cinéma de Reichardt) se lance dans le projet de construction d’une maison et vient chercher des blocs de grès chez un voisin esseulé qui n’a que pour seule compagnie le chant des oiseaux. Le lien qui unit certaines de ces femmes est plutôt mince. On ne comprend d’ailleurs pas l’intérêt réel de rassembler ces morceaux de vie en un seul film. D’une lenteur incroyable, il nous semble même que le chemin qui mène vers la fin (incisive et non annoncée tant elle est brute) est long, long, long. Malgré le casting féminin plutôt costaud (les comédiens de seconds rôles le sont tout autant), on ne parvient pas à accrocher et à s’enthousiasmer face à « Certain women ». Présenté en compétition lors du 42ème Festival, nous ne misons pas cher sur sa probable possibilité de remporter un quelconque prix et vous conseillons de passer votre chemin à la faveur d’autres films de la sélection. Durée du film : 1h47 Genre : Drame Note du film : 9/10 (par Sally et Stanley) Film en compétition – 3 septembre 2016 - Résumé du film : Ben vit dans le Grand Nord américain avec ses six enfants. Isolée du reste du monde, la joyeuse tribu cultive son esprit et son corps dans un respect total de la nature. Lorsqu’un événement tragique touche de près la famille, c’est son équilibre qui est menacé. Contraints de regagner la « civilisation », Ben et ses enfants vont devoir faire face à cette société en décalage avec leurs propres valeurs. Avis : « Captain Fantastic » a ouvert la compétition de ce 42ème Festival du cinéma américain de Deauville d’une bien belle façon. Après deux heures de balade sur la palette des émotions, c’est avec un enthousiasme réel que la salle toute entière s’est levée pour applaudir Matt Ross : le ton est donné et les autres films en lice auront fort à faire pour dépasser une telle réalisation ! Comme nous l’avons dit au réalisateur lors de notre échange en fin de projection, « Captain Fantastic » est un film plein d’espoir(s). Intelligent, très bon et très beau, son long-métrage est une valeur sûre d’ores et déjà, un incontournable. Retour sur cette vraie pépite que tous les orpailleurs du cinéma rêveraient de mettre en scène… « Le but de l’éducation, c’est de montrer aux gens comment apprendre d’eux-mêmes les choses. L’autre concept de l’éducation, c’est l’endoctrinement ». Cette citation de Noam Chomsky est l’essence même de ce que Ben, père de famille engagé, veut transmettre à ses enfants. Référence absolue du personnage, il fait de ce libre penseur un guide, une référence pour mener à bien l’éducation humaniste qu’il a choisie pour sa famille. En effet, Ben et sa femme, ont décidé de vivre à l’écart de notre société. Installés dans les bois du Nord des USA, ils mènent, avec leurs six enfants, un mode de vie en autarcie où la culture physique et idéologique ont une place prédominante. Bien décidé à en faire des « philosophes rois », Ben met en place un programme éducatif exigeant, les formant à faire face à un capitalisme frénétique et une société de surconsommation dictatoriale. Il ne laisse aucune place à une infantilisation inutile (à quoi bon préserver les enfants du monde violent s’ils ne sont pas armés pour le contrer?) et décide de tout dire à sa famille. Il veut faire d’eux des individus uniques (leurs prénoms très originaux en est d’ailleurs la preuve), ainsi, jeunes comme moins jeunes développent un esprit critique et peuvent exprimer leurs points de vue, leurs intuitions, leurs savoirs en toute liberté. Ce choc des cultures a l’intelligence de chercher le dialogue, même lorsque les membres de la famille s’opposent, et ce, afin de comprendre le point de vue de chacun. Et si les mots manquent, le non verbal est aussi considéré comme langage à part entière. Seule la musique, (qui prend une place importante dans la dimension éducative ET récréative de la famille) semble pouvoir faire l’objet d’improvisation, de lâcher prise et cède place à des moments de joie, de partage sans raisonnement théorique. Malgré tout, le choix éducatif de Ben a ses faiblesses : n’y a –t- il pas un moment pour tout ? Doit-on tout dire à des enfants ? Le temps de l’insouciance ne doit-il pas précéder le monde des adultes ? A cette éducation pourtant belle, il manque l’essentiel : l’école de la vie. C’est d’ailleurs ce que ne cessera de rappeler la famille de sa femme, qui voit dans cette philosophie quotidienne, les limites de la socialisation. Comment feront-ils lorsqu’ils intégreront la société « moderne » ? Ne seront-ils pas des « handicapés sociaux » bien pensants mais en décalage total avec la réalité ? Le point de vue de la famille de Ben met en exergue une critique de la société américaine : sa surconsommation (on notera la musique du film « Titanic » lorsqu’il est contraint de se rendre au supermarché), le surpoids de sa population, son manque d’intérêt pour la constitution, ses droits et ses devoirs, la perte d’identité de chacun. Jamais ce sujet n’aura été traité avec autant d’audace, de force et de beauté au cinéma ! Le spectateur se place d’ailleurs au centre de la famille, devenant par ce fait, un acteur de sa propre perception cinématographique, on les accompagne au plus près dans leur quotidien et on se place au dessus de ces personnages dans l’espoir de les voir trouver un équilibre, un juste milieu… La réalisation efficace, nous prend d’emblée et nous entraîne durant près de deux heures dans un univers bien pensé avec un scénario original qui ne parviendra jamais à s’essouffler. Oscillant entre humour et réflexion, Matt Ross nous cueille au plus profond de nous et offre un instant de cinéma qui nous marquera longtemps encore. En plus d’être un des acteurs vedettes de la série « Silicon Valley » ( ou d’être à l’affiche de films tels que « Aviator », « Good night and good luck » ou « American Psycho ») c’est aussi un réalisateur modeste et très à l’écoute de son public. Avec « Captain fantastic » il signe un quatrième film superbe qui magnifie la nature (au point d’en faire presque un personnage à part entière) et ses acteurs sur un fond de bande originale totalement raccord avec les émotions qui les animent. Justement, attardons-nous un moment sur ces acteurs, tous convaincants, qui offrent un jeu juste, interprété avec force et conviction. A commencer par les plus jeunes : Charlie Shotwell et Shree Crooks, tout simplement incroyables ! Tous jeunes et pourtant déjà si talentueux, ces deux acteurs en herbe ne le sont déjà plus et nous offrent plusieurs moments d’anthologie ! Les plus âgés ne sont pas en reste puisque Annalise Baso, Samantha Isler et Nicholas Hamilton s’accordent au diapason de ces formidables interprétations ! Enfin, George MacKay, qui joue Bodevan le frère aîné, vient faire le lien entre l’enfance, l’adolescence et le monde des adultes en soutenant son père dans ses choix ou défendant l’opinion et les intérêts de tous lorsque c’est nécessaire. Même le casting secondaire (on pense notamment à Frank Langella ou Kathryn Han) vient s’aligner avec une précision de jeu telle que l’on entre dans leur vie sans jamais penser que nous sommes finalement immergés dans une fiction. Enfin, Viggo Mortensen, grand acteur de notre temps, nous offre un jeu incroyablement vrai et dirige toute cette petite famille à la baguette (de roseau) de main de maître. Cette tribu atypique, soudée dans le malheur comme dans le choix de vie, est le reflet d’une équipe de film complice et totalement investie. « Captain Fantastic » est sur les lèvres de tous les festivaliers de Deauville tant il a su les toucher en plein cœur. Sa thématique, sa réalisation, son interprétation font de ce film un des favoris de la compétition et un must de cette année 2016 ! Date de sortie annoncée : 22 octobre 2016 (en France) Durée du film : 1h58 Genre : Drame |