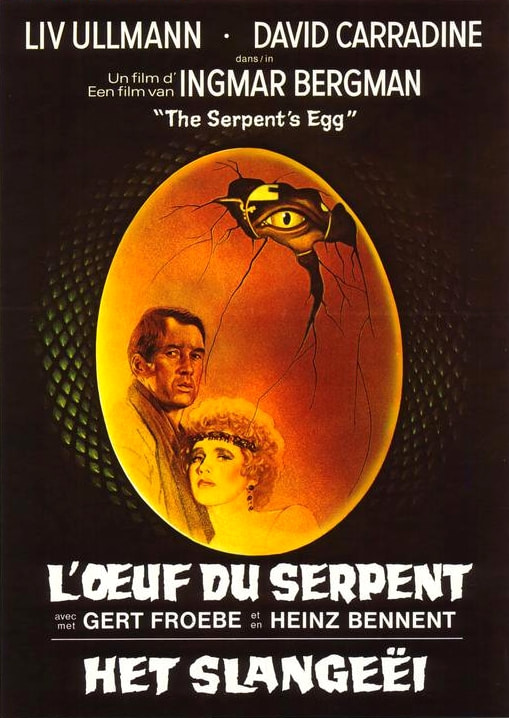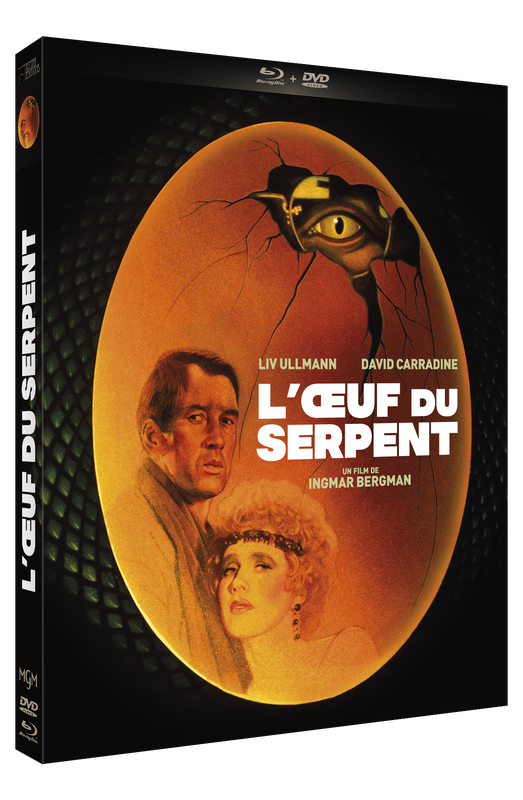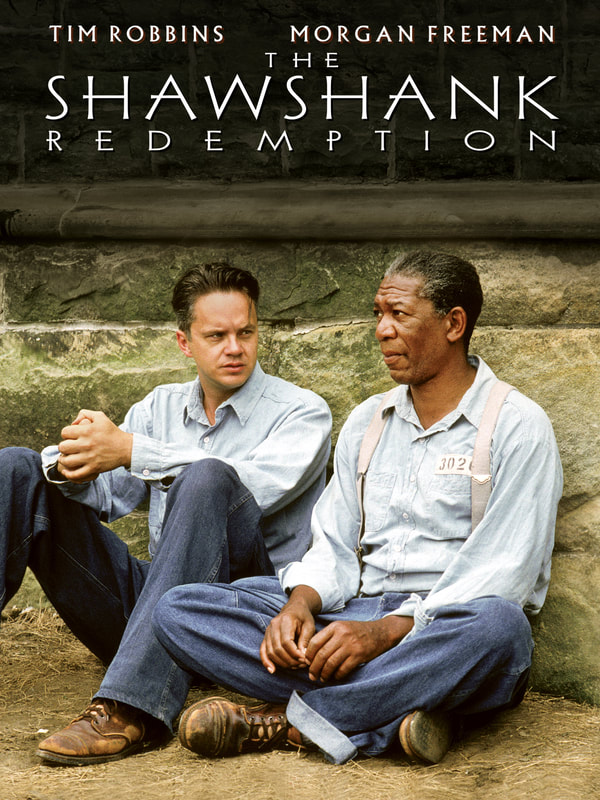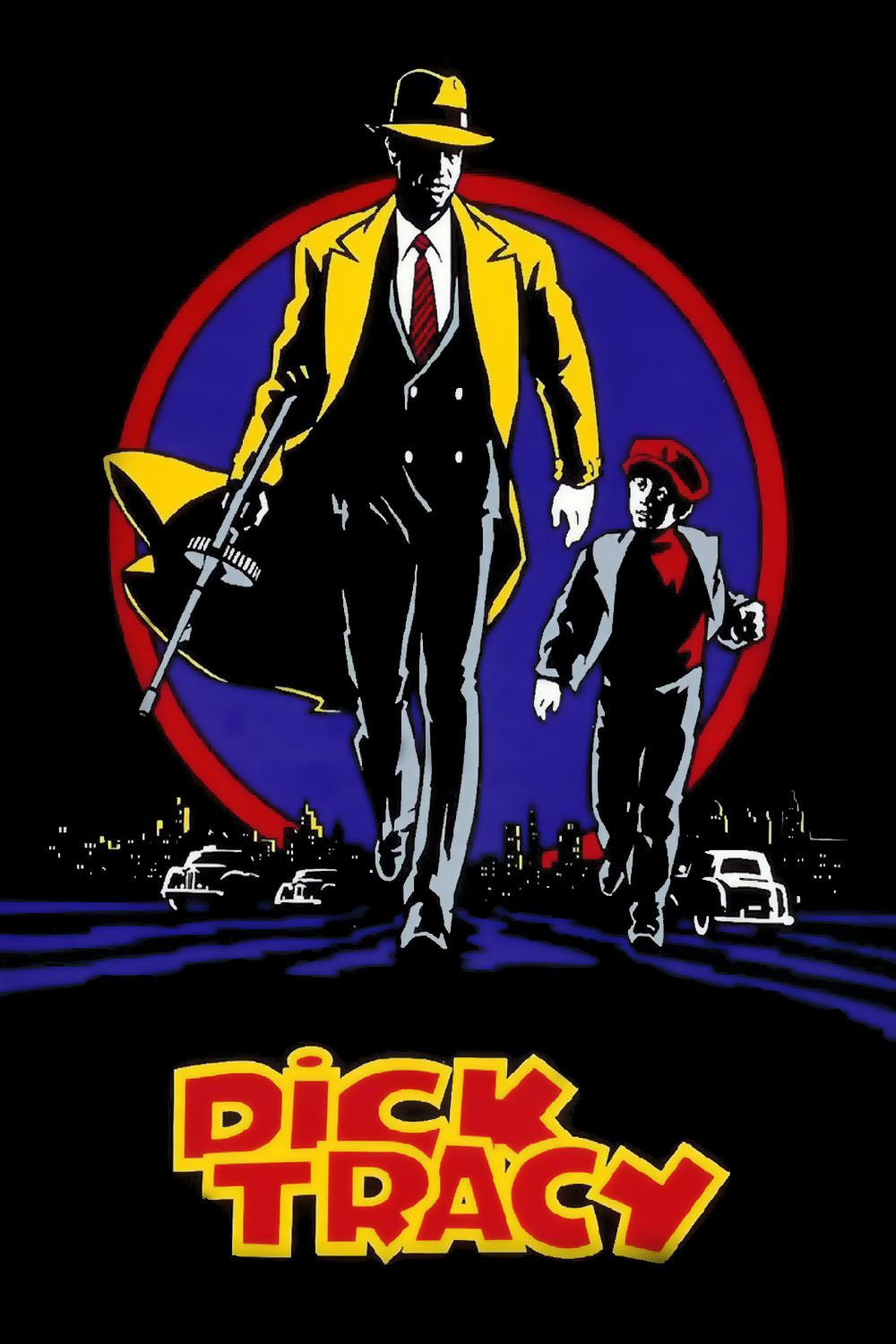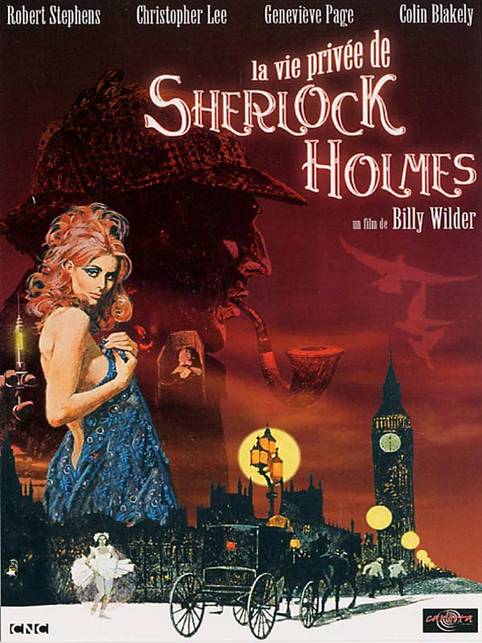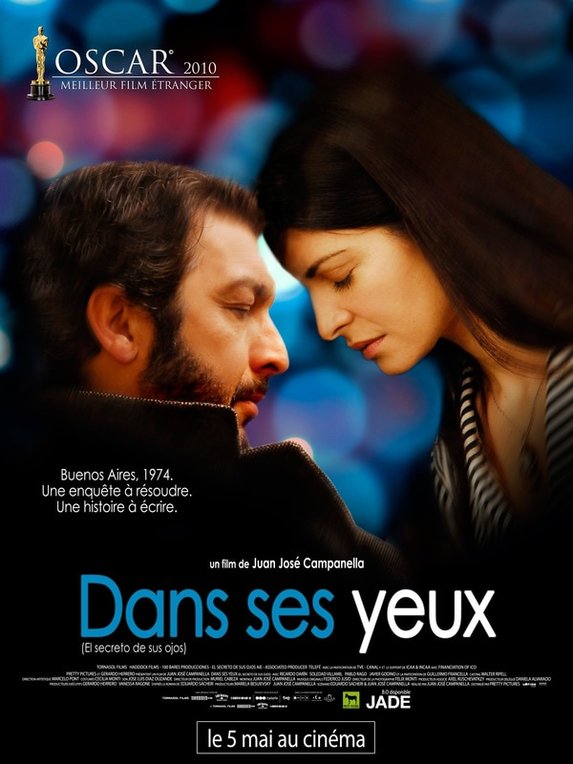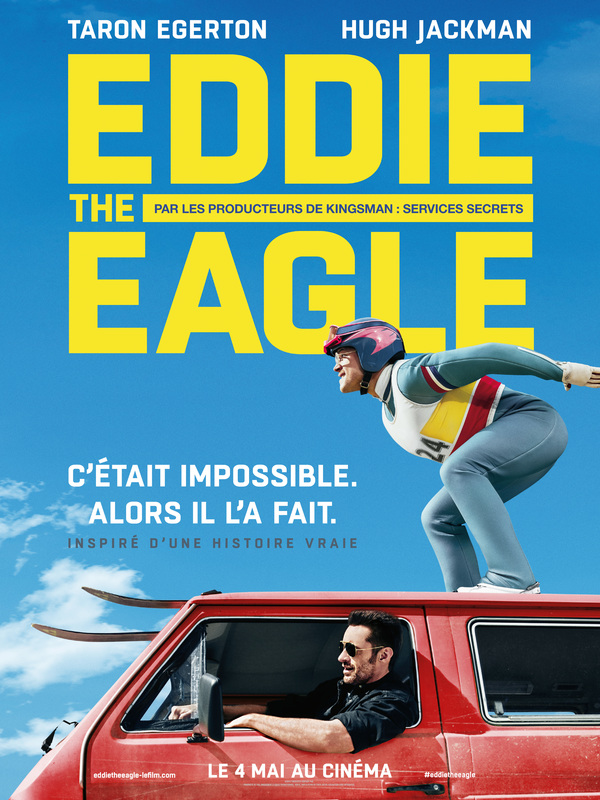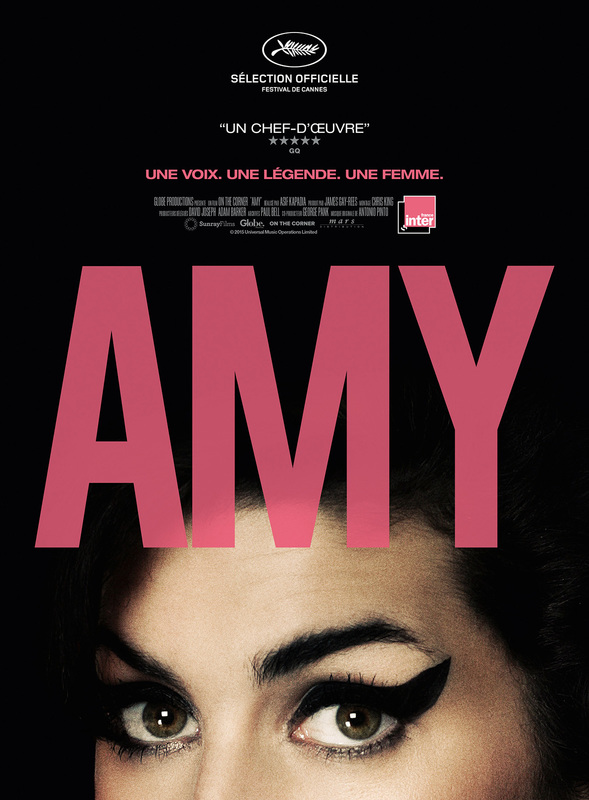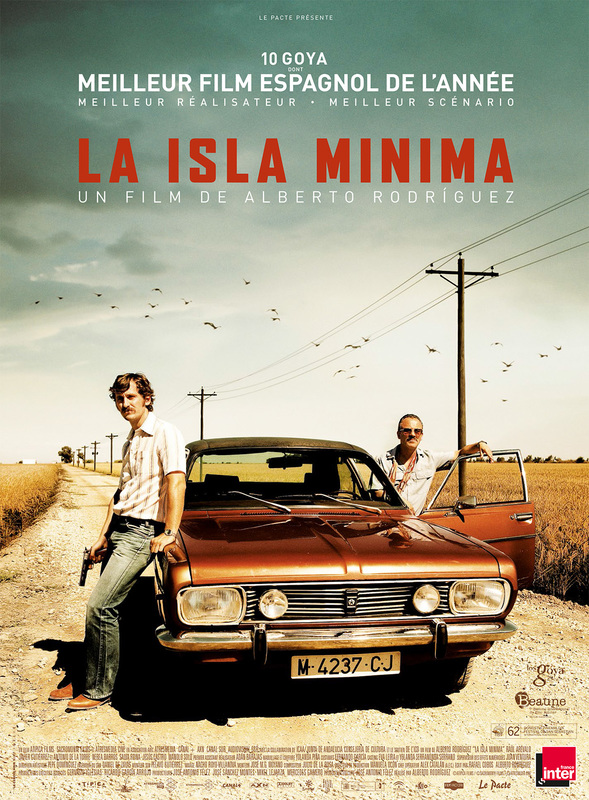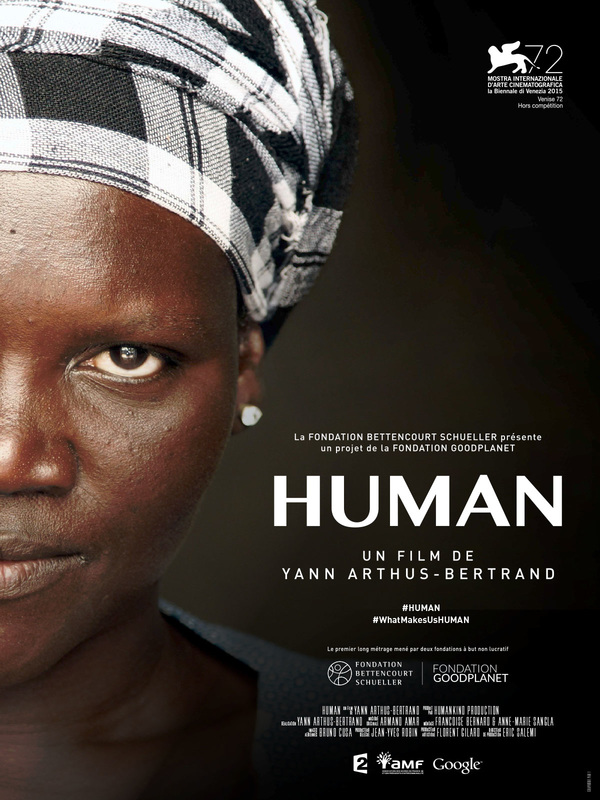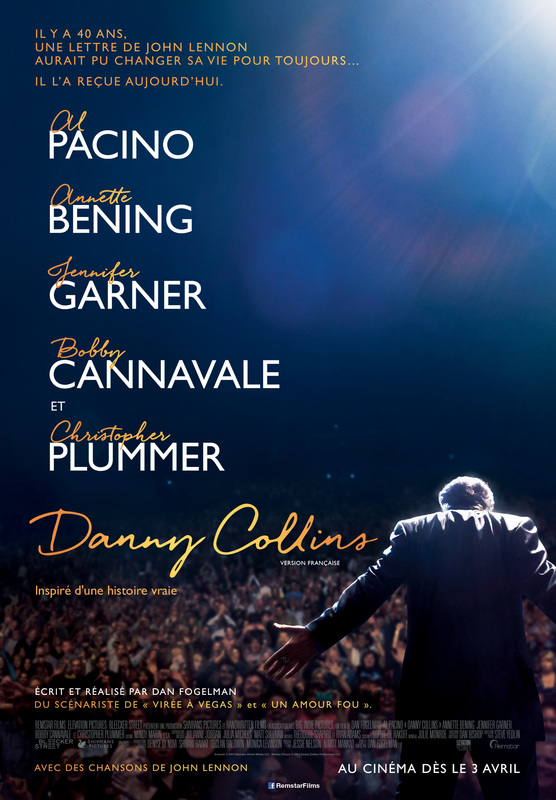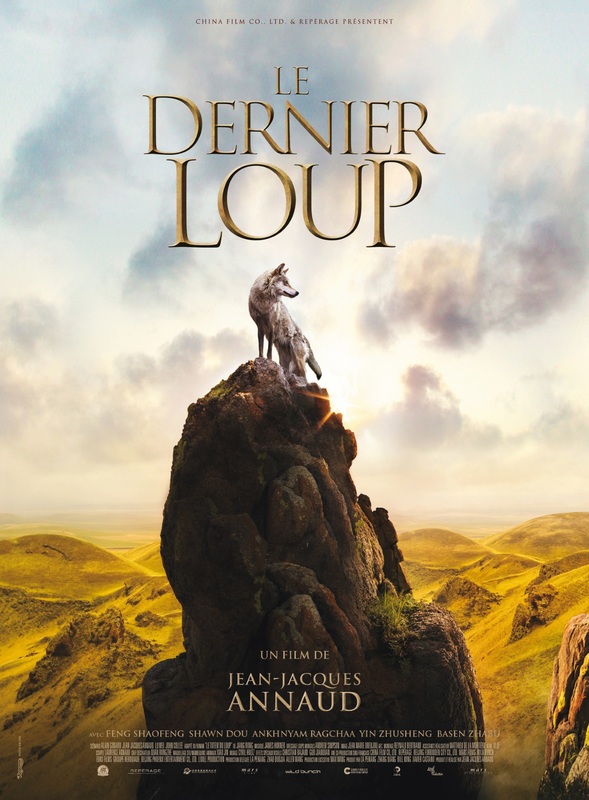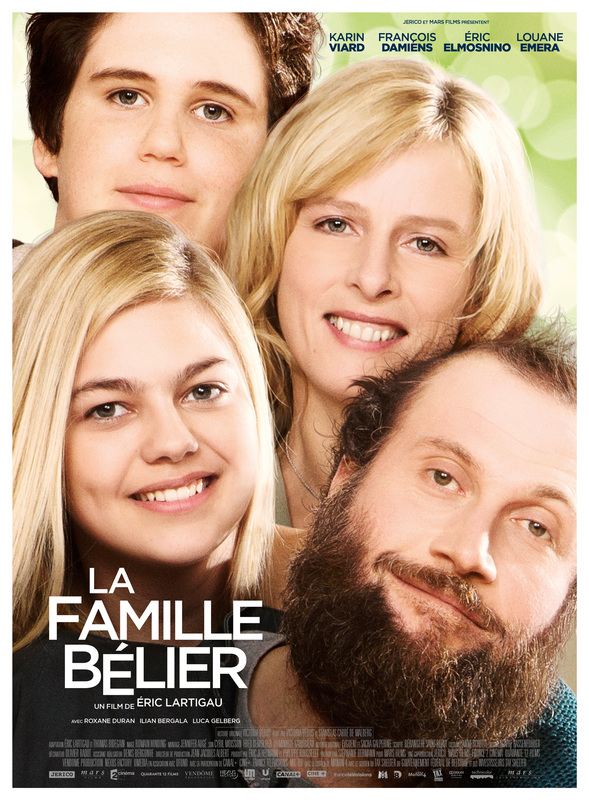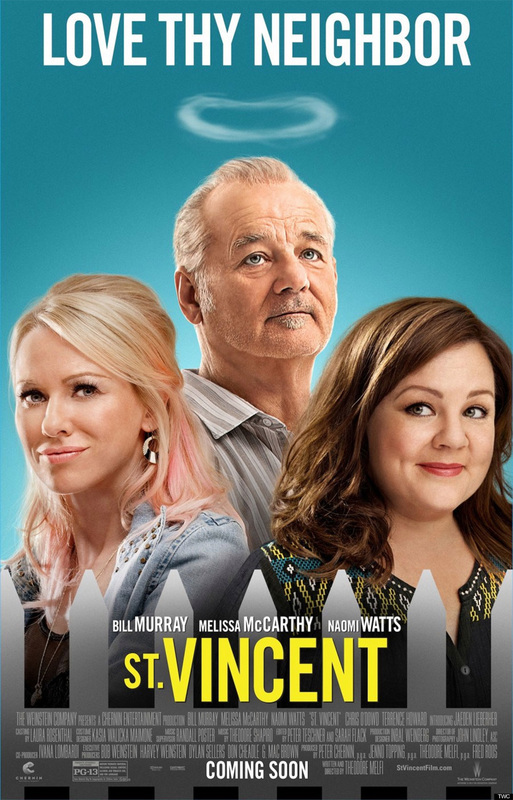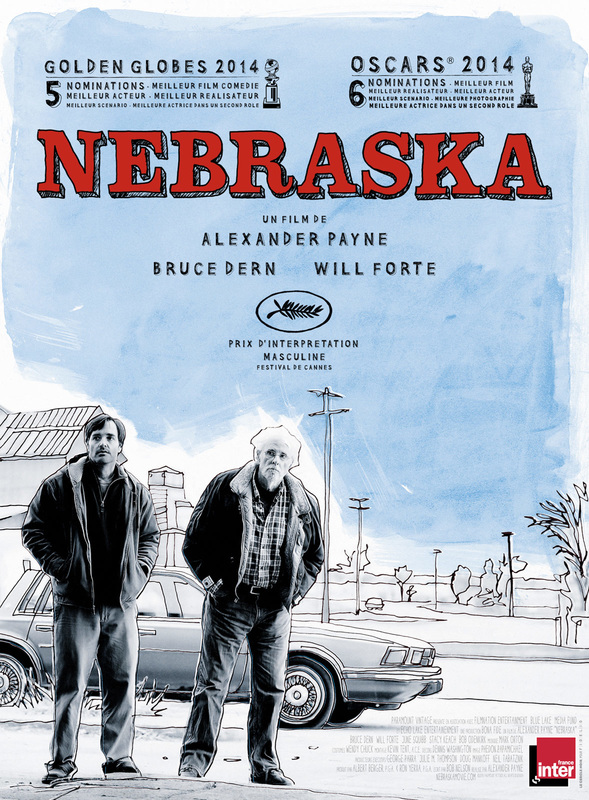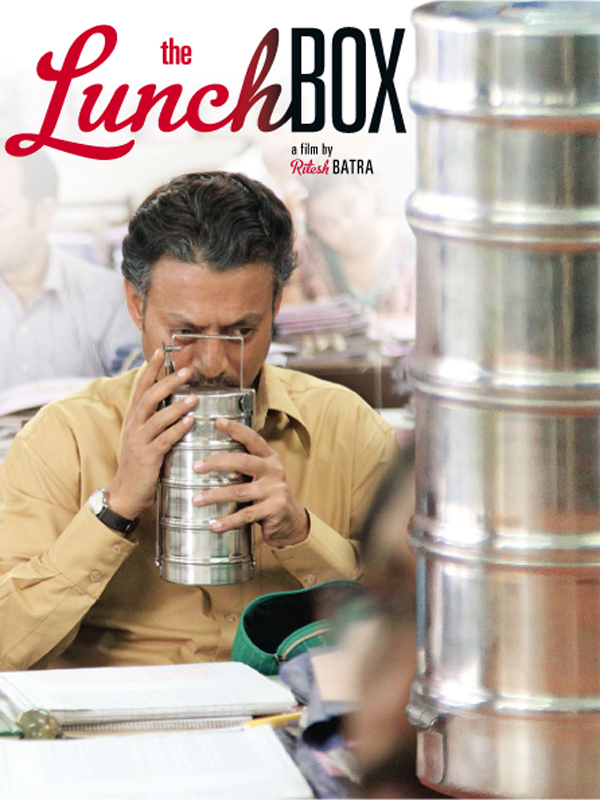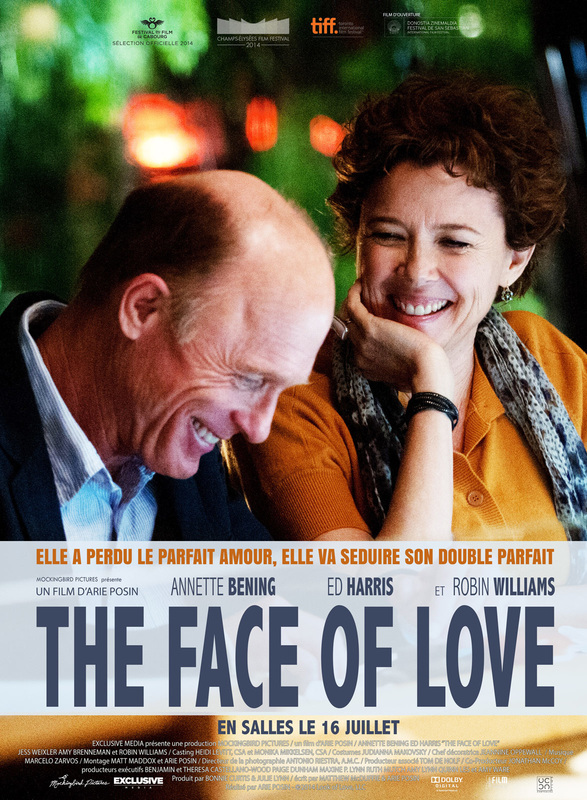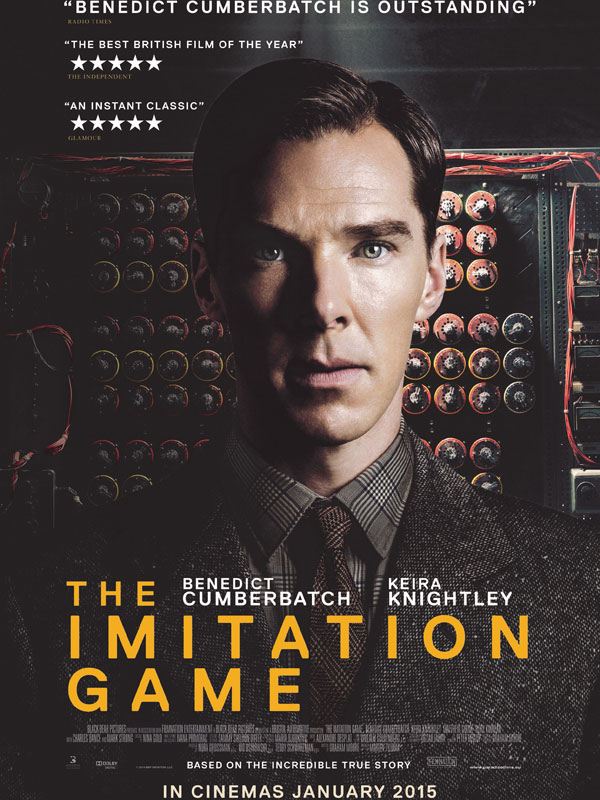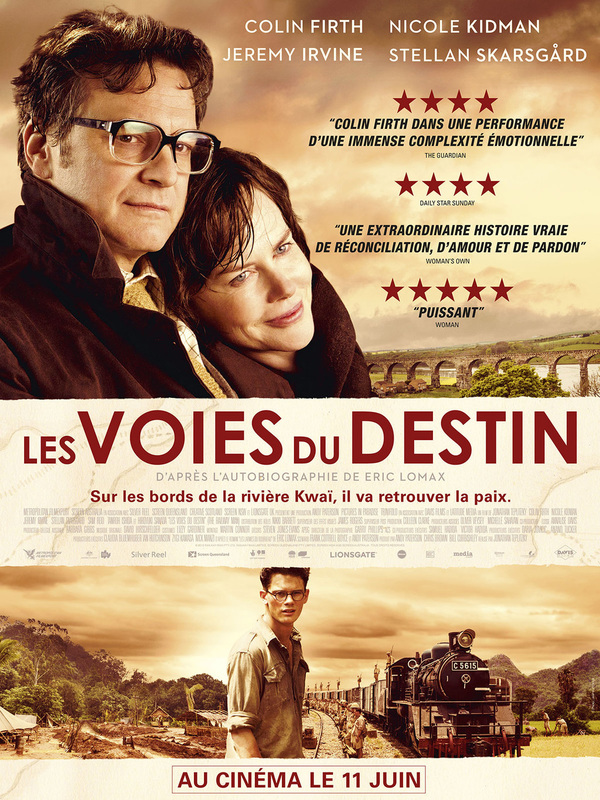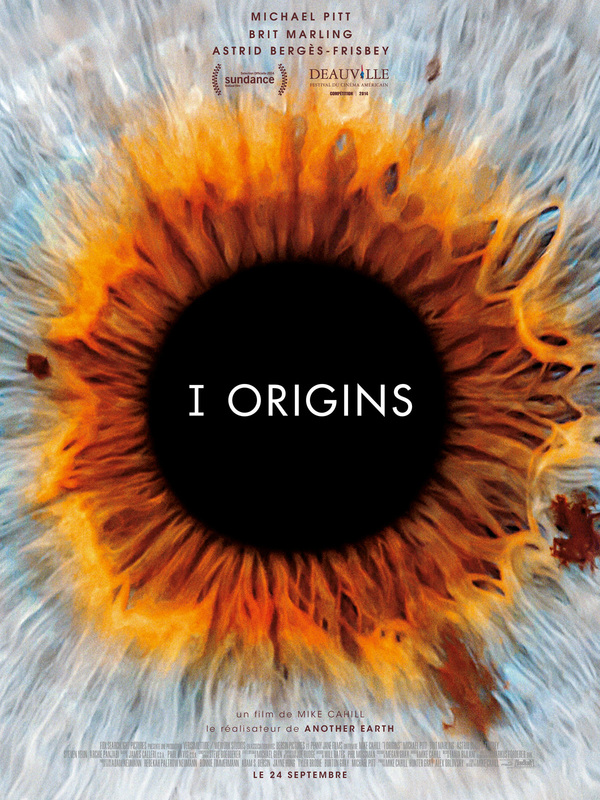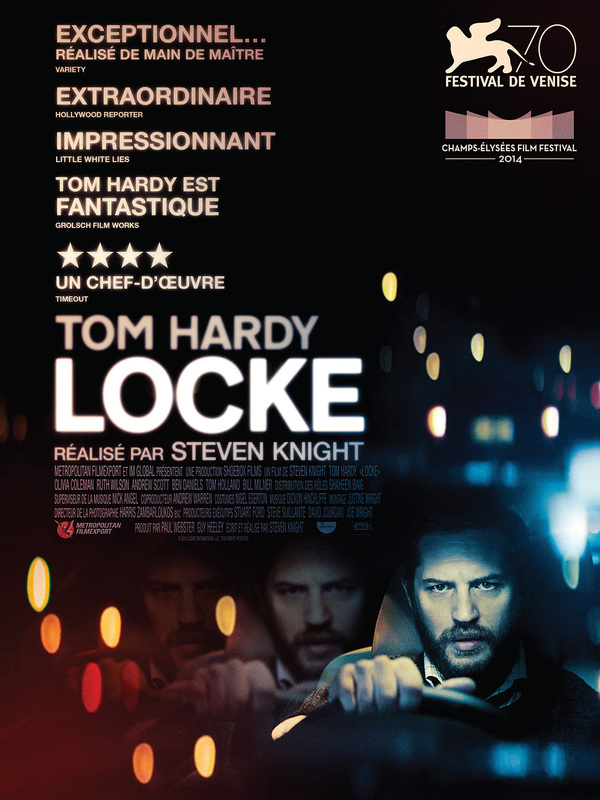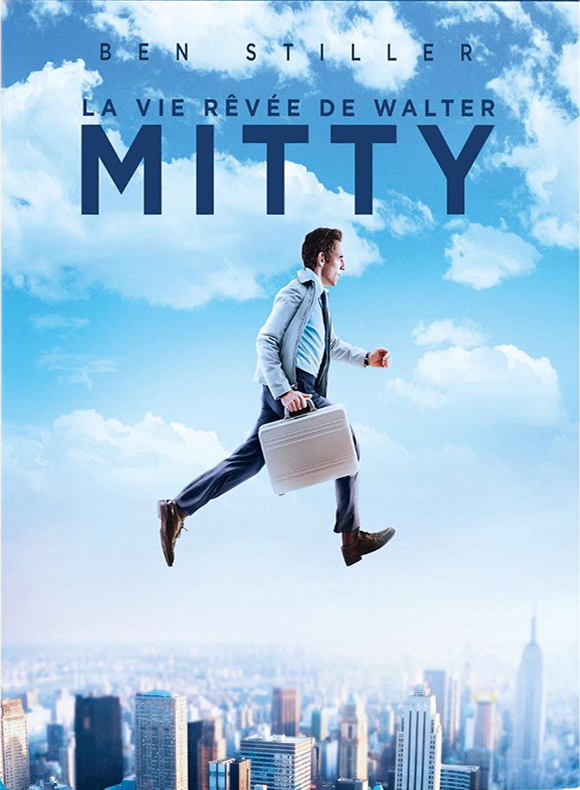Suite à un programme d’échange en Allemagne lorsqu’il était jeune, le réalisateur assista au discours d’Adolf Hitler et fut fasciné par cet homme qui promettait de redresser l’Allemagne en proie à l’extrême pauvreté et aux sentiments conjugués de culpabilité et de haine. Bien sûr, quelques années plus tard, le réalisateur fut horrifié de découvrir l’univers concentrationnaire et le génocide perpétré par les nazis et la conduite de cet homme qui promettait monts et merveilles. De cette expérience, il en tira la sève pour réaliser "L’Œuf du serpent" où l’on retrouve ce malaise palpable d’une société malade. Dès les premières minutes du film nous sommes embarqués dans une petite histoire, métaphore de la Grande. Le personnage principal, un juif américain interprété par David Carradine assiste impuissant à la transformation de la société. D’un drame familial, une toile sociétale sombre se construit trait après trait pour devenir de plus en plus monstrueuse à mesure que le film avance. Aux côtés de l’acteur, Liv Ullmann est parfaite dans le rôle de sa belle sœur. Elle incarne l’innocence, la naïveté et la bonté dans un monde qui broie tout et tout le monde. Les yeux azurés de l’actrice sont terriblement expressifs et foudroient le spectateur d’une mélancolie désespérante. Travaillant dans un cabaret de seconde zone, son personnage est impacté par la pauvreté qui gagne rapidement ceux qui sont en bas de l’échelle sociale, et qui, en plus souffriront de la violence perpétrée par un Etat policier en devenir… Nous pouvons sans mal affirmer que le film est une étude de la société allemande des années 20, avec ses peurs, sa violence, sa misère et ses tourments. La portée du film est beaucoup plus large qu’il n’y parait et il est intéressant de remarquer que le film se termine en 1923 lors du putsch raté d’Adolf Hitler. Alors que les humanistes (dont l’inspecteur de police interprété par l’excellent Gert Fröbe) se réjouissent de ce danger écarté, nul- sauf le héros- ne se rend compte que le vrai danger est à venir et qu’il est simplement en gestation. Ce coup d’Etat manqué participera, lui aussi, a alimenter les braises de la noirceur humaine. Le futur est clair comme l’œuf du serpent : sous la fine membrane, on discerne clairement le reptile déjà parfait. Car si le film tient sans mal le spectateur en haleine grâce à cette ambiance poisseuse et anxiogène, le climax de la fin du film est tellement monstrueux dans sa symbolique et sa violence cachée (et aussi apparente), qu’il inquiète les spectateurs pourtant parfaitement conscients de l’avenir inquiétant. Et toute la force de ce film est de nous montrer que cette « petite » histoire racontée, n’est que les prémisses de ce que sera la Grande Histoire avec son florilège de monstruosités. Et pire encore, que celle-ci nous apparait étrangement moderne… Comme si les monstres d’hier, les précurseurs du Mal n’appartiennent à aucune époque tant qu’existent et se transmettent leurs idées…Glaçant et nécessaire.
► Bonus Inédits, ceux-ci sont proposés en HD pour notre plus grand plaisir tant ils sont fascinants ! On commence avec l’interview de Bernard Eisenschitz, historien du cinéma et spécialiste du réalisateur. Il revient bien sûr sur la genèse du film mais aussi sur la pace de film parmi les autres.
0 Commentaires
Démarrant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le film montre aussi une amitié belle et sincère qui dure le temps d’une incarcération de pratiquement vingt ans. Si ce portrait carcéral est aussi marquant, c’est parce qu’il délivre de beaux portraits humains éloigné de cynisme, de racisme ou même de considérations sociales. Le réalisateur donne à voir des humains qui nous touchent de par leur humanité. Et dans ces rôles, difficile de ne pas être admiratifs des jeux conjugués de Tim Robbins et de Morgan Freeman parfaits en tous points. Leurs protagonistes, tous deux condamnés très lourdement nous émeuvent autant qu’ils nous fascinent. Car après de si longues années passées en prison, la peur d’en sortir se fait aussi ressentir, cette « institutionnalisation » écrasante provenant de la prison même est aussi au cœur des enjeux d’une l’intrigue finement écrite. Les seconds rôles tirent aussi leurs épingles du jeu et nous émeuvent également à de nombreux moments. Comment ne pas aimer profondément le personnage de Brooks (James Whitmore) (Tora ! Tora ! Tora !) ou se prendre de sympathie par celui de Tommy (Gil Bellows) ? Mais si les « gentils » sont parfaitement campés, il en va de même des « méchants » incarnés tellement bien si froidement par Bob Gunton (« 24h chrono ») dans le rôle du directeur, mais aussi Clancy Brown (« Lost », « La caravane de l’étrange », « The Mandalorian »), son fidèle molosse et gardien de prison. Bien qu’assez classique dans sa réalisation, sa narration, son intrigue et le développement de ses personnages font des « Evadés » un chef-d’œuvre intemporel qui ne vieillit pas. Frank Durabont remettra le couvert de l’émotion dans une autre adaptation d’un livre de Stephen King : « La ligne verte ». A croire que l’écrivain lui porte chance ! ► L’image et le son Comme souvent à l’époque, le film a été tourné en 35mm. Mais ici, il revêt son plus bel habit en 4k grâce à une définition poussé et à un HDR qui flatte la rétine ! Jamais la prison de Shawshank n’était apparue aussi froide ! Ses teintes bleutées sont éclatantes et alternent avec des couleurs plus chaudes (la scène du toit). Plus lumineux et coloré que précédemment (l’ancienne version blu-ray), le film améliore sa saturation et son contraste de telle façon que nous avons redécouvert le film ! Du bien beau travail ! Côté son, la version anglaise est en DTS-HD Master Audio 5.1 permet à la voix du narrateur (Morgan Freeman) de se faire pleinement entendre pour nous guider dans la prison ! Bien sûr, la spatialisation n’est pas très présente mais la musique de Thomas Newman peut tout de même envahir nos salons pour notre plus grand plaisir ! La VF n’a pas fait l’objet d’un soin particulier puisqu’elle est présente en stéréo… C’est dommage ! ► Les bonus Alors que le commentaire audio du réalisateur Frank Darabont élargit notre vision du film, nous pouvons compter sur deux très intéressants documentaires intitulés « Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir » mais aussi « Les Evadés : le film rédempteur ».
Publié pour la première fois au début des années 30, ce comic-strip (petites vignettes de BD) fera les beaux jours de la rubrique des célèbres « Chicago Tribune » et « New-York Times ». L’Amérique d’alors, encore fascinée par quelques grandes figures du gangstérisme, à l’image de Bonnie and Clyde, accueillera très favorablement cette nouvelle proposition du chevalier blanc, qui ne rechigne jamais à manier la mitrailleuse contre la pègre. Par la suite, plusieurs films et séries ont été produits. Néanmoins, il faudra attendre les années 70 pour que Warren Beatty, l’acteur à la cote qui monte, remporte les droits pour une nouvelle adaptation. Hélas, la jungle hollywoodienne est telle que les studios défilent sans pour autant mettre le grappin sur la célèbre licence. Heureusement, Disney est là pour rétablir cette trop longue injustice ! Après un impressionnant « tournez-manège » où les acteurs et réalisateurs les plus en vogue défilent (de Spielberg à John Landis pour les réalisateurs ; et de Mel Gibson à Paul Newman, en passant par Robert Redford pour les acteurs), Disney prend les choses en main et confie la réalisation à Warren Beatty qui a, entre temps, revu le scénario. Pourtant, ne s’attendant certainement pas à endosser autant de casquettes, le désormais acteur, réalisateur et scénariste se jette à corps perdu dans ce projet colossal ! Une toile du « pop art » filmée avec talent Passant d’un budget de 25 millions à 48 millions de dollars, Warren Beatty a eu pour seule volonté de rendre un hommage appuyé en réalisant une fresque cinématographique à la beauté renversante ! Car oui, la technique utilisée est un vrai régal pour les yeux et le cinéaste parvient à sublimer le matériau d’origine en poursuivant sa folie artistique ! Il vous suffira simplement de regarder les premières minutes du film avec cette séquence d’introduction magistrale pour vous convaincre, et soit dit en passant, à vous scotcher à votre fauteuil ! On y suit les mains du héros qui prennent ses effets personnels dans son appartement à l’intérieur rouge vif. Puis, la caméra prend de la hauteur pour dévoiler la beauté renversante de cette ville qui semble revêtir ses plus beaux apparats la nuit ! Le film fera le bonheur de toutes les télés modernes tant les couleurs vives sont utilisées. Du rouge flash au bleu aquatique en passant par un vert énigmatique, tous les fans des comics y trouveront leur compte ! L’émotion ressentie par ces nombreux plans visuellement magnifiques est décuplée grâce à la composition d’un Danny Elfman qu’on aurait accusé de plagiat s’il n’avait pas fait lui-même la musique de Batman (quasi identique sur le thème du justicier). La ville de Chicago imaginée par Chester Gould revit grâce à la technique du « Matte painting ». C’est originalité dans la posture artistique confère à l’œuvre une beauté de tous les instants ! C’est bien simple, nous avons l’impression d’évoluer dans une succession de tableaux aux cachets indéniables ! Ce ravissement pour les yeux nous fait dire que Warren Beatty a inscrit, en lettres d’or, il y a plus de trente ans, « Dick Tracy » de plain-pied dans la pop-culture. Un casting comme on n’en verra plus ! Enfin, comment ne pas évoquer l’important travail de maquillage qui permet de rendre hideux les grands acteurs présents au casting ? Méconnaissable, ceux-ci s’en donnent à cœur joie et cela transpire de la pellicule ! Aux côtés de Warren Beatty nous retrouvons avec un réel plaisir : Dick Van Dyke, Madonna, Glenne Headly, Al Pacino, Dustin Hoffman (dans le rôle hilarant du marmoneux !), Kathy Bates, James Caan, et Paul Sorvino. Vous l’aurez compris, le film intrigue autant qu’il subjugue son spectateur ! Et bien que nous ayons trouvé quelques longueurs dans ce film de moins de deux heures- la faute à des intrigues secondaires un peu trop appuyées- nous n’avons pas boudé notre plaisir un seul instant ! Revoir Dick Tracy en 2020 s’est se remémorer la magnifique audace qui existait dans les années 90. C’est aussi, redécouvrir un film malmené et boudé injustement à sa sortie. Enfin, c’est se mettre à voyager dans des tableaux filmés aux couleurs chatoyantes et rencontrer de vrais monstres du Cinéma ! Genre: Action/Humour Durée du film: 1h45 Résumé du film : Dans leur appartement de Baker Street, Holmes et Watson voient arriver une jeune veuve sauvée des eaux de la Tamise. Se nommant Gabrielle Valladon, cette dernière semble amnésique mais va vite retrouver la mémoire. Le fin limier et son équipier vont être entrainés dans une enquête hors du commun, où ils croiseront Mycroft Holmes, le frère de Sherlock, la reine Victoria et le monstre du Loch Ness Avis : Sorti en 1970, « La vie privée de Sherlock Holmes » de Billy Wilder a connu récemment une restauration importante et une nouvelle sortie en DVD/Blu-Ray. Bien moins célèbre que « Le chien des Baskerville » (avec Peter Cushing), cette aventure inédite du fameux détective britannique valait néanmoins la peine qu’on la dépoussière et la représente au grand public. Agrémenté de trois heures de bonus de qualité (dont on vous parle dans le chapitre « les bonus »), le film de Wilder nous entraîne dans l’univers atypique du détective flegmatique d’une bien belle façon. Le grain de l’image est impeccable, la palette de couleurs sobre et parfaitement intégrée, tout concourre à ce que la vision d’un métrage datant d’il y a presque 50 ans soit aussi nette et esthétique que possible et nous fasse oublier combien cette petite pépite aurait pu ternir au fil des années. Alors bien sûr, les décors et l’atmosphère du XVIIIème siècle facilitent très probablement l’immersion dans cet univers d’autrefois mais nous devons saluer le travail de restauration qui a été fait pour que le plaisir cinématographique soit total. Très classique et totalement raccord avec l’univers littéraire de Conan Doyle, « La vie privée de Sherlock Holmes », n’est pourtant pas issu de l’imaginaire du célèbre écrivain. Il n’empêche, cette plongée dans la maison du 221b Baker Street est bluffante et les références multiples. Digne d’une des enquêtes qu’aurait pu vivre Holmes et Watson, cette intrigue policière ne manque pas d’humour et montre combien le duo complice fonctionne aussi bien dans les écrits qu’à l’écran. Interprétés respectivement par Robert Stephens et Colin Blakely, Sherlock et John sont aussi exaspérants qu’attachants. Mais ce ne sont pas les seuls à se démarquer dans des rôles so british : Christopher Lee vient lui aussi prendre part au casting sous les traits de Mycroft, le frère emblématique du détective. Côté féminin, c’est Geneviève Page (« Buffet Froid », de Bertrand Blier ou « Belle de Jour » de Luis Bunuel) qui interprète l’énigmatique Gabrielle Valladon, victime belge venue perturber la tranquillité (et l’inactivité) de notre tandem londonien. Très agréable à suivre, pour ses clins d’œil autant que pour sa remasterisation, « La vie privée de Sherlock Holmes », est très lent (mais n’oublions pas que nous ouvrons une fenêtre sur le cinéma des années 70, aux codes très différents de ceux de maintenant), contemplatif, drôle et brillant. Un petit délice qui se déguste tel un cheese cake à l’heure du goûter. ► Les bonus Après une courte présentation d’Eddy Mitchell pour « La dernière séance », les amateurs de l’univers de Billy Wilder et de Sherlock Holmes se délecteront de près de 3 heures de bonus inédits et on ne peut plus intéressants. Bien sûr, il y a une fin alternative très courte, qui laisse supposer que Sherlock vivra d’autres aventures aussi sombres prochainement mais les vrais contenus additionnels copieux n’apparaissent qu’après ces deux belles petites mises en bouche.
La parole est également donnée à Jérôme Wybon et Ernest Walter qui évoqueront comment la comédie musicale avortée de Wilder est devenue le film que l’on découvre aujourd’hui. De la graine créatrice au développement du projet en passant par le tournage du film, cette autre petite heure de confidences apporte sa petite pierre à l’édifice des bonus de « La vie privée de Sherlock Holmes ». Enfin, le documentaire « Making of » sur Billy Wilder, constitue sans conteste le contenu additionnel le plus intéressant de tous. D’une cinquantaine de minutes, le reportage allemand évoque le travail du réalisateur, sa carrière, les coulisses du film et tout ce qui a été mis en œuvre pour que le résultat se rapproche au plus près de la vision de son créateur. Indispensable à tous les amateurs de l’univers de Conan Doyle adapté au cinéma, « La vie privé de Sherlock Holmes » est assurément une redécouverte que beaucoup prendront plaisir à déballer et à savourer. Durée du film : 2h05 Genre : Policier Bonus : 3h, sur un DVD à part, parmi lesquels un documentaire, des entretiens et des scènes coupées. Titre original : « The Private Life of Sherlock Holmes » Résumé du film : 1974, Buenos Aires. Benjamin Esposito enquête sur le meurtre violent d'une jeune femme. 25 ans plus tard, il décide d'écrire un roman basé sur cette affaire "classée" dont il a été témoin et protagoniste. Ce travail d'écriture le ramène à ce meurtre qui l'obsède depuis tant d'années mais également à l'amour qu'il portait alors à sa collègue de travail. Benjamin replonge ainsi dans cette période sombre de l'Argentine où l'ambiance était étouffante et les apparences trompeuses... Avis : Très justement récompensé en 2010 par l’Oscar du Meilleur Film Etranger, « Dans ses yeux » a également remporté le Goya du meilleur film hispano-américain tandis que Soledad Villamil, l'actrice principale, a reçu le prix du Meilleur Espoir Féminin. Véritable coup de cœur cinématographique, ce film est en réalité l’adaptation magistrale du roman "La Pregunta de sus ojos", de l'auteur argentin Eduardo Sacheri. D’ailleurs, l'écrivain a travaillé en étroite collaboration avec le réalisateur Juan José Campanella pour nous livrer cette enquête policière/thriller teintée de romance et de non-dits. Indispensable pour que la magie opère, la bonne entente entre les comédiens ne doit pas être feinte. Ici, nous sentons toute la bienveillance qui existe entre eux. Il n’est donc pas étonnant de constater qu’il s’agit de la deuxième collaboration entre le réalisateur et ses comédiens : la talentueuse et très belle Soledad Villamil et l’époustouflant Ricardo Darin. Comment justifier que ce film entre dans nos petites pépites ? A cette question, les éléments de réponse qui viennent à notre esprit sont nombreux. Pourtant, nous allons essayer de trouver les mots pour vous exprimer tout le bien qu’on en pense. Tout d’abord le genre ; s’agit-il d’une enquête policière ou d’un film d’amour prenant des airs de « Roméo et Juliette » ? Probablement un peu des deux. Elle (Soledad Villamil) est belle, issue d’une riche et bonne famille, intouchable. Lui est simple et ne peut compter que sur lui-même. Pourtant, ils s’aiment en secret mais ne se le disent pas. Comme si le fossé de leurs différences était plus grand que l’amour qui les guide l’un à l’autre. En filigrane nous percevons mieux le sens du titre : « Dans ses yeux ». Tout l’amour passe par leurs yeux. C’est comme si le film racontait deux histoires. La première, avec des dialogues, la seconde, avec les regards. Pour capter ces instants de non-dits, la caméra parviendra à épouser les émotions, les personnages dans leurs failles, leur lâcheté. Et comme le film n’est pas uniquement une romance mais flirte du côté du thriller et du film policier, l’objectif dynamise les scènes d’action et brillera par sa nervosité, puis son calme retrouvé. Si cette œuvre nous plait tellement, c’est aussi parce qu’elle est loin d’être manichéenne et que ses thématiques sont universelles : la quête de vérité tient une place centrale, tout comme la vengeance et la justice des Hommes (ne serait-ce pas aussi parfois de l’injustice ?) constitueront le fond de cette toile de maitre. Au risque de nous répéter, l’Amour, animera nos deux protagonistes et posera ces questions cruciales : « comment vivre une vie vide » ? « Comment vivre si l’être aimé ne colore pas ma vie » ? Ce film nous enseigne que regarder derrière est la seule façon d’avancer mais au final la blessure peut de nouveau saigner. On ne peut que guérir pour aller de l’avant. Les influences de Juan José Campanella sont multiples. On peut citer le cinéma italien pour les quelques fulgurances de comédie et surtout les films américains des années 70 dans la façon de filmer l’ensemble avec cette minutie du découpage. Aussi, la réalisation se veut léchée et le montage brillant. Tel un funambule, le réalisateur parviendra à établir un équilibre parfait entre drame, romance, pointe d’humour et suspense. « Dans ses yeux » se veut divertissant dans le bon sens du terme et se montrera fluide en passant de façon constante entre les deux époques. L’époque actuelle et celle des années 70, et ce, sans jamais perdre le spectateur en chemin. Enfin, les acteurs ont été formidablement castés et tout semble passer par leurs yeux. Nous ne pouvons taire l’interprétation magistrale de Guillermo Francella qui joue le collègue du héros. Terriblement touchant, il apportera beaucoup au film. En définitive, cette œuvre dévaste tout sur son passage. Tellement riche, elle a l’intelligence de mêler le thriller à la romance sur fond d’enjeux profondément humains et donc déchirants. La scène finale restera gravée durablement dans l’esprit du spectateur, qui sera happé par le récit et heureux d’avoir pu prendre part à cette grande histoire. Le réalisateur aime ses comédiens et cela transpire à l’écran. Tel un artificier, il met en lumière les failles de ses personnages, leurs douleurs, leurs hésitations, leur courage. On songe à ces pépites du cinéma américain et italien d’antan où la psychologie des personnages et leur construction belle et fragile sont au service d’une œuvre qui semble les dépasser. Durée du film : 2h 09min Genre : Drame Titre original : El Secreto de Sus Ojos Résumé du film : Depuis son plus jeune âge, Eddie Edwards n’a qu’un projet : participer aux Jeux Olympiques. Le petit garçon, qui n’a rien d’un athlète, poursuit son rêve coûte que coûte et au péril de sa santé. Aussi, après des années d’entraînement improductif, Eddie entrevoit la possibilité de s’inscrire aux JO d’hiver de Calgary dans la catégorie saut à ski. En effet, aucun sportif britannique n’a jamais concouru dans cette discipline, pourquoi ne pas tenter de représenter son pays dans ce sport risqué ? Parti s’entraîner en Allemagne, notre skieur en herbe croise la route d’un entraîneur « has been » et tous deux se lancent dans un incroyable défi : participer aux Jeux Olympiques d’hiver de 1988 ! Avis : Tous ceux qui ont croisé notre route ces dernières semaines savent combien nous avons adoré « Eddie the Eagle ». Sorti le 30 mars en « stomeling » dans les salles belges, le dernier film de Dexter Fletcher nous avait touché en plein cœur. Son succès dans les complexes français en mai dernier a démontré combien un film inattendu pouvait ravir et unir critiques et spectateurs. Retour sur l’histoire incroyable mais vraie de Michael Edwards, un athlète britannique peu conventionnel… Avec « Eddie the Eagle », vous vous préparez à entrer dans l’histoire vraie et désopilante de Michael Edwards. En effet, cette biographique aux airs de comédie nous démontre combien il vaut mieux vivre de remords que de regrets … Eddie l’Aigle n’avait aucune prédisposition pour devenir un sportif de renom et pourtant ! A force de ténacité, de persévérance et de courage, le britannique a su faire de son rêve une réalité. Et ce rêve, Dexter Fletcher le met en scène de façon remarquable ! En plus d’être un bon film, son dernier long métrage est aussi un très, très beau film ! Alors qu’il ne signe que sa deuxième réalisation (la première étant « Sunshine on Leith »), l’acteur londonien a su nous cueillir du début à la fin et nous raconter l’histoire méconnue de cet athlète médiatisé il y a une trentaine d’années. Et pour cause, avec sa bande originale magistrale, sa photographie travaillée et sa reconstitution génialissime, le réalisateur nous plonge en quelques secondes dans les années 1972 et nous fait ressortir 16 ans plus tard tout émerveillés. A aucun moment nous ne décrochons du biopic le plus touchant que nous ayons vu ces dernières années. Prenant de la première jusqu’à la dernière minute, on retient son souffle, on ne peut contenir sa joie, son stress, son désespoir et ses rêves : on est secoué, remué tout comme l’est le héros du film. Bref, on y croit et on sent son cœur battre : Dieu ce que c’est bon ! Rempli d’émotions, le film nous rappelle quelque peu « Shine » de Scott Hicks. Abordant un thème radicalement différent, les deux long métrages ont cependant de nombreux points communs : la persévérance à toucher son rêve du doigt malgré les nombreux découragements, des personnages atypiques et hors norme en qui peu de personnes croient, un manque d’encouragement de la part du père… tout est là ! Pour peu que l’on accepte de se livrer aux émotions des protagonistes, nous sommes emportés dans les tourments de la vie et dans un fol espoir de réussite. Au centre du film, Eddie Edwards, bien évidemment. Interprété par un Taron Egerton totalement investi et métamorphosé, le personnage ne fait que gagner en intensité. Grâce à ce rôle, l’acteur britannique (vu dans « Kingsman : services secrets ») montre l’étendue de son talent et fait preuve d’une véritable prouesse d’interprétation ! Les tics, les attitudes, les maladresses d’Eddie sont siennes. Le travail de préparation au rôle a dû être conséquent et le résultat est éloquent ! Sans doute grâce à l’excellente complicité entretenue avec Hugh Jackman qui se fond un registre dans lequel on l’adore ! A l’extrême opposé du jeune sportif, Bronson Peary, se verra confier une mission à laquelle il n’a jamais songé : le coacher. Sombre, rempli de démons, l’entraîneur improvisé devra retrousser ses manches et croire en quelqu’un d’autre, plus qu’en lui-même. Les deux acteurs font jeu égal et se donnent la réplique avec beaucoup de contenance. Les faire rencontrer était une idée de génie et le résultat est plus que convaincant ! Avec son casting efficace et impeccable, sa belle leçon de courage et ses nombreuses surprises, « Eddie the Eagle » est un incontournable de 2016 ! Nous ne saurons trop vous conseiller de vous laisser emporter par cette histoire incroyable qui vous laissera quelques souvenirs impérissables ! Durée du film : 1h45 Genre : Biopic « Amy », comme son nom et son affiche l’indiquent, raconte la vie d’Amy Winehouse. Si on connaît tous les succès de la chanteuse britannique, on ne sait pas toujours qu’ils sont la retranscription de sa vie, ses états d’âmes et des épreuves qu’elle a traversées durant sa courte carrière. Derrière sa voix incroyable et son talent indéniable se cache une histoire sombre qui a terni une star incontestée partie trop tôt. Sortie DVD/Blu-ray en décembre dernier, « Amy » a beaucoup fait parler de lui, notamment lors des diverses cérémonies consacrées au cinéma où il s’est vu récompensé une dizaine de fois par de nombreux prix parmi lesquels l’Oscar et le BAFTA du meilleur documentaire. Et on comprend à présent pourquoi car en plus d’être un documentaire instructif, c’est une ode au talent de la jeune chanteuse et un bel hommage à tous ceux qui l’on entourée des années durant que ce long-métrage nous présente. Qu’ils soient anonymes ou célèbres, nombreux sont les témoins qui se relaient pour nous conter la vie d’Amy Winehouse en toute franchise. Ainsi, ses amis, sa famille, sa meilleure amie Juliette, son manager (Nick Shymansky), son producteur (Salaam Remi), quelques vedettes l’ayant croisé (Pete Doherty, Mark Ronson, Tony Bennett), Blake Fieldern (son ex-mari) tous (ou presque) prennent la parole et nous confient les souvenirs qui les lient à la chanteuse. Présentés de façon linéaire, ces anecdotes nous permettent de mieux vivre son ascension vers le succès et sa chute vers les enfers. Ambitieuse et talentueuse, Amy Whinehouse n’a pas 18 ans lorsqu’elle entre de plein pieds dans le monde de la musique, passant de clubs en bars pour chanter ce jazz qu’elle aime tant. Entourés de ses amis, elle sillonne les routes à la recherche d’une maison de disques prête à lui accorder sa chance. Et c’est en 2003 que la chance tournera et que son premier album « Frank » naîtra. Le succès est au rendez-vous, elle s’achète un loft et le partage avec sa meilleure amie avant d’entamer une tournée et de connaître un petit succès auprès des amateurs de jazz. Lorsqu’elle quitte sa colocation pour s’installer à Camben, Amy est bien décidée à écrire un nouvel album mais c’est l’angoisse de la page blanche qui la guette. Logée dans un quartier festif, c’est ici que les choses commencent à déraper. Elle rencontre Blake Fielder dans un club et vit une histoire d’amour intense… mais comme toutes les passions, la flamme peut brûler fort mais finit toujours par se consumer. Amy sombre dans une grave dépression après sa rupture avec Blake, et manque de peu d’entrer en désintoxication à Black Park où son ami Nick l’a emmenée. Son père s’y oppose pensant qu’elle va bien et voilà Amy au plein cœur de Londres, en proie à de nouveaux démons. Cette histoire, elle l’a raconte dans son succès international « Rehab ». Ecrire, chanter, c’est un moyen de purger sa peine. Et elle le fait également dans l’excellent « Back to black », où elle nous raconte sa douleur liée à sa récente rupture. Elle ouvre son cœur, confie sa détresse… l’album cartonne et le succès est fulgurant. Comme si sa vie n’était pas déjà assez morose, la mort de sa grand-mère (dont elle était si proche) en 2006, l’a fait mourir elle-même de l’intérieur et elle replonge dans ses démons de l’alcoolisme et de la boulimie. Bien entourée, tout le monde tente de l’aider et Amy se remet peu à peu sur pieds. Après le succès de son deuxième album, Blake revient. Ils s’aiment et se marient à Miami durant la tournée américaine d’Amy. De retour des USA, le couple découvre les effets enivrants du crack et de l’héroïne au point d’en être devenus totalement accros. En 2007, fatiguée et ravagée par la drogue, Amy fait une overdose et doit annuler sa tournée. Sauvée de justesse, elle passe par une période trouble avant de trouver le repos à Sainte Lucie où elle se rétablit et poursuit sa carrière loin de tout stress et de Blake, incarcéré. Encadrée par son garde du corps, elle voit les beaux jours venir et chante en duo avec son idole Tony Bennett avant de reprendre la route des festivals. Mais dans ses bagages, Amy emmène avec elle les mauvaises habitudes et replonge dans l’alcool jusqu’au 23 juillet 2011, date tristement célèbre puisqu’elle marque la fin de la vie de cette jeune femme qui n’a pas su se sauver. Bien sûr, son histoire, ses addictions, nous les reconnaissions dans les grandes lignes. « Amy » est un très joli film où vidéo personnelles, témoignages, extraits télévisés, d’interviews télé ou radio s’entremêlent pour nous offrir une biographie de qualité. Ici, tout est vrai, authentique, à l’image de la star qui en est le sujet central. La réalisation, impeccable, est signée Asif Kapadia. Le metteur en scène britannique a déjà consacré un film à Ayrton Senna (dans « Senna » sorti en 2010), mais a aussi réalisé de longs métrages tels que « The warrior » ou « The return ». Ce qui est appréciable ici, c’est qu’il nous propose un documentaire de choix sans jamais nous mettre dans l’inconfort d’un voyeurisme mal placé. Les images d’archives et les interviews ne sont là que pour nous raconter l’histoire de la célèbre chanteuse, en toute transparence. Les traductions de ses textes viennent compléter les confidences de ses amis et constituent des témoignages précieux livrés à jamais à tous ceux qui veulent les entendre. En définitive, « Amy » est un très joli documentaire que nous ne pouvons que vous conseiller de voir et d’entendre. Durée du film : 2h07 Genre : Documentaire Résumé du film : Dans un monde mythologique proche de la Terre, le Soleil est accroché à un temple mobile et la lune a un animal mi-girafe, mi-chameau. Tous deux sont fragiles, petits et conduits par des gardiens qui chaque jour, réalisent le même chemin pour instaurer un équilibre entre le jour et la nuit. Mais les gardiens se font vieux et il est à présent temps de désigner des successeurs dignes de cette lourde tâche… Mune et Sohone sont choisis pour prendre la relève et ce sera bien moins évident qu’il n’y paraît. Avis : Esthétiquement, le film est impeccable et plaira sans doute aux adultes, amateurs de film d’animation bien que son premier public reste sans conteste les enfants ! Mais attention, le long-métrage présentant quelques images impressionnantes, il vaudra mieux le regarder avec des enfants de plus de 7 ans au risque de voir les plus jeunes pleurer et se réfugier dans les bras de papa ou maman dès l’apparition de Nekross, le grand vilain méchant de l’histoire. Dans ce monde fictif, la lune et le Soleil ont été créés par les premiers gardiens. Celui du soleil, a lancé une chaîne tel un lasso pour garder l’astre près de sa planète, la réchauffant et l’éclairant une bonne partie du jour. Celui de la lune est descendu dans un monde de rêves, pour sculpter sa propre lune et l’a faite monter dans le ciel après l’avoir accrochée à un fil d’araignée. Mais si créer un astre semble simple, le garder et le confier à une génération suivante est moins évidente. D’autant plus que la survie des peuples du jour et de la nuit dépend de l’harmonie entre les deux gardiens qui, très différents les uns des autres, ont un rôle important à jouer dans le maintien de cet équilibre. Les nouveaux gardiens investis dans cette tâche sont malheureusement peu formés et peu préoccupés par leur mission. Mune est un personnage maladroit, désigné par erreur et Sohone, un dragueur fier et intéressé par les filles de sa région. Mais lorsque Nekross, ancien gardien du Soleil, veut s’approprier son astre et s’accaparer la lune, nous sommes à deux doigts de voir un chaos se créer à la surface de la Terre et l’obscurité totale qui en découlerait risquerait de faire périr faune et flore du jour et de la nuit… Nos deux nouveaux héros n’ont qu’une solution : s’investir profondément pour récupérer ce qui leur a été dérobé et s’unir, malgré leurs différences, pour que le jour comme la nuit reprennent leur place. Heureusement, Mune et Sohone vont pouvoir compter sur l’amitié de Cire (qui ne peut pas trop s’approcher du Soleil ou des sources chaudes au risque de fondre et disparaître), une aide précieuse dans leur longue quête. Rempli de poésie, le film est à la fois touchant, instructif et ponctué de jolies valeurs : l’amitié, le courage, le dépassement de soi, le soutien inconditionnel, etc. Le scénariste Benoît Philippon et Alexandre Heboyan, (qui a déjà travaillé sur « Kung Fu Panda », tous deux relativement méconnus dans le monde du 7ème art, réalisent un premier film d’animation original et incroyable. Magnifique visuellement, il place la mythologie au cœur d’une histoire d’aventure qui saura emporter petits et grands. Les décors sont sublimes, les musiques de l’excellent Bruno Coulais (on vous parlait de son travail récemment encore grâce au film « Les saisons ») sont adaptées à chaque situation, l’humour intelligent, les répliques travaillées,… rien n’a été laissé au hasard ! Pour preuve, ce changement d’univers graphique, passant de la 3D à la 2D (lorsqu’on s’immerge dans l’univers des rêves) qui fondent l’un sur l’autre avec subtilité. Et que dire de l’interprétation de nos doubleurs de choix, un trio célèbre qu’on prend plaisir à redécouvrir: Michael Gregorio (Mune) qui garde sa propre voix et n’offre pas le panel d’imitations qu’on lui reconnaît, Izïa Higelin (Cire) et Omar Sy (Sohone) donnent vie à leur personnage avec beaucoup de talent. Ce conte moderne a vraiment tout pour plaire : il démontre que Pixar est loin d’avoir le monopole en matière de films d’animation et que les Européens ont de belles idées qui, une fois germées, laissent place à des films poétiques, maîtrisés et superbement réalisés. C’est pour toutes ces raisons que « Mune, le gardien de la lune » figure dans nos petites pépites de l’année. Durée du film : 1h26 Genre : Film d’animation Résumé du film : Juan Robles et Pedro Suárez, deux policiers de Madrid sont envoyés dans la région du Guadalquivir afin d’enquêter sur la disparition de deux adolescentes. Dès le début de leur enquête, ils se rendent compte qu’une série de disparitions semble avoir eu lieu dans cette petite communauté andalouse. Lorsqu’ils découvrent les corps des jeunes filles, nos deux policiers se lancent aux trousses d’un tueur au sang froid. Mais rien ne facilitera leur enquête : les secrets, les non-dits, le silence des habitants les empêcheront de percer le mystère à jour. Malgré leurs caractères et leurs méthodes radicalement opposées, nos deux enquêteurs s’associent pour retrouver le responsable de ces meurtres sauvages. Avis : Sorti cet été après avoir été présenté dans de nombreux festivals, « La isla minima » a été récompensé de nombreuses fois. Lors de la 29ème cérémonie des Goyas, il a remporté 10 prix dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur ou encore du meilleur acteur pour Javier Gutiérrez. Encensé dans certaines compétitions cinématographiques espagnoles et françaises, on se devait de se pencher sur ce phénomène qui a beaucoup fait parler de lui lors de sa sortie. Et nous ne regrettons pas de l’avoir fait. Tout d’abord, parce que l’époque des années 80 durant laquelle se déroulent les faits est très bien représentée. Perdu au milieu de nulle part, le petit village où se déroulent les faits semble figé dans le temps. Les images proposées, la lumière, les couleurs sont sublimes et nous transportent dans un ailleurs et un autre temps avec beaucoup d’attachement. Ensuite, parce que les thrillers étrangers ont la cote dans notre paysage cinématographique. Après le tandem norvégien du « Département V », c’est un duo espagnol que l’on suivra dans l’enquête de la « Isla Minima » et il n’y a pas à dire, les réalisateurs étrangers savent y faire ! Bien loin de tous les clichés dont ils sont parfois affublés, les films du genre parviennent encore à nous cueillir et à nous surprendre et celui-ci en fait partie. Preuve qu’il ne faut pas être estampillé « made in USA » ou être dirigé par un cinéaste de renommée pour proposer au public une intrigue et une réalisation de qualité. D’ailleurs, là où il fait fort, c’est que le réalisateur laisse peu de place à l’histoire personnelle des deux protagonistes. Si l’on décèle leurs failles et que l’on leur caractère, le reste a peu d’importance. Et ce n’est que tant mieux car cela nous permet de rester focalisé sur l’enquête sans nous perdre outre mesure. Pas de blabla à rallonge, pas d’introspection inutile, on mène l’enquête et on tâche d’avancer malgré les difficultés. En parlant de réalisateur, il s’agit ici de Alberto Rodriguez qui est d’ailleurs loin d’être un novice puisqu’il a déjà scénarisé et mis en scène cinq autre longs-métrages tels que « Le costard » ou « Les 7 vierges ». Si son nom ne nous dit probablement rien, il marquera notre esprit et nous incitera même à nous plonger dans ses autres long-métrages. Invitation que l’on vous fait à notre tour. Bien plus qu’un film policier, « la Isla minima » présente aussi une Espagne post-franquiste qui peine à mettre en place une démocratie stable après avoir connu le fascisme de Franco. Alberto Rodriguez a d’ailleurs eu l’intelligence de marquer cette opposition à travers ses personnages principaux. Il dira de ses héros que "Le premier est mû par la peur de mourir, le second par une ambition dévorante. Pour autant, il n’y a selon moi, ni “ gentil ”, ni “ méchant “ dans cette histoire. L’un n’est pas tout noir et ni l’autre tout blanc, ce serait trop simple. Pour autant, la question que soulève le film est frontale : notre jeune flic, en essayant de passer l’éponge sur les casseroles de son vieux collègue fait-il le bon choix ? Quel avenir pour nous, pour l’idée de justice ? Le compromis est-il la solution ? Et à quel prix ?" En tête du casting, Javier Gutiérrez (Juan Robles dans le film) et Raúl Arévalo (pour assurer le rôle de Pedro Suárez), deux comédiens espagnols confirmés mais inconnus chez nous. Etonnant car leur charisme, leur jeu et leur visage typé se mettent au service du film film avec génie : ils méritent vraiment d’être reconnu au-delà des frontières et espérons recroiser leur route dans d’autres films mieux distribués. L’enquête est lente, on tourne en rond à l’image de ce qui pourrait se produire dans la vie réelle. Ici, aucun effet d’accélération, aucun moyen démesuré pour servir l’enquête : on fait avec les moyens de l’époque et on tente de mettre en lumière toute la vérité, aussi dure soit-elle. Pour accentuer cette dureté des faits, des décors arides du Sud de l’Espagne, que nous trouvions déjà sublimes, à perte de vue. Tout est (bien) pensé et si certaines scènes peuvent choquer un public non averti, nous n’avons pas grand-chose à regretter dans ce film… peut-être la discrétion de sa sorti en salles et en DVD en décembre dernier ? « La isla minima » est véritablement un bon film et vaut la peine que l’on s’y intéresse ! Durée du film : 1h45 Genre : Thriller Résumé du film : « Human » est un ensemble de témoignages d’habitants des quatre coins de notre Terre. Entrecoupés d’images de notre planète, le documentaire laisse la parole à des anonymes comme à des personnalités célèbres. Evoquant des thèmes multiples comme la vie, la guerre, l’immigration ou le quotidien, il met en lumière la perception des choses selon l’endroit où l’on a grandit. Très jolie leçon de vie, « Human » est une valeur sûre qui éveillera les adultes comme les adolescents. Avis : Le documentaire de Yann Arthus-Bertrand a connu un joli succès lors de sa diffusion télévisée. Disponible en DVD depuis octobre dernier (à prix très démocratique !), il fait véritablement partie des films qu’il faut visionner et montrer. Tant pour le sujet qu’il évoque que pour sa réalisation… En effet, Yann Arthus-Bertrand nous plonge dans le regard de représentants des peuples du monde et leur donne une libre parole sur des sujets divers et variés. Il délaisse véritablement ses images de la Terre vue du ciel pour rencontrer des Hommes de tous horizons et présente leur témoignage en toute humilité. Mais il nous offre aussi de jolies vues de notre planète depuis les cieux, comme celle de la caravane en plein désert, des lignes de militaires ou des espaces que l’on découvre depuis les airs. S’il a changé de sujet de prédilection, il continue malgré tout à garder sa patte et à nous montrer notre belle Terre. Pour parvenir à créer un tel documentaire, il aura fallu trois ans au réalisateur pour effectuer son travail. Avec son équipe, il a interviewé plus de 2000 personnes, dans 65 pays différents. Il a sélectionné une centaine d’entre elles pour nous les offrir dans un esprit d’authenticité et de sincérité. Bouleversants, intéressants, attendrissants, étonnants, les témoignages se succèdent sans que l’on ne se lasse. Le défi difficile de garder les spectateurs attentifs est largement relevé. Car le réalisateur français n’a pas fait dans la demi-mesure. Comme pour « Home », le film est sorti dans 60 pays et en 63 langues. Il existe aussi plusieurs versions de son documentaire : la version longue pour le cinéma dure 3 heures 8 minutes, une version en trois parties est disponible sur Internet, et une version raccourcie a été diffusée sur France 2 le 29 septembre 2015 dernier. S’il peut paraître long dans sa version pour le cinéma, on apprécie cependant le voyage poétique et instructif, comme tous les autres longs-métrages de qualité qu’il nous a déjà proposé. Avec ce fond noir et ces visages qui défilent, on a l’impression que tous ces témoins s’adressent directement à nous et nous parlent de ce que l’on a de différent ou de similaire. Tous deviennent des orateurs privilégiés qui touchent directement en plein cœur. Prenons pour exemple le condamné pour double meurtre qui évoque le pardon et l’amour qu’il a reçu de la mère (et grand-mère) de ses victimes avec beaucoup d’émotion. Tous évoquent leur notion du bonheur (différente de la nôtre et tout aussi sincère). Pour certains, elle ne constitue bien souvent qu’à n’avoir qu’un toit et de quoi vivre décemment, de retrouver sa famille ou de s’offrir un objet que l’on désirait tant. Cela remet bien évidemment en question notre mode de vie, nos exigences face à la vie, notre consommation excessive et le besoin d’avoir plutôt que d’être… Le rapport des hommes à la guerre et aux armes est aussi une des thématiques abordées sous différents angles mais de telle sorte que l’on a jamais l’envie de juger ce qui peut être évoqué. L’amour, l’homosexualité sont aussi abordés en toute impunité… Et puis comme toujours, les musiques que Yann Arthus-Bertrand a choisies portent à merveille ses propos et se marient aux images avec beaucoup de subtilité. Plus qu’un documentaire, « Human » est une ode à la vie, à la tolérance, à la compréhension du monde qui nous entoure. Son réalisateur a d’ailleurs dit « Je pense que comprendre le monde est extrêmement difficile aujourd'hui autant que d’accepter nos contradictions au quotidien, Et sans doute qu'à travers toutes ces interviews, je suis devenu meilleur. C'est l'ambition du film en fin de compte ». Nous, on ne peut que le remercier de nous avoir rendu meilleur et de nous avoir ouvert les portes des peuples d’ailleurs. Durée du film : 3h10 Genre : Documentaire Totalement passé inaperçu lors de sa sortie dans nos salles en juin dernier, « Danny Collins » est pourtant une vraie perle cinématographique comme on les aime. Distribué sous le nom d’ « Imagine » en France, cette comédie dramatique présente un Al Pacino comme on a rarement l’habitude de le voir. Retour en arrière sur un film phénomène immanquable. Résumé du film : Danny Collins est une vraie rock star. Depuis plus de quarante ans, ils arpentent les routes et offrent des concerts retraçant sa carrière devant un public de fans conquis. Lors de son anniversaire, son meilleur ami lui offre un cadeau extraordinaire : une lettre que John Lennon avait écrite à Danny dans les années 70 et qui ne lui est jamais parvenue. Dans son courrier, le célèbre Beatles encourage le chanteur à continuer d’écrire ses textes tant ils sont bons. Mais la rock star n’a pas opté pour cette carrière, préférant des interprétations plus populaires et il prend vite conscience qu’il a fait fausse route durant de trop nombreuses années. Bien décidé à renouer avec l’homme qu’il est vraiment, Danny Collins plaque tout et décide de rattraper le temps perdu auprès de sa famille. Mais peut-on tout recommencer aussi facilement ? Avis : « Danny Collins » est un feel good movie comme on en voit peu. Touchant, amusant, émouvant, ce film, inspiré de faits réels, recèle bien des qualités scénaristiques mais pas seulement. En visionnant le premier long métrage de Dan Fogelman, vous vous apprêtez à découvrir un Al Pacino comme vous ne l’avez sans doute jamais vu ! En effet, le personnage de Danny Collins offre une belle opportunité de jeu à l’acteur américain de 75 ans. Son impressionnante carrière est parsemée de rôles emblématiques et l’apologie de ses interprétations n’est plus à faire. Néanmoins, avec ce film, il revêt le costume d’une star pop rock un peu « has been » mais terriblement touchante. Envieux de renouer avec sa famille, il fera tout son possible pour trouver grâce à leurs yeux et retrouver des valeurs familiales qu’il a trop longtemps délaissées. Drôle, maladroit, généreux, Danny est une caricature ancrée dans les années 70, avec tout ce que cela inclus : rouflaquettes, paillettes, chemines à col en v amidonnées, consommation de drogue excessive. Il lutte contre ses démons qui l’empêchent de « grandir » et de faire face à la réalité de la vie. Mais ouvrir les yeux et entrer dans son époque, c’est aussi se rendre à l’évidence : sa famille s’est construite dans son absence et lui a laissé bien peu de place. Cette famille, elle est très justement interprétée par Bobby Cannavale (vu dans « Chef » il n’y a pas longtemps), un fils en déni total avec l’univers paternel auquel il n’a jamais adhéré ainsi que Jennifer Garner, la belle-fille compréhensive, devenue bien malgré elle une sorte de médiateur entre les deux Collins père et fils. Applaudissons aussi la performance de la toute jeune Giselle Eisenberg, petite fille du chanteur et actrice étonnante pour son âge ! Elle sera le trait d’union de cette famille qui peine à se retrouver et saura toucher en plein cœur notre papy rockeur. A côté de cette smala, Danny va également croiser la route de Mary Sinclair tenancière d’un hôtel de luxe, devenue son amie et qui remettra bien des fois la tête de notre rock star sur ses épaules. Bien décidée à ne pas succomber à ses avances, elle sera la confidente, la raison de celui qui pensait tout avoir pour être heureux. Incarnée par l’excellente Annette Benning (« The face of love », autre jolie pépite, « American Beauty », « Elle s’appelle Ruby », « The kids are all right»), son personnage est délicieux et apportera une dose de douceur et d’humanité dans l’histoire de notre héros. Enfin, Christopher Plummer, autre grande figure du cinéma américain, endosse le costume du producteur et du meilleur ami véritablement sincère de Danny, le seul à l’avoir accompagné tout au long de sa carrière et dans sa vie privée parfois compliquée. Belle bouffée d’air frais dans cette période où les jours deviennent sombres, « Danny Collins » est un film à ne manquer sous aucun prétexte. 2015 nous a réservé de belles surprises et celle-ci est vraiment de taille … réservez-lui une place de choix dans votre dvdthèque car il est certain que vous ne le regretterez pas ! Durée du film : 1h46 Genre : Comédie dramatique Résumé du film : En décidant de voir « Le Dernier Loup », nous optons pour un voyage dans le temps et dans l’espace. En effet, nous voilà en 1969, sur les pas de Chen Zhen, un étudiant de Pékin, envoyé en Mongolie pour éduquer des éleveurs nomades mongoles. Très vite, le jeune chinois va adhérer au rythme de vie des paysans et s’enrichira des beautés de la steppe immense. Dans ce milieu hostile, les loups règnent en maître et Chen Zhen ne cessera d’admirer le comportement de la meute qui les entoure. Alors que Mao Tse Toung demande aux populations rurales d’éradiquer cette espèce animale, l’étudiant capture un louveteau dans le but de l’apprivoiser. Comment la communauté mongole va-t-elle réagir ? Pourra-t-il imposer son choix aux autorités locales envoyées par le gouvernement ? Comment laisser la nature s’épanouir quand des Hommes sont là pour la réguler ? Quel risque peut-on encourir quand on veut domestiquer un animal sauvage ? Chen Zhen découvrira combien il n’est pas aisé d’imposer ses idées. Avis : Jean-Jacques Annaud, célèbre cinéaste français nous offre depuis des décennies, des films de qualité. « Le Dernier Loup » ne fait pas exception, que du contraire ! Mais faut-il encore présenter l’Homme qui se cache derrière la caméra ? Auteur et réalisateur d’une série de films bouleversants et aux thèmes variés tels que « Le Nom de la rose », « l’Ours », « l’Amant », « Sept ans au Tibet », « Deux frères », il aura mis près de 7 ans à réaliser son dernier film… et pour cause, il fallait élever des petits louveteaux et entrer dans l’univers de ce animal fascinant afin de présenter avec réalisme le mode de fonctionnement d’une meute. Loin d’être un document animalier, « Le Dernier Loup » est un drame touchant et pragmatique Bien évidemment, visionner ce genre de long métrage doit découler d’un choix réfléchi. Les amateurs d’action, de fantaisie, d’amour cucul ou de scénarios haletants seront déçus. Les autres, ceux qui attendaient avec impatience le dernier Annaud ou les amateurs de belles images seront ravis car ce film est un condensé de tout ce que l’on aime dans le cinéma du septuagénaire. Une fois de plus, JJ Annaud prône un cinéma authentique aux images léchées et presque 100% bio. Il filme avec amour un sujet qu’il a découvert et porté avec fascination et passion et cela s’en ressent. Côté réalisation, on adorera les images de la steppe asiatique ainsi que les plans rapprochés des différents animaux et particulièrement ceux des loups. Les émotions diffusées par leur regard sont bluffantes et impressionnantes. A croire que l’animal est un comédien à part entière et qu’il se met au service du scénario avec résolution. Il ne vole cependant pas la vedette aux acteurs professionnels car, en réalité, les uns comme les autres desservent le scénario, qui est la véritable star du film. Pourtant confortablement installés dans notre canapé, on se retrouve à des milliers de kilomètres de chez nous, dans un environnement sublime et quelque fois inquiétant, à admirer l’évolution d’un groupe humain et d’une meute qui se côtoient avec risques et dévotion. Preuve que la technique et la réalisation sont réussies avec ces images si bien léchées. Notons qu’Annaud admettra avoir eu recours à quelques effets spéciaux pour une scène de blizzard mais affirme qu’hormis cela, tout est authentique… on veut bien le croire ! Niveau équipe du film, sur les 650 personnes qui ont travaillé sur ce long métrage, seules 9 étaient françaises. Toutes les autres, des comédiens aux techniciens ont été recrutées en Chine. Parmi les rôles principaux, notons la présence de quelques vedettes chinoises comme Feng Shaofeng (« Le dernier royaume ») ou Shawn Dou (« The flowers of war », « Nightfall ») et des acteurs inconnus qui remplissent le contrat avec brio : Basen Zhabu, Yin Zhusheng, Ankhnyal Ragchaa. C’est grâce à ce genre de film que l’on se rend compte combien le cinéma asiatique est ignoré pour les Occidentaux que nous sommes. Dommage car ils ont quelques pépites dans leur pays de rizières. Notre seul petit regret : le doublage qui n’est pas totalement mauvais mais qui empêche de profiter pleinement du jeu des acteurs asiatiques qui font sans doute passer leurs émotions de façon plus intense encore ! Optez donc pour une VO sous titrée, c’est bien plus adapté ! Enfin, la musique signée James Horner (« Avatar », « Le masque de Zorro », « Titanic », « Apollo 13 », etc.) porte à merveille le long métrage et se calque avec justesse sur les différentes scènes du film, faisant battre notre cœur d’émotion ou de stress. Les Chinois ne se sont pas trompés en demandant à Annaud de réaliser l’adaptation du best-seller « Wolf Totem ». Aussi lu que le « Petit livre rouge » de Mao, ce roman a touché la foule populaire de Chine sur des générations. Preuve en est que ce pari est réussi puisque le film enregistrait plus d’un million d’entrées au box-office chinois le premier jour de sa sortie ! Moins suivi chez nous, il a pourtant enregistré un nombre d’entrées important en France au point de talonner les très médiatiques « 50 nuances de Grey » et « American Sniper » sortis au même moment. Espérons que ce film Finalement boudé par la compétition des Oscars pour représenté la Chine, « Le dernier loup » est un film 4 étoiles sans doute peu apprécié pour sa juste valeur. Oui, c’est vrai le film a quelques longueurs. Oui, ce drame peut sembler « plat » par moment (surtout si on est des adeptes de film d’action). Nous, on aura voyagé dans la steppe mongole durant près de 2 heures et on sera sorti de la salle heureux du voyage et envieux de faire connaître le dernier opus du grand Annaud! Durée du film: 1h55 Genre : Drame Titre original chinois : 狼图腾 (Láng Túténg) Résumé du film : L’histoire, vous la connaissez sans doute déjà tant on l’a présentée dans les médias. Paula Bélier, fille d’agriculteurs sourds et muets, s’inscrit dans un cours de chant de son collège. Très vite, son professeur remarque en elle un talent certain et souhaite l’inscrire au concours de la Maîtrise de France Radio à Paris. La jeune adolescente, très mature, sera tiraillée entre sa nouvelle passion et l’envie d’aider ses parents dans leur quotidien… Mais comment convaincre les siens que ce qui leur fait défaut (à savoir la voix) peut aider à concrétiser un rêve ? Avis : Il y a de cela presqu’un an, au sortir de la projection, rares étaient les insatisfaits. En effet, Eric Lartigau (« Les infidèles », « Prête-moi ta main », « Mais qui a tué Pamela Rose ») est un habitué des comédies bleu blanc rouge et nous fait vivre durant 1h45 une histoire drôle, touchante et brillante. Tout y est juste : du jeu à la musique, on assiste à un film philharmonique. C’est un VERY good movie à côté duquel il ne faut pas passer ! Pour son casting tout d’abord. Excellentissime est sans doute un superlatif trop faible pour décrire le jeu de tous ceux et celles qui s’impliquent dans ce film. Impossible de dire qui se distingue par sa prestation, tant tous les comédiens sont au diapason, du rôle le plus important au plus anecdotique. Karin Viard et François Damiens signent ici une vraie performance car non contents d’avoir appris la langue des signes pour incarner des sourds et muets, ils amplifient leur force comique par un non verbal maîtrisé, naturel et drôle. Le défi est largement relevé et on ne peut qu’admirer la prise de risque et sa réussite ! On aurait presque envie de se mettre à genoux et d’aduler les comédiens tellement leur performance réalise un sans faute. Il en va de même pour Eric Elmosnino (il avait reçu le prix du meilleur acteur pour « Gainsbourg, vie héroïque ») qui incarne le professeur de chant de l’école. Acariâtre et directif, il devient le personnage le plus important de la vie de Paula. Le comédien n’hésite pas à mouiller sa chemise et mettre son talent de musicien au service du long métrage. Plus réaliste que jamais, son personnage est détesté puis apprécié de tout son public, preuve que son interprétation sonne juste. Enfin, Louane Emera, la vraie révélation du film, qui du haut de ses 18 ans nous donne une vraie claque. Elle jongle avec les émotions comme si elles étaient siennes. On partage ses joies, ses peines, ses satisfactions et ses déceptions sans se rappeler une seule fois que nous sommes confortablement installés dans notre ciné. On vit sa vie au point de trembler avec elle et de ne pouvoir s’empêcher de verser quelques larmes à plusieurs reprises. On ne sait d’ailleurs pas si on lui souhaite une belle longue carrière de comédienne ou de chanteuse, tant elle réalise les deux avec talents et émotions (justes !). Inconnue du monde du 7ème art, elle crève l’écran avec cette première performance admirable. Elle nous émeut par la fragilité dans son jeu et par sa voix chaude toute en rondeur lors des tours de chant. Pas étonnant que Michel Sardou lui-même ait été ému d’entendre ses titres réinterprétés avant tant de fébrilité ! D’ailleurs, pour prolonger ce superbe moment ciné, il suffira de se plonger dans la BO, signée Evgueni Galperine et interprétée par Louane Emera, la chorale des Hauts de Seine et Eric Elmosnino. Un petit bijou on vous avait dit ! Durée du film : 1h46 Genre : Comédie dramatique Résumé du film : Vincent, retraité acariâtre, est criblé de dettes et abuse de l’alcool. Complètement paumé, il tente de rester la tête hors de l’eau malgré ses gros soucis financiers. Mais quand Maggie et son fils Oliver viennent emménager à côté de chez lui, sa vie prendra un tout autre sens. Le vieux bougon endossera le rôle de « baby-sitter » auprès du petit garçon de 12 ans et prendra de nouvelles responsabilités. Avis : Presque passé inaperçu lors de sa sortie en salles (et en DVD) « St Vincent » est pourtant un film à ne pas manquer. Touchant, drôle et léger, il est rempli de qualités ! Cerise sur le gâteau, il offre une prestation remarquable en la personne de Bill Murray ! L’ancien « ghostbuster » (qui rejoindra d’ailleurs l’équipe du 4ème opus) tient ici un de ses meilleurs rôles. Renouant avec un jeu que l’on avait très apprécié dans « Lost in translation », Bill Murray offre une interprétation impeccable et ce, jusqu’aux dernières notes du générique de fin, qu’il prend plaisir à chantonner. Grincheux, paumé, déluré, râleur, la liste des adjectifs pour qualifier son personnage est longue. Mais derrière cette apparence se cache un Homme au cœur d’or, prêt à faire quelques sacrifices pour le bien-être de son entourage. Et çà, le petit Oliver l’a bien compris. Joué par l’excellent jeune acteur Jaeden Lieberher, le garçonnet percera la carapace de son vieux voisin et une amitié improbable verra le jour. La relation entre les deux protagonistes est au centre du film, et c’est un régal ! Les situations cocasses, les répliques truculentes viennent ponctuer la trame avec beaucoup d’humour et de tendresse. Car de la tendresse, il y en a et cela fait un bien fou de voir un long-métrage sans « méchant », sans étalage d’action, sans mesquinerie… Tous les personnages sont touchants. Même celui de Melissa McCarthy (« Very Bad Trip 3 », « Les flingueuses », « Spy ») qui pour une fois, délaisse son jeu lourdingue et « too much » dans lequel elle est régulièrement cantonnée. Sobre, elle prouve ici qu’elle a de jolies ressources en stock et incarne cette mère dépassée avec beaucoup de sincérité. On espère réellement qu’elle optera plus souvent pour ce genre de rôle qui lui va à ravir ! Enfin, notons la présence de Naomi Watts en prostituée enceinte, preuve que rien n’est convenu d’avance…. Certes l’histoire n’a rien d’originale mais peu importe. Ici, c’est la performance du jeu d’acteurs, la relation entre les différents personnages qui priment sur le scénario et Theodore Melfi (qui réalise son premier long-métrage) l’a bien saisi. Le quatuor de comédiens offre une comédie savoureuse qui plaira à beaucoup d’entre vous ! Nous ne manquons pas non plus de faire un petit clin d’oeil à la bande originale du film (proposée par Theodore Shapiro), pile poil dans le ton, et extrêmement plaisante pour nos oreilles. Tout dans « St Vincent » fait de ce film un petit bijou de l’image au son, de la drôlerie à l’émotion… Véritable pépite, ce « feel good movie » est approprié à nos temps gris car il fera entrer un peu de soleil dans votre journée et vous fera sourire autant qu’il pourra vous toucher. Durée du film : 1h34 Genre : Comédie « Nebraska ». Ce film est une vraie réussite, à tout point de vue ! Qu’il s’agisse de la réalisation, de la bande-son, de la photographie, du jeu des comédiens… tout est parfait ! Raison pour laquelle nous vous proposons cette petite pépite qui nous est chère. Résumé du film : Woody Grant est un vieux monsieur, usé par l’alcool et par le poids de l'âge. Sa vie s’illumine lorsqu’il reçoit un courrier lui annonçant qu’une grande loterie le désigne gagnant de la coquette somme d’un million de dollars. Il décide donc d’aller chercher son dû dans l’état du Nebraska contre l’avis de toute sa famille qui s’obstine à lui faire comprendre qu’il est victime d’une arnaque. Mais qu’importe, Woody est têtu et prend la route. Son fils, désespéré de le ramener à la raison, décide de l’accompagner dans cette aventure qui les rapprochera et ravivera quelques souvenirs. Avis : « Nebraska » figure parmi nos coups de cœur de 2014. Un peu passé inaperçu, le film du réalisateur américain Alexander Payne a pourtant de très belles qualités. Rempli de tendresse, d’humour, de valeurs sincères, d’espoir et de tristesse aussi, il mixe les émotions avec beaucoup de délicatesse et offre un film touchant et vrai, comme on voudrait en voir plus souvent. Tout d’abord, parce que l’histoire qu’il nous propose est savoureuse. La route que le père et le fils vont emprunter, les rapprochera, les ouvrira à l’autre et leur permettra de découvrir l’histoire familiale qu’ils n’ont jamais vraiment partagée. C’est donc une occasion unique de se retrouver et de se parler. Bien sûr, tout cela ne se fera pas sans heurt et fort heureusement pour nous car nombreuses sont les scènes cocasses ... mais toujours empruntes de tendresse. Nous sommes en permanence les témoins privilégiés de ce road movie peu ordinaire. Et sur le chemin, nos deux protagonistes en profiteront pour rendre une petite visite à leur famille, restée dans leur village natal. Ensuite, parce que les acteurs du film sont exceptionnels. A commencer par le grand Bruce Dern (le papa de Laura Dern, Dr. Ellie Sattler - Grant dans « Jurassic Park »), qui interprète magistralement le désabusé Woody Grant. Son allure nonchalante, son entêtement, ses indélicatesses enrichissent un personnage haut en couleurs, malgré le choix du réalisateur, de filmer son histoire en noir et blanc. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que Bruce Dern a reçu le très convoité prix d’interprétation masculine lors du Festival de Cannes 2013 ! Son fils, joué par Will Forte (vu dans l’excellent « Broadway Therapy »), est un appui précieux et salvateur. Il est sans doute le seul à croire qu’il vaut mieux aider son père à vivre son rêve plutôt que de le réfréner en vain. Il n’hésitera pas à tout plaquer pour prendre la route vers la ville de Lincoln où l’attendent le précieux gain. A ces deux personnages emblématiques, ajoutons le frère, incarné par le talentueux Bob Odenkirk (qu’on prend beaucoup de plaisir à suivre dans la série « Better Call Saul »), présentateur télé plus terre à terre et peu enclin à suivre les frasques de son père, ainsi la truculente June Squibb, l’épouse de Woody, cash et volubile à souhait. Voilà une famille explosive qui ne peut que prêter à sourire ! A ces comédiens, nous pouvons ajouter une série de seconds couteaux tout aussi pittoresques dans leur personnalité ou leur attitude. On se régale de bout en bout, tantôt riant aux éclats, tantôt touchés par les réactions moqueuses de quelques envieux. Notons aussi que la musique répétitive de Mark Orton vient ajouter une petite dynamique sympathique à ce road movie tendre et délicat. Si vous avez envie d’une bouffée d’air frais, d’une jolie histoire sur fond d’humour gentillet, « Nebraska » ne pourra vous décevoir, mieux, il pourrait fortement vous plaire ! Durée du film : 1h54 Genre : Comédie/ Road Movie Résumé du film : Ila est mère au foyer. Comme beaucoup d’autres femmes de sa condition, elle prépare chaque jour le repas de son mari et le lui fait livrer par coursier. Appliquée et désireuse de le reconquérir à travers sa cuisine, elle tente de nouvelles expériences gustatives qui ne semblent pas avoir l’effet souhaité. Et pour cause, les repas qu’elle prépare sont livrés à quelqu’un d’autre… Curieuse de savoir qui se régale de ses petits plats, elle décide de lui écrire au travers de sa lunchbox… Avis : À sa sortie, le film indien « The lunchbox » avait enthousiasmé les critiques. Convaincu à notre tour, c’est tout logiquement qu’il rejoint notre rubrique des petites pépites. Derrière sa sensation de lenteur, cette très jolie histoire au scénario original a tout pour plaire et a le mérite d’apporter sa dose de bonne humeur dans notre quotidien. L’histoire est toute simple. Deux personnes esseulées créent un échange épistolaire et se confient leurs états d’âme, leur joie, leur peine au travers des petites missives. Tous les opposent (l’un est proche de la retraire et assez aigri dans la vie, l’autre jeune mère de famille trompée mais positive) et pourtant, ils parviennent à créer une relation à distance qu’ils n’auraient sans doute jamais eue si les repas mijotés d’Ila ne s’étaient pas égarés. Mais au-delà de cette « simplicité » scénaristique, on trouve une complexité de thèmes intelligemment abordés. Emotions, espoirs, confidences accompagnent un chemin de vie révolutionné par une erreur salvatrice. Avec « The lunchbox» Ritesh Batra réalise son tout premier long métrage. Habitué aux courts-métrages, son film connaît un succès fulgurant suite à sa présentation au Festival de Cannes 2013. Fort de cette expérience, il réalise en ce moment « The sense of an ending » et semble vouloir continuer à nous livrer un cinéma authentique parsemé de valeurs nobles. Si le cinéma indien nous est encore trop étranger, on ne peut que constater qu’il contient des petits bijoux qui méritent d’être découverts. Il en va de même pour les comédiens du film qui signent une performance remarquable et portent l’histoire des protagonistes avec beaucoup de résolution. En tête du casting, Irffan Khan, acteur emblématique, vu notamment dans « L’Odyssée de Pi », « The Amazing Spiderman » ou récemment dans « Jurassic World » (où il incarnait M. Masrani, le propriétaire du parc). Nimrat Kaur, elle, est bien moins connue chez nous et n’a pas une carrière aussi impressionnante. Qu’importe, ses émotions nous portent et nous entraînent dans son quotidien avec beaucoup de justesse. Enfin, Nawazuddin Siddiqui, jouera le confident, l’intermédiaire, l’insolent bienveillant et déclenchera, sans s’en rendre compte, une prise de conscience chez notre héros. Le trio d’acteurs est brillant, vraiment ! Enfin, comme le dit l’un des personnages du film : « un mauvais train peut nous mener à bonne gare ». Cette philosophie de vie résume sans doute au mieux tout ce que l’on pourrait écrire sur le film et donne un bref aperçu de ce que vous pourrez y trouver. Nous, nous sommes montés à bord en toute confiance et avons fait un très bon voyage ! Durée du film : 1h45 Genre : Drame Titre original : द लंच बॉक्स Si « #Chef » rejoint notre rubrique des petites pépites, c’est parce que ce film offre un moment de cinéma comme on les aime. On ne se lasse pas de le voir et on prend toujours un immense plaisir à en parler autour de nous. Dès lors, nous ne pouvons que vous conseiller d’entrer dans l’univers du Chef Casper et nous espérons que vous y trouverez vous aussi, votre touche d’allégresse. Résumé du film : Carl Casper est un chef passionné mais bridé. En effet, le patron du restaurant pour lequel il travaille aime les valeurs sûres et laisse peu de place à sa créativité. Lorsqu’un grand critique débarque dans la salle et descend son travail en flèche, Carl décide de tout plaquer, de se consacrer à sa famille, à ses projets et de donner un nouveau souffle à sa vie. C’est à bord d’un food truck qu’il renaîtra de ses cendres et s’adonnera à une cuisine identitaire et savoureuse… Avis : Depuis quelques années, la cuisine refait partie intégrante de notre culture télévisuelle ou familiale et nombreuses sont les émissions / séries évoquant le domaine culinaire. Alors que de multiples longs métrages ont déjà abordé ce thème (« Les recettes du bonheur », « Les saveurs du palais », « Comme un chef »,etc. ), nous nous plongeons avec un plaisir incommensurable dans le long métrage de Jon Favreau. Bientôt à la réalisation du « Livre de la jungle » (dont les premières images sont prometteuses), le comédien et scénariste américain offre ici une histoire présentant une aventure humaine exceptionnelle. Une fois de plus, Mr Favreau démontre qu’il est un réalisateur multi facettes et nous entraîne dans des univers toujours très différents les uns des autres : qu’il s’agisse d’ « Elfe », d’ « Iron Man » ou encore de « Cowboys et envahisseurs », il sait varier les plaisirs et fort heureusement ! A nouveau, il a su s’entourer d’une équipe de comédiens des plus talentueux. Son personnage est en effet encadré par une brigade fidèle et confiante en ses projets. Qu’il s’agisse de son fils, interprété par le tout jeune Emjay Anthony, son ex-femme (Sofia Vergara, vue dans « Joker » ou dans la série « Modern Family ») ou son ami de toujours (John Leguizamo), tous y trouvent leur place avec ambition et conviction. Et à côté des protagonistes, une belle brochette d’acteurs tels que Dustin Hoffman, Scarlett Johansson, Bobby Cannavale (« Danny Collins », « Spy »), Oliver Platt ou encore Robert Downey Jr (qu’il a déjà fait tourner dans… « Iron Man»). Quand on vous disait que ce film était un petit régal ! L’histoire qui nous préoccupe montre combien il ne faut jamais baisser les bras et croire en soi, en ses rêves et que la confiance de nos proches peut nous porter au-delà de nos espérances. Ce sont autant de jolies valeurs familiales et amicales qui sont présentées tout au long de ces presque deux heures de film (vraiment ? On n’a pas vu passer le temps) et c’est une des raisons pour lesquelles « #Chef » vaut vraiment la peine d’être vu. Durée du film : 1h54 Genre : Comédie Titre original : Chef Avec son film sorti en DVD en novembre dernier, Ken Loach nous entraîne dans la campagne irlandaise des années 30. Résumé du film: Basé sur l’histoire vraie de Jimmy Gralton, "Jimmy's Hall" nous immerge dans une période méconnue où l’Eglise, auto proclamée seule détentrice de vérité, condamne la population avide de loisirs et de culture. Revenu des Etats-Unis où il s’est exilé dix ans plus tôt, Jimmy et une bande d’amis, décident de remettre sur pied le « Pearse-Connolly Hall », lieu d’instruction et de retrouvailles bon enfant où tout un chacun peut apprendre les arts picturaux et littéraires ou s’adonner à la danse lors de bals populaires. C’était sans compter sur le père Sheridan et les autorités du comté de Leitrim, qui mettront tout en œuvre pour fermer ce foyer de « débauche » et asservir la population locale à une pensée plus « pure » et moins communiste. Avis: Excessivement bien réalisé, ce film nous offre une bouffée d’oxygène et présente une palette d’émotions réalistes. La révélation du film est sans conteste, Barry Ward, bien trop méconnu, et qui crève l’écran et nous convainc à le suivre dans ce combat pour la liberté et le droit de vivre. "Jimmy’s Hall "est un film émouvant, instructif et exaltant. A voir ! Durée du film : 1h49 Genre : Drame historique Résumé du film: Nikki, cinquantenaire bourgeoise, a énormément de mal à se remettre de la perte dramatique de son mari. Depuis 5 ans, souvenirs et peines hantent son quotidien. Un jour de visite d’un musée d’art particulièrement apprécié par son époux, elle croise la route de Tom, un artiste peintre somme toute banal… sauf qu’il ressemble trait pour trait à celui qui a partagé sa vie durant 30 ans. Avis: Obstinée à retrouver ce sosie, Nikki se lance dans une quête de l’Amour perdu, et fera entrer dans sa vie une copie exacte de feu son mari. C’est une histoire à la fois malsaine et extrêmement touchante que s’approche à vivre ces deux « inconnus », incarnés à merveille par l’excellent Ed Harris (Abyss, Apollo 13) et par la bouleversante Annette Bening (American Beauty, Mother & Child). En prime, nous côtoierons Robin Williams, qui, par son jeu, nous rappelle douloureusement combien il manque à nos écrans. Arie Ponsin signe ici un deuxième long métrage qui marquera les esprits et qui interroge sur la capacité à faire le deuil d’une histoire d’Amour dans la folie ou dans la lucidité. Une petite pépite à découvrir « The Face of Love » est une histoire touchante, innovante et interpellante qui saura plaire à un large public. Intéressant par son approche de la psychologie des personnages, ses différentes clés de lecture feront de ce film un drame profond et excessivement bien interprété par deux acteurs de qualité! Durée du film: 1h32 Genre: Drame / Romance Résumé du film : Manchester, 1939. Alan Turing entend parler d’une mission top secrète consistant à décoder les messages radio militaires allemands. Mathématicien de génie et professeur d’université à la logique implacable, il se sent à la hauteur de ce défi. Mais c’était sans compter sur la complexité d’Enigma, cette invention quasi-démoniaque, qui change les codes chaque jour, empêchant qui que ce soit de traduire les manœuvres belliqueuses mises en place et menaçant la liberté de l’Europe entière. Entouré d’autres intellectuels de son époque, Alan Turing va mener son plus grand combat : déjouer Enigma ! Avis : Il existe des films dont les bandes annonces entrouvrent des portes et attisent la curiosité du spectateur. « The imitation game » fait partie de ceux-là et après sa vision, on ne pourra admettre qu’une chose : ce film a tenu toutes ses promesses ! Tout d’abord, parce son casting est époustouflant. Grand coup de chapeau à Benedict Cumberbatch, connu notamment pour son rôle de Sherlock dans la série anglaise du même nom, et qui porte le rôle d’Alan Turing à bouts de bras avec un indéniable talent. Keira Knightley n’est pas en reste car elle- aussi est efficace dans son rôle de jeune génie épanouie et investie dans une mission qui n’aurait jamais dû être le sienne. Et que dire d'Elle Leech (le chauffeur de la famille Crawley dans la série Dowton Abbey) qui révèle tout son jeu dans cette interprétation de chercheur prêt à tout pour damer le pion à la nation germanique ? Ce film américo-britannique a tout pour faire vivre une heure cinquante de plaisir cinématographique à ses spectateurs, on s’en réjouit ! Morten Tyldum, norvégien, était sans doute un anonyme pour beaucoup d’entre nous. Il y a fort à parier qu’avec sa brillante réalisation d’« Imitation game », il fera partie des noms que l’on citera après ce mois de janvier 2015. Car oui, ce biopic est une vraie réussite et il peut s’enorgueillir d’en être le brillant machiniste. Dans ce film, tout fonctionne : la mécanique, le casting même la musique, dont la bande originale signée Alexandre Desplat (compositeur très apprécié par le monde du 7ème art) , donne un élan perpétuel à l’histoire des personnages au point de faire partie intégrante de l’équipe. Si vous craigniez que le côté technique ne supplante le reste, rassurez-vous, ce n’est absolument pas le cas et c’est en toute confiance que vous pourrez vous préparer à un voyage dans un pan de l’Histoire peu connu. Certains seront déçus de ne pas percer les mystères du secret « Enigma », d’autres apprécieront cette concision. Car « Imitation game » présente l’histoire de Turing, l’Homme, le mathématicien innovateur, celui qui, plutôt que de se battre arme au point contre les Allemands, a résisté au temps et aux années pour trouver une manière de décoder les messages cryptés de l’armée nazie et qui, par son travail, aura définitivement changé la face de l’Histoire. On découvre son parcours, son enfance, ses réussites et ses échecs à travers des flash back réussis. Ceux-ci qui ne gâche en rien la dynamique générale du film, que du contraire, ils permettent de s’approprier la psychologie du personnage et de comprendre certains de ses choix. Comment un homme, introverti, cartésien, un tantinet arrogant et pourtant fragile parviendra-t-il à percer ce que n’importe quelle machine mettrait des millions d’années à décoder ? Et s’il ne parvenait pas mener à bien la mission que l’Angleterre lui a confiée ? Pire, quelles seraient les conséquences d’une éventuelle réussite ? Voir «Imitation game », c’est accepter de réécrire une partie de l’Histoire de la deuxième guerre mondiale et de se laisser emporter dans le tourbillon des codes et des lettres à ne plus savoir que penser. C’est découvrir comment l’avenir des nations peut se trouver entre les mains de quelques érudits… Durée du film: 1h55 Titre original: The imitation game Ne vous y trompez pas, le dernier film de Lucas Belvaux n’est pas un film d’Amour ; c’est un film sur l’Amour. Cette nuance est importante car le spectateur n'en ressort pas indemne. Attention pépite en approche! Résumé du film : Clément, jeune professeur de philosophie parisien est affecté à Arras pour un an. Loin de Paris et ses lumières, Clément ne sait pas comment occuper son temps libre. C'est alors qu'il rencontre Jennifer, jolie coiffeuse, qui devient sa maîtresse. Si la vie de Clément est régie par Kant ou Proust, celle de Jennifer est rythmée par la lecture de romans populaires, de magazines « people » et de soirées karaoké avec ses copines. Cœurs et corps sont libres pour vivre le plus beau des amours mais cela suffira-t-il à renverser les barrières culturelles et sociales? Alors bien sûr, au vu du pitch, nous pourrions présager un choc culturel entre deux personnes n'évoluant pas dans le même univers. Et c'est précisément là le tour de force du réalisateur. Jamais il n'enferme longtemps ses personnages dans ce cadre. Il désamorce, rend ses personnages extrêmement lucides et nous surprend. Chapeau l'artiste.. Avis : « Pas son genre » est adapté du roman éponyme de l’écrivain français Philippe Vilain , publié en 2011 chez Grasset. C’est en écoutant une chronique que Lucas Belvaux a eu l’envie de le transcrire au cinéma. Et ce, pour notre plus grand plaisir. Nous le disions d’entrée de jeu, « Pas son genre » parle d’Amour, mais pas seulement. C’est également un film sur les attentes que le sentiment amoureux génère. Cette œuvre retranscrit de façon fine les espoirs que l’Amour porte en lui, ses désillusions et ce sentiment de ne pas toujours être compris. Non par manque de communication mais parce que l’autre ne possède pas toujours les clés de lecture. C’est un peu comme si les personnages se situaient à différents niveaux de communication. Et chacun décode la relation avec ses bagages propres et sa vision de l’Amour. Comment ne pas être déçu lorsque nos attentes sont trop fortes? Comment être heureux lorsqu’on attend de l’Amour qu’il se manifeste tel qu’on l’a toujours désiré. Avec nos attentes, notre vision et nos espoirs? La réalisation est sans faille: elle est actrice à part entière et ira jusqu’à appuyer la psychologie des personnages pour nous tromper, nous manipuler. Ou du moins nous amener à ressentir les tourments des personnages et à prendre parti. A tort ou à raison ? Brillant. D'ailleurs, le réalisateur avoue que contrairement au roman où l’histoire est racontée à la première personne; le point de vue parlé ne sera plus uniquement celui de Clément (charismatique prof de philosophie et acteur de talent); mais aussi à Jennifer, la fille dont il tombe amoureux. "J’ai choisi de rééquilibrer les points de vue, afin de regarder les deux personnages à la même distance, de les traiter de la même façon parce que, finalement, malgré leurs différences, je suis aussi proche d’elle que de lui", confiera le réalisateur. Le rôle de Clément est porté par Loïc Corbery (Adoubé Chevalier dans l'Ordre des Arts et Lettres) en état de grâce. C'est simple, quel que soit le moment où l'acteur est épié par la caméra, sa présence et son jeu flattent notre rétine. Quant au personnage de Jennifer (à prononcer à l'anglaise, c'est important!), Emilie Dequenne trouve là un rôle qui semble lui correspondre: belle, vraie et spontanée. Elle apparaît tel un soleil pour évoluer vers plus de noirceur. Les deux acteurs jouent de concert sans fausse note dans cette belle symphonie. La musique, très présente sert l’intrigue et dessine le personnage d’Emilie Dequenne, coiffeuse spontanée, blasée des histoires sans lendemain et des mecs bidons. Où est celui qui l’aimera comme elle le mérite? Ou plutôt comme elle le veut, comme elle le désire ardemment? Jennifer veut aimer passionnément, avec force. Clément aime Jennifer à travers toute sa singularité, sa simplicité qui font qu’elle est touchante et tellement vraie. La force du film est d’interpeller le spectateur en le mettant devant un miroir. Il le questionnera alors sur l’acte d’Aimer. Et il nous renverra devant notre propre façon d’être à deux, en relation. Très vite, le réalisateur ira plus loin et nous élèvera pour contempler ce tableau cinématographique. Nous serons alors les témoins impuissants de la distanciation progressive du couple; gangrené par les attentes d’un « idéal » de l’un et la mauvaise compréhension du climax qui est en train de se jouer pour l’autre. Brillant! Et parce que Kant parle de la passion amoureuse mieux que votre serviteur: "La passion amoureuse ou un haut degré d'ambition ont changé des gens raisonnables en fous qui déraisonnent." - Emmanuel Kant Durée du film : 1h51 Genre : Comédie romantique Eric Lomax… ce nom ne vous dit peut-être rien ? Héros du film « Les voies du destin » (« The railway man » en VO), ce personnage, auteur d’une autobiographie intitulée « Les larmes du boureau » a réellement existé. C’est en effet l’histoire vraie de cet ingénieur et soldat britannique que nous conte Jonathan Teplitzky. Résumé du film : La vie d’Eric Lomax n’est plus qu’un champ de ruines depuis son retour de Singapour où il a servi dans l’armée britannique durant la deuxième guerre mondiale. Le ciel gris qui pèse sur lui comme une chape de plomb, se colore d’espoir lorsqu’il rencontre, Patti (interprétée par Nicole Kidman). Fraîchement marié, ce n’est pas une lune de miel qui l’attend mais un voyage intérieur où les peurs et les souvenirs de ses souffrances passées prennent le dessus et l’empêche de vivre pleinement son nouveau bonheur. Inquiète de voir son mari incapable de survivre à son passé, Patti cherche à comprendre l’enfer qu’était le sien jadis, en rencontrant un autre vétéran de cette guerre. Le mur du silence s’ébrèche petit à petit et ouvre une porte à une vengeance que pourra prendre Lomax. En effet, son tortionnaire vit toujours et est revenu sur les lieux de ses sévices. Notre héros parviendra-t-il à le rencontrer ? Quelle tournure pourrait prendre cette confrontation ? Se libéra-t-il enfin du poids de son passé ? Et si la victime devenait à son tour bourreau ? Ce sont ces réponses que l’on vient chercher en se rendant dans nos salles obscures où vous attend un film poignant et une interprétation de haute voltige ! Avis : De prime abord, on pourrait penser que ce film nous sert un remake du « Pont de la Rivière Kwaï », sorti en 1957. Mais détrompez-vous car même si le contexte historique est brièvement mis en avant, ce n’est pas le sujet principal du film. Au contraire, ce sont les Hommes plus que les faits qui font l’objet du film de Jonathan Teplitzky. Colin Firth incarne de façon époustouflante Eric Lomax, des années après sa libération mais toujours en proie à des crises d’angoisse, séquelles de son abominable incarcération dans le camp de Singapour. Il est difficile d’imaginer que Colin Firth n’a pas lui-même vécu ces atroces souffrances tellement ses larmes, ses peurs, son jeu sont convaincants et semblent être le reflet d’un passé douloureux qu’il n’a pourtant pas connu. Et que dire de son jeune pendant, Jeremy Irvine (vu dans « Cheval de Guerre » de Spielberg) qui est tout aussi crédible dans le rôle de Lomax jeune et avec lequel nous tremblons lors des séquences rétrospectives ? Nicole Kidman, seul personnage féminin du casting, joue une épouse désemparée, prête à tout pour que son époux trouve enfin une relative sérénité. L’actrice (de 47 ans) continue à nous faire vibrer et garde un talent de simplicité et de conviction que d’autres peuvent lui envier. Le Suédois Stellan Skarsgard est lui aussi de la partie et interprète un ami de Lomax, autre participant de cette guerre et le témoin privilégié de ce qu’a vécu le héros du film. Au contraire de son camarade, il reste enfermé dans sa solitude et n’a pour liens sociaux que les réunions de vétéran et les confidences faites à Patti. Comme souvent, son jeu d’acteur persuasif dessert à merveille le film et fera de lui, un des éléments déclencheurs de la seconde partie du film. Autre perle du casting, l’acteur peu connu Hiroyuki Sanada (aperçu dans « Wolverine- le combat de l’immortel » ou encore dans « 47 ronin »), qui tient le délicat rôle de tortionnaire « à la retraite ». Retrouvé par Lomax dans le lieu même où se sont déroulés les évènements atroces de sa captivité, il devra répondre de ses actes et faire face à une confrontation musclée. Vous l’aurez compris, le casting complet, sa crédibilité, la magnifique interprétation des personnages font de ce film un petit bijou que l’on dépose dans un écrin d’émotions que l’on est venu chercher en poussant la porte du ciné. « Les voies du destin » est un film qui ne pourra que vous troubler et vous faire réfléchir à votre capacité de pardonner ce qui peut paraître impardonnable. Durée du film : 1h57 Genre : Drame Titre original : The Railway man "LA SCIENCE m'a toujours fasciné. Lorsque j'étais enfant, au Tibet, j'étais mu par une grande curiosité quant au fonctionnement des choses. Quand j'avais un jouet, je commençais par jouer un peu avec, puis je le démontais afin de voir comment il était construit. (...) "Si la science vient à prouver qu'une croyance bouddhiste est erronée, alors le bouddhisme devra changer. A mon sens, science et bouddhisme ont en commun une quête de la vérité et un désir d'appréhender la réalité". Tenzin Gyatso, quatorzième dalaï lama Découvert à Deauville en 2014, cette petite pépite cinématographique n'est, hélas, pas sortie dans nos salles. Toutefois, ce film scénaristiquement ambitieux mérite qu'on le recherche afin de nous enrichir. Attention: film choc! Résumé: Afin de vous laisser la surprise, je ne dévoile qu'une infime partie de l'histoire. L'essentiel, à mes yeux, étant de vous parler ici de mon ressenti et de la portée de ce film intelligent. Ian Gray (Michael Pitt, totalement investi) - docteur en biologie moléculaire - mène des recherches sur l’œil humain. L'objectif étant pour lui de recréer les stades d'évolution de l’œil depuis sa forme la plus primitive (et même son absence) jusqu'au stade le plus évolué, à savoir celui de l'Homme. Et ainsi mettre fin à toute implication d'un "dessein de Dieu" et de tuer une fois pour toute le débat religieux. Très vite, le héros tombera amoureux de Sofi (hypnotisante Astrid Berges-Frisbey découverte dans "La Fille du puisatier" et "Pirate des Caraïbes: la Fontaine de Jouvence"). De leur rencontre naîtra la passion mais aussi la confrontation de deux univers que tout oppose: la science pour lui, et une vision enchantée de la vie faite de Karma, de cycle des renaissances et du destin pour elle. Avis: Au vu du pitch, vous aurez compris que la portée de cette perle dépasse de loin le cadre de la romance. A travers ce film, le réalisateur Mike Cahill (Another Earth) aborde très adroitement la dualité science et foi pour la mettre en tension jusqu'à un final renversant! C'est bien simple, il ira même jusqu'à prendre différentes orientations pour servir son film sans laisser le spectateur sur la route. Nous sommes littéralement happés par tant de maestria. (Surtout restez après le générique pour la surprise du chef). Le réalisateur a pris ce projet à bras le corps pour nous faire voyager en nous...sans nous faire quitter notre siège. Concernant ses motivations, celui-ci dira avec beaucoup de justesse: "Les scientifiques sont des personnages passionnants qui m’inspirent. Ils passent leur vie à se poser des questions essentielles. Pourquoi existons-nous ? De quoi sommes-nous faits ? Ils explorent chaque aspect de ce qui fait notre vie en espérant y trouver les réponses. J’aurais beaucoup aimé être un scientifique, mais je suis réalisateur, alors je fais des films à leur sujet", Mike Cahill - réalisateur. Le réalisateur connaît son sujet, c'est indéniable. Son film renvoie à ses interrogations, sa fascination pour la thématique et nous livre une véritable réflexion sur la condition de l'Homme. Peut-on réellement opposer science et foi? Cette vision dualiste a-t-elle encore un sens aujourd'hui? Ou n'est-elle que le vestige du XVIIe siècle? Quelle est la place de Dieu et de l'Homme dans nos sociétés actuelles? Mike Cahill traite un vaste sujet en donnant au spectateur des clés de réponse. Et au final, quelle est la vérité? Y-a-t-il seulement UNE vérité? Est-ce celle dont on se dote avec sa raison et ses croyances; avec sa foi? Le débat est ouvert... Je préfère laisser ici quelqu'un de plus sage que votre serviteur s'exprimer sur le sujet: "Voyez-vous, beaucoup de gens considèrent encore que la science et la religion sont en opposition. Si je suis d'accord pour dire que certains concepts religieux sont en conflit avec les faits et les principes scientifiques, je pense aussi que des individus de ces deux univers peuvent avoir un dialogue intelligent, un dialogue qui aurait en fin de compte le pouvoir de créer une compréhension plus approfondie des défis auxquels nous sommes confrontés ensemble dans notre univers d'interdépendance". Tenzin Gyatso Quant à la réalisation, celle-ci est sans faille et pleinement au service de l'histoire. Les acteurs sont parfaits de justesse et évoluent avec beaucoup d'aisance dans les méandres de ce film métaphysique, qui jamais, ne laissera le spectateur sur le bas côté. Les personnages principaux sont investis dans leurs rôles avec force et conviction. Nous sommes conquis! A ce propos, Astrid Bergès-Frisbey possède une particularité génétique rare qui sert justement le film: l’hétérochromie. Cela lui confère des iris de plusieurs couleurs. "Ses yeux dans le film n’ont subi aucun trucage d’aucune sorte. Ils associent naturellement des teintes de gris et de bleu tirant sur le vert. C’est très beau et spectaculaire et cela apporte encore plus au personnage." expliquera Mike Cahill. L'histoire, basée sur l'éternelle dualité science et foi; le jeu puissant des comédiens et la réalisation sans faille nous emmèneront dans un voyage spirituel où le doute est permis. Et avec lui, l'ouverture des possibles! C'est dans un état second que nous ressortons de la salle encore fébriles et songeurs. Bluffés par cette expérience cinématographique sur fond de métaphysique. Après avoir repris notre souffle, des pensées nous viennent; puis des interrogations. Beaucoup d'interrogations. Très vite, nous nous rappelons que le 7e art est un formidable canal qui permet de "sortir de nous-même", de prendre un peu de hauteur pour réfléchir sur nous, sur les autres et sur les relations qui nous unissent à eux dans la vie. Durée du film : 1h53 Genre : Drame, Science- Fiction Steven Knight est connu pour son travail de scénariste sur de nombreux films: Amazing Gace, Les recettes du bonheur, World War Z 2, etc. Pour Locke, Knight signe son premier film en tant que réalisateur et produit un long métrage brillant ! Résumé du film: L’histoire, très simple de prime abord, nous entraîne dans un huit clos intelligent et prenant. Ivan Locke, héros éponyme du long métrage, est un directeur de chantier très apprécié. Demain a lieu un des projets les plus importants de sa carrière et pourtant, un coup de fil vient interrompre son quotidien et rien ne se passera plus comme prévu. La journée est terminée et sa famille attend son retour pour assister à la diffusion du match de la saison à la télé mais Locke a un autre projet en tête : il doit se rendre à Londres au plus vite. Avis: Durant l’heure quinze du film, nous serons, en temps réel, passagers aux côtés de Tom Hardy, acteur remarquable dans ce rôle et vu, notamment, dans Inception, Quand vient la nuit et dans Mad Max : Fury Road. On assiste à la précipitation du héros dans ses retranchements, ses colères, ses introspections et ses choix difficiles au travers une multitude d’appels téléphoniques passés depuis son véhicule. Difficile d’en dire plus sans spoiler l’intrigue mais une chose est sûre Locke est une petite merveille d’interprétation et de réalisation dans ce genre. Sorti en DVD le 2 janvier dernier, on vous conseille de ne pas passer à côté! Un film passionnant à voir en VO bien évidemment ! Durée du film: 1h25 Genre: Drame Résumé du film : Walter Mitty est un homme ordinaire, enfermé dans son quotidien, qui n’ose s’évader qu’à travers des rêves à la fois drôles et extravagants. Mais confronté à une difficulté dans sa vie professionnelle, Walter doit trouver le courage de passer à l’action dans le monde réel. Il embarque alors dans un périple incroyable, pour vivre une aventure bien plus riche que tout ce qu’il aurait pu imaginer jusqu’ici. Et qui devrait changer sa vie à jamais. Avis : Sur papier, l'idée d'un homme qui voulait vivre ses rêves ou plutôt qui rêvait de vivre pleinement sa vie est tentante. Mais, qu'en est-il réellement? Peut-on transposer sur pellicule toute la folie d'un tel projet? La réponse est OUI et d'une bien belle façon. Suivez le guide.. Ben Stiller aux commandes d'un film ne nous a jamais laissé un souvenir impérissable: de "Tonnerre sous les tropiques" en passant par "Zoolander" et autre "Disjoncté"; ses films bien que plaisants à suivre ne sont rien en comparaison de sa dernière réalisation. C'est un peu comme si l'acteur/réalisateur avait trouvé l'équilibre entre le meilleur de son humour et le meilleur de sa sensibilité pour nous émouvoir, nous toucher et nous offrir un beau moment de cinéma. Il a mûri l'ami Ben et ça nous fait du bien. Entouré d'une pléiade d'acteurs aussi bons les uns que les autres, Ben Stiller entraîne avec lui ses partenaires de jeu dans sa vision héroïque d'un homme ordinaire vivant des situations extraordinaires. Mentions spéciales pour les actrices Kristen Wiig et Shirley MacLaine. La première incarne la collègue de Walter: douce, bienveillante et belle. L'actrice ne triche pas et nous livre une belle performance. Nous sommes sous le charme. Quant à la seconde, cette grande actrice incarne sa mère. Dans son regard se trouve tout l'amour d'une mère pour son fils, pas besoin de mots. Là encore, nous sommes conquis. Mais les hommes ne sont pas en reste. Il y a tout d'abord Adam Scott ("Frangin malgré eux", "Aviator", "Friends with kids") en patron stupide et arrogant; mais aussi une belle brochette de seconds rôles aussi truculents les uns que les autres: Adrian Martinez vu récemment dans "Casse-tête chinois"; l'inconnu Ólafur Darri Ólafsson qui crève l'écran en pilote d'hélicoptère complètement ivre et barré. Et surtout, Sean Penn qui nous offre le rôle d'un photographe de l'extrême à la fois mystérieux, intrépide et touchant; une sorte de Robert Capa catapulté dans notre temps. La réalisation sans faille est truffée d'éléments visuels agréables à l'oeil et sert parfaitement l'intrigue et l'extravagance du film. La bande son, sublime, rend hommage à David Bowie avec un Space Oddity réinterprété collant parfaitement à l'histoire. La thématique du film est intimement liée à la recherche de l'Amour, à la quête du Bonheur et à l'envie d'être un autre. Ou plutôt d'être soi mais en plus grand, plus fort, plus courageux, plus fou plus... plus. Ce film est un appel à retrouver ce qu'il y a de plus vivant en nous, de plus beau. La force de ce dernier est de nous révéler en filigrane ce que nous possédons mais que par peur, par pudeur, nous n'osons montrer et faire exister. Qui n'a jamais ardemment désiré projeter ses rêves et les ancrer dans le réel? C'est un peu comme si les rêves de Walter lui permettaient d'échapper quelques instants à son quotidien trop routinier. Les éléments anodins qui surviennent dans sa vie sont les éléments déclencheurs d'une sorte de madeleine de Proust de souvenirs et d'événements pas encore arrivés. Il y a Ben Stiller..Ce dernier a écrit ce rôle pour lui. Il n'a jamais été aussi touchant, "vrai" et drôle que dans ce rôle. Dans celui-ci, l'émotion passe par son regard. Son attitude humble et digne en toute circonstance. Il aime en secret, tout bas mais aimerait crier. Pardon, il aimerait CRIER. La projection des ses fantasmes seront le tremplin de son courage d'aimer et de vivre. Chapeau bas l'artiste. Et puis, il y a le spectateur. Lorsque je suis sorti de la projection, la pluie et le vent étaient de la partie. Aussi, la météo, loin de me peser, me ravivait et m'éclaircissait les idées. La vie rêvée de Walter Mitty agit en effet sur nous comme le ferait la pilule du bonheur. Elle nous réveille et nous (re)donne le goût de l'aventure et l'envie de donner le meilleur de nous-même. Ce film incarne un cheminement. De la (re)connaissance de Soi, nous allons vers les Autres. Alors, laissons nous porter par ces images et rêvons, agissons et aimons jusqu'au bout. Jusqu'à ce que notre cœur, notre corps et notre tête s'enflamment. Veuillez m'excuser, mais après cette expérience cinématographique il est plus que temps de vivre pleinement sa Vie. Durée du film :1h54 Genre : Comédie romantique Titre original : The Secret Life of Walter Mitty |
|