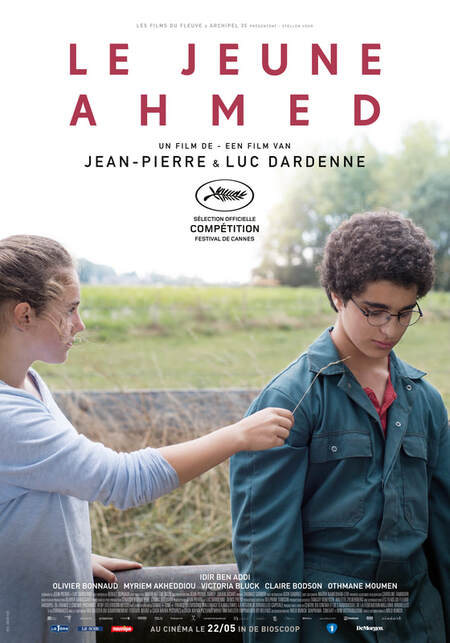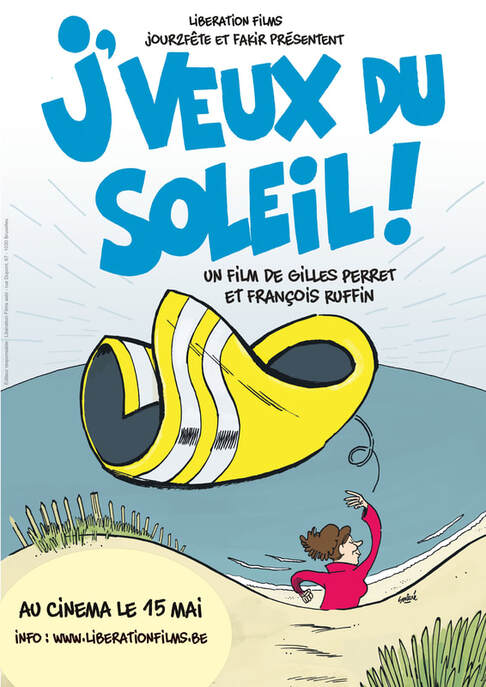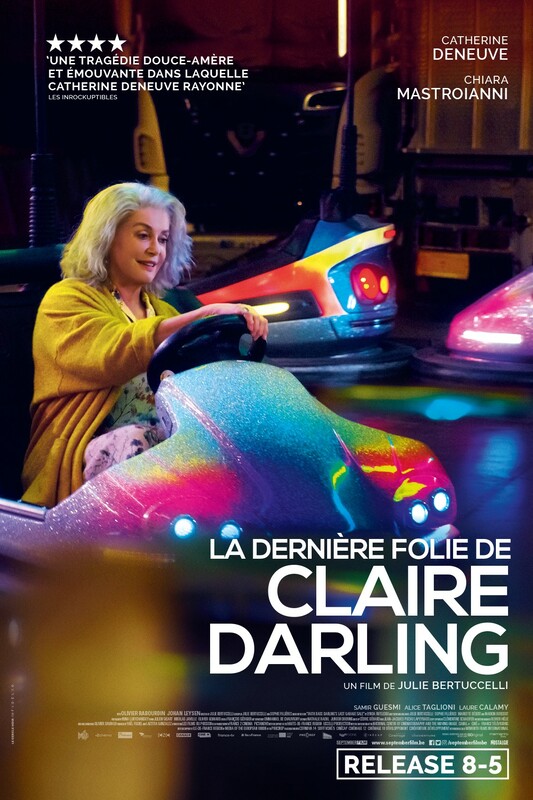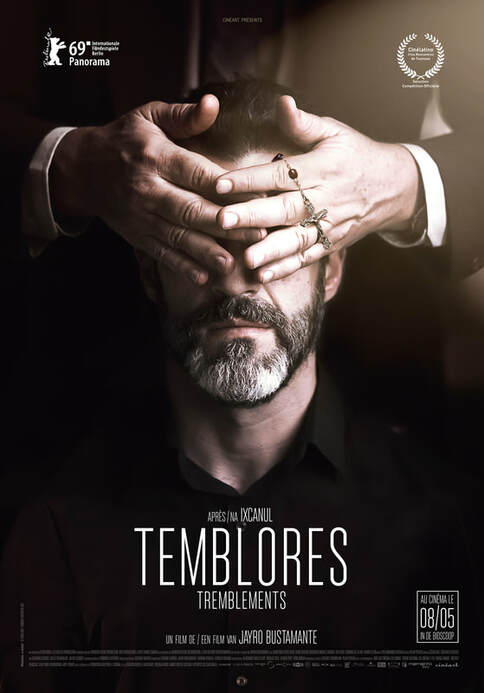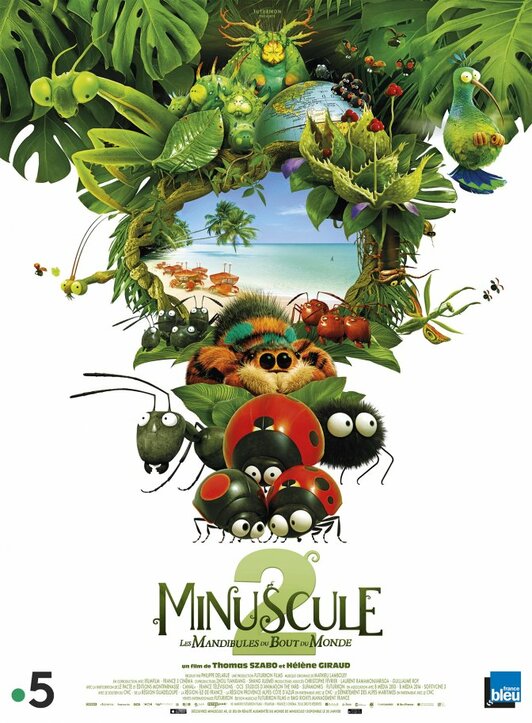|
Résumé du film : L'agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à une vague de monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra, Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah à trois têtes. Un combat sans précédent entre ces créatures considérées jusque-là comme chimériques menace d'éclater. Alors qu'elles cherchent toutes à dominer la planète, l'avenir même de l'humanité est en jeu… Note du film : 4/10 (par Véronique) Avis : S’il vous reste un chèque ciné près à périmer, un peu de temps libre et de l’énergie pour affronter des combats titanesques en veux-tu en voilà, vous pouvez vous risquer à entrer dans votre salle ciné pour 2h15 de lavage de cerveau. Si au contraire, vous aviez une quelconque mini exigence vis-à-vis de ce « Godzilla II », vous serez peut-être comme nous, totalement harassés par ce long-métrage poussif de Michael Dougherty. Bad freaks show Déjà mis en scène de nombreuses fois (35 pour être précis dont 3 réalisations issues des studios hollywoodiens), Godzilla se retrouve cette fois face à un ennemi disproportionné : Ghidorah (surnommé le Monstre Alpha). Cet hydre-dragon à trois têtes crachant des éclairs ne détruit pas seulement tout sur son passage, il appelle à la surface de la planète tous les Titans, autres monstres démesurés jadis dieux de la Terre. Ainsi, Mothra, Rodan et compagnie se joignent à la fête qui ne sera (malheureusement) pas de courte durée. Cris assourdissants, destructions massives, effets spéciaux qui piquent aux yeux ne manqueront pas de dynamiser un scénario ultra plat aux dialogues foutraques. Teinté d’humour risible, « Godzilla 2 : roi des monstres » est la suite du Godzilla de Gareth Edwards et la transition annonçant la venue sur les écrans de « Godzilla vs Kong ». Formant le triptyque du MonsterVerse, ces différents opus se succèdent mais se ressemblent peu. Rattrapant la frustration de ne pas avoir pu se régaler de la présence de Godzilla dans la version de Gareth Edwards, Dougherty sort l’artillerie lourde et présente non pas un mais plusieurs monstres de taille impressionnante. D’ailleurs, à les voir se dresser sur la toile, on se dit qu’il sera bien difficile de faire face à tout ce joyeux bazar monstrueux mais qu’importe, l’armée américaine et une série d’éminents savants tenteront de dompter, apprivoiser et mater ces créatures venues des temps anciens (ou d’ailleurs…) Un casting hétéroclite Là aussi, l’amertume est de rigueur. Affichant de grands noms d’univers très différents, « Godzilla 2 : roi des monstres » présente un panel d’acteurs aussi divers et variés que son bestiaire titanesque. Vera Farmiga (de la saga « The conjuring »), Kyle Chandler, Sally Hawkins (qui a déjà fréquenté d’autres monstres), Bradley Whitford, Thomas Middletich (le « comique » de service) et Ken Watanabe (déjà présent dans le premier « Godzilla ») nombreuses sont les têtes connues ou les acteurs montants de leur génération Anthony Ramos et O'Shea Jackson Jr pour ne citer qu’eux. Dans les autres figures populaire, on retrouve Millie Bobby Brown (qui sera à l’affiche de « Godzilla vs Kong ») toujours branchée larmes de crocodiles et cris de rage et désespoir, une jeune comédienne qui, après l’engouement de la série « Stranger Things » fait une entrée peu convaincante dans le monde du cinéma. Prévisible, le rôle de chacun n’est pas assez travaillé et on s’attache finalement peu à ces héros du jour que l’on espère vite libérés du pétrin dans lequel ils se sont embourbés, tout comme nous, pauvres spectateurs. Rien ne va plus Réalisé par Michael Dougherty, scénariste de « X-Men 2 », « Superman Returns » et… « X-Men : Apocalypse » (tout s’explique !) et réalisateur du film « Krampus », « Godzilla 2 : roi des monstres » dégouline d’effets spéciaux trop numérisés et donnerait presque la nausée à force de ballotter ses spectateurs dans tous les sens. Gros blockbuster peu intelligent, ce film de genre Kaiju-eiga (nom donné aux films de monstres japonais) en met plein la vue mais en oublie l’essentiel : garder un cap un tant soit peu crédible. Les raccourcis scénaristiques, les répliques grotesques et le revirement de situation de notre cher Godzilla, devenu l’allié des humains, ne finissent plus de se succéder, étirant à outrance une intrigue qui aurait gagné d’être raccourcie d’un gros tiers. Malgré quelques références bien senties aux différentes versions de Godzilla (de celle des années 1950 à celle d’il y a 4 ans), le film de Michael Dougherty et son monstre gentil de 120 mètres de haut ne parvient pas à nous concerner, pire, nous ferait fuir en jurant un peu tard, qu’on ne nous y prendrait plus. Usés par tant de folies furieuses, d’effets spéciaux et de bruits, nous sortant de la salle avec un goût amer et la sensation d’avoir perdu deux heures de notre temps. De mémoire, la dernière déconvenue du genre était « Batman V Superman » et nous n’en avons pas gardé un souvenir impérissable. Date de sortie en Belgique/France : 29 mai 2019 Durée du film : 2h12 Genre : Action/ Science-fiction Titre original : Godzilla: King of the Monsters
0 Commentaires
Résumé du film : « Rocketman » est une fantaisie musicale épique sur l'incroyable histoire humaine des années marquantes d'Elton John. Le film suit le voyage fantastique de la transformation du timide pianiste prodige Reginald Dwight en la superstar internationale Elton John. Note du film : 8/10 (par Véronique) Avis : Il a signé les plus beaux succès musicaux depuis les années 1970, a créé une identité de toute pièce et ravit des millions de fans du monde entier, se transformant en bête de scène à chaque concert. Mais derrière son pseudonyme populaire, Elton John n’a jamais cessé d’être un jeune homme solitaire, mal aimé par la majorité de son entourage qui voyait en lui la star mais pas l’homme blessé. Le film de Dexter Fletcher, « Rocketman », est l’occasion de découvrir le parcours fait de strass et de paillettes, de larmes de joie et de peine de Reginald Dwight. Bienvenue dans l’univers musical du fantasque génie de la pop rock anglaise. Don't Let the Sun Go Down on Me Après « Bohemian Rhapsody », « Blaze » ou encore « Walk the line », la lignée de biopics musicaux se poursuit, offrant des shows grandioses et des films plus intimistes aux curieux ou fans de la première heure. « Rocketman » se trouve quelque part entre ces deux univers. En proposant de suivre les pas d’Elton Hercules John dans ses premiers succès et sur ses premières grandes scènes, Dexter Fletcher (réalisateur de « Eddie the eagle » et remplaçant de Bryan Singer dans la dernière ligne droite de « Bohemian Rhapsody ») innove dans le genre en proposant une comédie musicale fantastique où composition de tubes et souvenirs s’entremêlent de façon presque onirique. Autant mettre en musique les mots de son auteur paraît facile, autant sa vie quotidienne semble, elle, bien compliquée : cocaïnomane, alcoolique, addict au sexe et au shopping, Elton John a brûlé la chandelle par les deux bouts, oscillant comme une bougie dans la tempête médiatique et populaire qui détruit tout sur son passage. I want love Rejeté par son père, rarement embrassé par sa mère (Bryce Dallas Howard), le petit Réginald n’a jamais été véritablement aimé et encouragé que par sa grand-mère, sa famille ne lui donnant jamais vraiment la place qui revient à celle d’un petit enfant. Se cherchant et se construisant une identité pour fuir un peu son passé, Elton John est parvenu à devenir une icône pop adulée mais toujours esseulée. Sa rencontre bouleversante avec Little Richard et la fondation du groupe Bluesology mais surtout celle de Bernie Taupin (son parolier et ami interprété avec conviction par le génial Jamie Bell) seront très probablement les pierres d’édifice d’une longue carrière faite de tubes indémodables. Our song Ces morceaux emblématiques (qui se compilent dans une très jolie bande originale), trouvent d’ailleurs leur place dans ce biopic (très) musical, les textes de Bernie Taupin étant contextualisé et de parfaits prétextes à quelques révélations touchantes ou émouvantes. C’est que « Rocketman » est une vraie comédie musicale, où chants, danses et musiques s’invitent très régulièrement dans un biopic fantastique pour le moins original. Sans repère chronologique certain, la ligne temporelle se définit au travers des morceaux choisis pour illustrer chaque étape de sa vie. S’il s’adresse à un public cible certain, le film de Dexter Fletcher vaut le détour dans nos salles pour la prestation bluffante de Taron Edgerton, showman incontesté. Revenant à un rôle plus dense qui lui sied à merveille (Dexter Fletcher l’avait déjà mis en scène de façon incroyable dans le très beau « Eddie the eagle »), l’acteur britannique de 29 ans (!) ne recule devant rien pour rendre son Elton John terriblement vivant. Et pourtant, au vu des premières images, on pouvait s’interroger sur ce choix, lui qui ne ressemble pas tant que cela à son modèle. Qu’importe, la performance est remarquable notamment grâce à une prestation vocale admirable ! Aidé par Elton John himself pour entrer dans son rôle, le comédien lui rend un incroyable hommage pudique et on ne peut plus appréciable. On est aimé par « Our song », entrainé par « Don’t breaking my heart » et, la gorge nouée, nous comprenons combien les textes et les rythmes de ses succès lui collent aussi bien à la peau. I'm Still Standing Et au-delà du casting investi et remarquable, on se doit de souligner l’incroyable réalisation, la minutie des décors et cet énorme souci du détail. Les costumes de scène d’Elton, l’enchaînement de ses souvenirs et les confidences du chanteur fragilisé apportent une pointe de nostalgie dans un arc en ciel coloré dans un récit biographique de deux heures où le temps se suspend le temps d’un instant. Rebondissant continuellement « Rocketman » est à l’image de son interprète qui, alcoolisé, drogué ou en plein spleen, a toujours su monter sur scène… du moins jusqu’au jour où Elton plaque tout, préférant reprendre sa vie en main plutôt que de continuer à se perdre en chemin… Instructif, touchant et dynamique, « Rocketman » est à voir pour toutes ses belles qualités qui occultent bien vite le manque de ressemblance entre Taron Edgerton et son modèle. Un Taron qui nous donne envie de nous procurer la bande originale du film (c’est à présent chose faite !) et de revivre, de façon musicale et fantastique, le parcours d’un homme qui n’a « su se faire aimer convenablement » que par le tard par David Furnish (producteur du film) ou par ses fans… Un film sans concession, qui n’occulte rien de la vie houleuse de son héros et qui assume totalement son style musical omniprésent. Date de sortie en Belgique/France : 29 mai 2019 Durée du film : 2h01 Genre : Biopic/Comédie musicale Résumé du film : La Famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père, un peu doux-dingue, fait vivre tout le monde dans une caravane, et la mère, Annie teint les cheveux de son fils Émile en blond, parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça ! Quand Pauline, la fille du lycée dont Émile est amoureux, l’invite à Venise pour les vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul problème, et de taille, les parents décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique... Note du film : 6/10 (par Véronique) Avis : A mi-chemin entre « Little Miss Sunshine » et « La vie est un long fleuve tranquille », parsemé d’un brin de « Tuche » attitude et de « Camping Paradis », « Venise n’est pas en Italie » est le cinquième long-métrage de l’écrivain et réalisateur Ivan Calbérac. Celui qui avait déjà signé « L’étudiante et Monsieur Henri », « Irène » ou encore « Une semaine sur deux » nous propose cette fois un petit road movie totalement absurde porté par Benoit Poelvoorde et Valérie Bonneton. S’il fera sourire ses spectateurs, le film a cependant du mal à tenir sur sa longueur et vaudra le détour si vous appréciez ses acteurs principaux et les petites comédies légères mais ensoleillées. Une caravane pour un petit Tour de France En adaptant son roman du même nom (qu’il avait déjà mis en scène au théâtre), Ivan Calbérac choisit de donner vie à Emile et sa famille avec un angle nouveau. Si nous n’avons pas lu le livre ni vu la pièce, nous entrons avec aucune appréhension dans son univers déjanté. C’est que la famille Chamodot est haute en couleurs et les parents, Bernard et Annie, très particuliers. Donnant lieu à des situations cocasses dont on s’amuse à diverses reprises, le quotidien de ce trio infernal donne d’emblée le ton et fait rire la salle à de nombreux moments. Mais lorsque Emile, le cadet de la famille très introverti, est invité par sa camarade de classe à la rejoindre pour un concert en Italie, il est loin de s’imaginer que sa tribu honteuse le suivra dans ses pérégrinations, ne lâchant jamais le petit rejeton. Heureusement pour lui, Emile (très juste Hélie Thonnat) pourra compter sur le soutien de son grand frère Fabrice (Eugène Marcuse, la révélation du film) et la bienveillance d’inconnus rencontrés sur la route. Maladroits, les parents d’Emile font pourtant tout leur possible pour accomplir leurs rêves et vivre dans une certaine harmonie. Qu’importent les on-dit et les moqueries, seuls comptent les moments passés en famille. Grandissant dans un environnement qui ne lui convient pas (et dont il a particulièrement honte), le jeune Emile préfère d’ailleurs dormir dans le garage d’une voisine que de partager le petit espace restreint de la caravane familiale. Sensible, timide et manquant de confiance en lui, le jeune adolescent est pourtant le chouchou de ses parents ringards qui n’hésitent pas une seule seconde à l’emmener auprès de sa douce Pauline. Benoit Poelvoorde est très touchant, Valérie Bonneton en fait des caisses mais on suit sans trop rechigner ce road movie délirant aux petits messages remplis de tendresse. Que retenir finalement de ce « Venise n’est pas en Italie » ? Sa bande originale sympathique et le tube « A.I.E » de la Compagnie Créole massacré par Benoit Poelvoorde ? Son jeune casting convaincant ? Sa douce folie sympathique malgré une réalisation trop classique ? Un peu de tout cela et on s’étonne d’ailleurs de garder un petit souvenir ému d’un final qui résume à lui-même toutes les (belles) intentions du réalisateur. Amusante mais pas tonitruante, cette comédie familiale plaira à un large public peu exigeant et se rangera davantage dans la case téléfilm que dans celle des sorties du mois. Date de sortie en Belgique/France : 29 mai 2019 Durée du film : 1h35 Genre : Comédie ► Quelques photos de l'avant première au Festival de Valenciennes Résumé du film : Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée, une comédienne fait appel à un sosie pour la remplacer sur son prochain tournage… sans se douter qu'il s'agit de sa propre soeur jumelle dont elle ignorait l'existence. Note du film: 6/10 (par Véronique) Avis : Réalisatrice de « Ange et Gabriel » (avec Isabelle Carré et Patrick Bruel) et des deux premières saisons de « Fais pas ci, fais pas ça », Anne Giafferi a déjà su faire souffler un vent de fraîcheur dans des comédies s’adressant à un large panel de (télé)spectateurs. Cette fois encore, la scénariste française a opté pour la légèreté pour mettre en scène un fait divers qui l’avait jadis bouleversé. En effet, « Ni une ni deux » est né de la vision d’un reportage qui montrait deux jumelles d’origine asiatique séparées à la naissance et adoptées par deux familles très différentes. Mais alors qu’elle aurait pu choisir de traiter ce sujet unique en surface, la réalisatrice a décidé d’installer son sujet dans le monde du cinéma dans lequel elle travaille depuis quelques années déjà. Sympathique sans être révolutionnaire, « Ni une ni deux » est la petite comédie sans prétention de cette période pré-estivale. Mathilde, puisque te v’la ! En confiant un double rôle principal à Mathilde Seigner, Anne Giafferi a choisi d’opposer ses deux héroïnes Julie et Laurette dans leurs caractères mais aussi dans leurs métiers. L’une est comédienne à succès, négociant difficilement un virage dans sa carrière, l’autre est une coiffeuse épanouie mais en quête de repères. La Mathilde rousse, les traits sévères et l’antipathie en bandoulière est l’exact opposé de la Mathilde blonde, guillerette et enthousiaste de découvrir un nouvel univers. Parfois clichés, les deux mondes des sœurs jumelles se rencontrent lorsque Julie, obsédée par son physique et son envie de continuer de tourner dans des films d’auteur, a recours à la chirurgie plastique. Défigurée par son intervention esthétique, la comédienne (aux faux airs de Isabelle Huppert) engagée pour un tournage n’a d’autre choix que de contacter son sosie parfait rencontré quelques jours plus tôt. Après une introduction plus vraie que nature sur les rançons de la gloire et la réalité des difficultés à continuer de négocier sa carrière cinématographique, le film prend un nouveau tournant et propose d’autres enjeux. Totalement prévisible, le scénario jongle malicieusement avec les quiproquos et, même s’il n’a pas la prétention de révolutionner la comédie française, a le mérite de laisser la place à de jolis seconds rôles portés par les efficaces François-Xavier Demaison (agent de Julie), Arié Elmaleh et Marie-Anne Chazel. Investie dans son interprétation, Mathilde Seigner convainc et parvient à donner vie à deux entités séparées dont les retrouvailles sont loin d’être gagnées. Solaire, la comédienne a toujours su s’imposer dans des rôles très différents et le fait ici encore avec beaucoup d’indulgence. Vous l’aurez compris, dans nos salles ce mercredi, « Ni une ni deux » est une alternative gentillette aux blockbusters du moment, un petit film léger porté par la sympathique Mathilde Seigner. Date de sortie en Belgique/France : 29 mai 2019 Durée du film : 1h38 Genre : Comédie Résumé du film : John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l’intérieur même de l’Hôtel Continental. "Excommunié", tous les services liés au Continental lui sont fermés et sa tête mise à prix. John se retrouve sans soutien, traqué par tous les plus dangereux tueurs du monde. Note du film : 9/10 (par François) Avis : Le John Wick nouveau est arrivé, et avec lui, une pluie de cadavres encore chauds ! Plus rythmé, plus intense, les superlatifs ne manquent pas lorsqu’on évoque le troisième film d’une saga qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, « The Continental » la série centrée sur le fameux hôtel s’apprête à être diffusé. A l’heure où vous lirez ces lignes, les recettes du film atteignent 57 millions en Amérique du Nord, coiffant ainsi sur le poteau le titan « Avengers: Endgame » ! Excusez du peu ! C’est encore dans un état fébrile que nous écrivons ces quelques lignes…Amateurs de films d’action décomplexés, voici l’empereur John ! « Si vis pacem, para bellum » Si tu veux la paix, prépare la guerre. La locution latine bien connue est on ne peut mieux choisie pour définir ce qui attend le spectateur pendant plus de 2h ! Se déroulant juste après la fin du deuxième film, nous retrouvons un John Wick excommunié, affaibli, avec une prime de 14 millions de dollars pesant lourdement sur sa tête ainsi qu’une armée de tueurs à gage à ses trousses ! Ne pensez pas reprendre votre souffle de sitôt car le rythme général et la dynamique des différentes scènes sont tout bonnement excellents ! Les combats, véritables chorégraphies d’arts martiaux, sont filmés avec maestria par le réalisateur Chad Stahelski déjà responsable des opus précédents ! Keanu, ce héros ! Ce qui nous interpelle fortement lorsqu’on évoque le film, c’est la performance absolument ahurissante de Keanu Reeves ! A 54 ans, l’acteur assure 98% des cascades à l’écran pour un résultat qui laisse sans voix. Bien sûr, l’acteur est un habitué du cinéma d’action (« Matrix », « 47 Ronins », etc.), il n’empêche… Sa préparation physique laisse admiratif. Afin de reprendre le rôle, Keanu Reeves s'est entraîné pendant cinq mois en arts martiaux (kung-fu, wushu, silat indonésien) et en maniement d'armes. A l’écran, nous n’avions jamais vu ça ! Dès les premières minutes, la tension est palpable dans ce chaos ambiant où notre héros est pourchassé par ses semblables. Sans aucun temps mort, le premier combat débute dans une explosion de violence parfaitement retranscrite à l’écran. Peu après, nous assistons ébahis à des affrontements de groupe qui subliment une chorégraphie millimétrée. Les styles de combats défilent pour s’adapter à la situation tout comme les nombreuses armes ou objets à portée de main. Mais le plus épatant étant la recherche de réalisme. Entendons-nous bien, les aptitudes surréalistes du personnage peuvent prêter à sourire mais ne gâchent en rien un plaisir de tous les instants. Les combats semblent tournés sans raccord de montage dans une danse frénétique. Les plans larges permettent de ne rien perdre de l’action ni des nombreux détails présents. De plus, l’occasion nous est donnée de profiter des voyages proposés par le réalisateur qui a installé sa caméra à New-York, à Marrakech et dans le Sahara. Et que dire des combats intégrant les animaux ? Le rendu de la scène montrant les chevaux est hallucinant. Quand la bagarre mêlant hommes et chiens survient, nous nous disons qu’une telle utilisation des canidés était jusqu’ici inédite. C’est bien simple, ce « jujitsu canin » nous a décroché la mâchoire ! A la lumière des événements décrits, il y a dans le personnage de Keanu Reeves, un peu des héros d’antan, de ceux qui possèdent une certaine droiture et semblent invulnérables. Casting chic pour effet(s) choc(s) Outre le plaisir de retrouver les « anciens » de la franchise (Ian McShane, Lance Reddick et Laurence Fishburne), l’univers s’étend et intègre de beaux personnages joués par des acteurs convaincants. On pense notamment à Anjelica Huston, Halle Berry, Asia Kate Dillon, Jason Mantzoukas et Mark Dacascos, lequel avait connu le succès dans les années 1990 avec « Crying Freeman ». Aussi, difficile de ne pas être amusé par la présence de l’acteur Jerome Flynn, qui jouait le rôle de Bronn dans la série « Game of Thrones ». Quand Parabellum rime avec péplum « John Wick Parabellum » est une œuvre résolument moderne qui rend hommage aux films de genre mais qui parvient à le transcender. Même si le ton se veut plus sérieux, l’humour est omniprésent et permet de détendre pas mal de situations extrêmement tendues. Résolument décomplexé et profitant de moyens colossaux, Parabellum s’inscrit brillamment dans une mythologie qu’il continue à façonner grâce à son univers étendu : le Continental de New-York mais aussi celui de Marrakech, le procédé d’excommunication, la Grande Table et l’adjudicatrice ne sont que quelques exemples d’un monde bouillonnant en proie à une hiérarchie extrêmement codifiée, violente...et fascinante. Même l’identité de John Wick y est davantage développée afin de mieux cerner le héros. Avec « John Wick Parabellum », Chad Stahelski nous livre un monument du film d’action et d’arts martiaux qui toise les plus grandes réussites du genre. Décomplexé et furieux, ce troisième volet continue à développer sa propre mythologie et le fait bien ! Ne revendiquant rien de plus que le plaisir pour le spectateur, John Wick semble gagner en invincibilité à chaque affrontement, à l’image des vrais héros d’autrefois. Date de sortie en Belgique/France : 22 mai 2019 Durée du film : 2h20 Genre : Action Résumé du film : Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais… Note du film : 7,5/10 (par François) Avis : Cette année 2019 est à marquer d’une pierre blanche pour la compagnie aux grandes oreilles ! A peine remis du « Dumbo » de Tim Burton et dans l’attente du « Roi Lion » de Jon Favreau, nous voyons déferler sur nos écrans l’adaptation d’un autre chef d’oeuvre qui a marqué toute une génération ! Aladdin dans l’imaginaire collectif, c’est avant tout un génie ultra marrant et terriblement attachant doublé par l’immense Robbin Williams. C’est également « Ce rêve bleu » que nous avons tous en tête. Mais c’est aussi Jafar ! Selon nous, un des méchants les plus réussis imaginé par Disney. Fourbe et ambigu, chacune de ses apparitions étaient soigneusement mise en scène pour nous fasciner. Le film « live » parvient-il à jouer ainsi avec nos émotions ? En partie oui, même si tout n’est pas parfait. Récit d’un rêve éveillé qu’on aurait voulu bleu. Du crayon à la pellicule, promesse tenue ? Au registre des satisfactions, la transposition de l’univers imaginé par Guy Ritchie se veut presque aussi éclatante que le dessin animé ! Les décors sont splendides et témoignent d’un réel souci du détail afin de ramener le spectateur en enfance. Le tournage d’ « Aladdin » s’est déroulé au Royaume-Unis, ainsi qu’au Royaume Hachémite de Jordanie afin d’apporter un cachet réaliste au désert puisque celui retenu est celui où fut tourné Lawrence d’Arabie. Où que se posent nos yeux, nous sommes enchanté du rendu à l’écran : la fameuse caverne est aussi effrayante que dans le dessin animé, le marché d’Agrabah vit, offre des couleurs vives et nous donne envie de flâner dans ses allées. Quant à la cité, elle a été construite en plein air sur une immense zone en quinze semaine pour un résultat extrêmement convaincant ! Oui, la magie opère toujours à Agrabah ! Carton rouge dans ce casting haut en couleur ! La question que tout le monde se pose probablement est de savoir si le génie incarné à l’écran par Will Smith tient la route ! On répondra sans ambages : oui ! L’acteur s’en donne à cœur joie et bien que n’arrivant pas à se défaire de son jeu (on reconnaît toujours le grand Will à l’écran), il le fait bien et nous amuse à chaque instant ! Ce génie-là est dans la mouvance de celui du dessin animé et sa folie est communicative ! D’ailleurs, on sent que Mena Massoud (qui incarne Aladdin) et lui se sont réellement amusés sur le plateau ! Le duo fonctionne en plein et nous pouvons même étendre les éloges au quatuor complété par Naomi Scott, parfaite en princesse Jasmine, et Nasim Pedrad qui joue sa servante. On prend plaisir à voir Aladdin faire la cour à Jasmine sans que cette dernière ne soit trop naïve ! C’est qu’entre 1992 et maintenant, il fallait creuser un peu les disparités des personnages afin qu’ils ne soient pas trop lisses et c’est une réussite ! Et que dire de la performance de Navid Negahban, parfait dans le rôle du Sultan ! Jadis, très ingénu (oserions-nous dire bête?), l’acteur parvient à insuffler à son rôle une épaisseur bienvenue ! Oui, nous savons ce que vous pensez et peut-être craignez en lisant ces lignes... Si tout va si bien, pourquoi un carton rouge ? C’est vrai que nous avions d’immenses attentes pour le personnage de Jafar. Ce personnage ambivalent, faussement serviable et en réalité fourbe et très inquiétant nous fascine ! Nous avons en souvenir ses entrées qui glaçaient le sang. Machiavélique, cette éminence grise manipule sans vergogne pour atteindre ses objectifs en évoluant dans l’ombre, patiemment. Son expérience de la vie politique explique son âge et sa stature élancée traduit son caractère diaboliquement rusé qui le fait craindre par beaucoup. Ici, nous ne comprenons pas pourquoi avoir choisi l’acteur Marwan Kenzari- âgé de 36 ans pour jouer le fameux Grand Vizir. Plus qu’une erreur, il s’agit d’une faute impardonnable pour peu que l’on apprécie le dessin animé ! L’acteur joue son personnage en restant dans une seule dimension et ne tire absolument pas parti du caractère complexe de Jafar. Gesticulant tout le temps, l’acteur fatigue plus qu’il n’effraie pire, exaspère plus qu’il ne fascine. Point de roublardise ici, juste une ambition bien trop grande à porter par ce jeu si peu consistant et beaucoup trop grossier. N’en jetons plus, le malheureux est déjà à terre...Nous espérons qu’il y restera longtemps encore. Quelle joie cela aurait été de voir un Gérard Darmon dans le rôle ! Amonbofils aurait été parfait avec un sceptre de cobra ! Hormis la piètre performance de celui dont on ne doit plus prononcer le nom et des ajouts de scènes chantées pour justifier les 2h09, tous les feux sont au vert pour cette sortie en famille réussie ! Bien que nous n’ayons pas été réceptif à la dimension « comédie musicale » de l’ensemble, nous avons pris bien du plaisir à voir et à écouter, une nouvelle fois, ce rêve bleu bien plus démesuré que nous ne l’avions imaginé. Date de sortie en Belgique/France : 22 mai 2019 Durée du film : 2h09 Genre : Aventure/Fantastique Résumé du film : Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d'écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients. Alors qu'elle cherche l'inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En plein tournage, elle est enceinte de l'acteur principal… qui est en couple avec la réalisatrice du film. Tandis qu'elle lui expose son dilemme passionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre secrètement. La parole de sa patiente nourrit son roman et la replonge dans le tourbillon de son passé. Quand Margot implore Sibyl de la rejoindre à Stromboli pour la fin du tournage, tout s'accélère à une allure vertigineuse… Note du film : 7,5/10 (par François) Avis : Présenté en compétition officielle du Festival de Cannes, « Sybil » est le dernier film de Justine Triet avec Virginie Efira dans le rôle titre. Après « Victoria », que vaut leur deuxième collaboration ? A la sortie du film, il est difficile de se prononcer tant on a besoin de temps pour intégrer ce que l’on vient de voir. Il n’empêche, nous retrouvons Virginie Efira dans un rôle très éloigné de son registre et cette audace est à saluer ! Comme un goût de série américaine… Selon l’avis même de la réalisatrice, « Sybil » est inspiré de la série « En Analyse » avec Gabriel Byrne : thérapeute compétent, attentionné et apaisant, dont la vie privée est un véritable désastre. Les points communs sont extrêmement nombreux avec la série à succès puisque le thérapeute lui-même consulte à son tour un confrère et continue à recevoir quelques patients qui l’aident également à y voir plus clair ! Dans le cas présent, Virginie Efira - Sybil- transgresse toutes les règles de déontologie afin de rédiger son livre en s’inspirant de la vie de ses patients. A cette première inspiration, la réalisatrice n’a pas oublié de regarder dans le rétroviseur et de puiser dans le cinéma de Woody Allen. On pense à son film « Une autre femme » datant de 1988. Là encore, l’héroïne qui cherche le calme et l’inspiration fait la rencontre d’une autre femme qui va perturber son existence. Dans « Sybil », il s’agit du personnage de Margot joué par Adèle Exarchopoulos. Cette dernière, au plus mal, demandera des conseils déterminants à Sybil. Tout le film se joue dans ces relations entre l’héroïne, sa vie privée et les quelques patients qu’elle continuera de suivre. Une vérité qui dérange Avec « Sybil », plusieurs thèmes sont imbriqués à la manière de poupées russes. L’importance des racines tient une place centrale dans la quête d’identité. L’héroïne jouée par une méconnaissable et stupéfiante Virginie Efira, évoluera dans l’intrigue en glissant doucement sur une pente dérangeante. Nous le disions, ses choix et son attitude vont la mener à beaucoup de malheur. Pour elle bien sûr, mais également pour ceux qui croiseront sa route. Miroir d’une certaine réalité, Sybil attire les problèmes et joue avec le feu au risque de se brûler. La performance de Virginie Efira, en personnage toxique, tient de la haute voltige tant elle incarne le personnage avec nuance et intelligence. Aucunement manichéenne, la psychologie de son personnage complexe est fascinante à suivre à l’écran. D’ailleurs des scènes osées sont de la partie, fruit d’une direction d’actrice exemplaire ! Justine Triet dit à ce propos : « Avec ce film, j’ai eu l’impression de découvrir d’autres visages de Virginie. Elle comprend tout ce que je cherche, ça va vite. La glace était brisée, j’ai osé tout lui demander, et elle m’a fait confiance. Elle s’est totalement abandonnée ». La réalisation sans faille semble suivre l’évolution des personnages et s’adapte aux errances de l’héroïne. D’ailleurs, une partie du film a été tourné en décors réels à Stromboli lorsque les évènements grondent et que la tension monte d’un cran… Le revers de la médaille pour le spectateur est l’impression de flou qui apparait assez vite. L’utilisation de flashback et le rôle parfois peu défini de certains proches de l’héroïne (on pense notamment à sa famille) brouillent le jeu de cartes. Paradoxalement, ce choix colle à la complexité de la vie de Sybil. En définitive, il nous est difficile de statuer sur ce film qui divisera sans doute mais ne laissera personne indifférent. Voyez ce film comme une expérience psychologique filmée avec beaucoup de réussite et portée par une Virginie Efira au top de son jeu. Date de sortie en Belgique : 29 mai 2019 Date de sortie en France : 24 mai 2019 Durée du film: 1h40 Genre : Drame psychologique Résumé du film : En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie. Note du film : 6/10 (par Véronique) Avis : Onzième long métrage des frères Dardenne, « Le jeune Ahmed » a, tradition oblige, lui aussi trouvé le chemin de la Croisette et est entré en lice pour la fameuse Palme d’Or. Evoquant la radicalisation, ce nouveau film trouve un sujet inédit dans l’univers des cinéastes mais n’oublie pas pour autant de s’ancrer dans une réalisation et des procédés propres au célèbre tandem. La proximité des personnages, l’entrée dans leur environnement proche, leurs ressentis et leur portrait brut permettent de cheminer au plus près d’eux tout comme le fait la caméra tremblante portée à l’épaule, parfait médium entre la fiction qui se joue sous nos yeux et nos réactions de spectateurs. Les gros plans scrutant les (absences d’) émotions des héros du jour, de ces comédiens en devenir choisis pour leur authenticité apportent toujours une vraie valeur ajoutée à ces portraits peints sur mesure par nos scénaristes et réalisateurs liégeois. Intéressant dans son approche, leur nouveau récit évoque la radicalisation d’un jeune musulman intégriste mais pas seulement… La relation aux autres et la famille sont à nouveau au centre de l’intrigue, autant que l’évolution inquiétante des émotions refoulées d’un ado en quête de repères. Dans les belles trouvailles thématiques, on note celle des réactions familiales face au comportement radical d’Ahmed (Idir Ben Addi), le désarroi de sa mère et les tensions qui se créent dans le foyer lorsque la radicalisation du fils gagne du terrain. Au contraire de « Layla M », le film de Luc et Jean-Pierre Dardenne montre le souhait personnel d’un adolescent de faire son propre Djihad et de prendre un peu trop à la lettre les propos de son Imam ou des sourates, s’influençant seul dans un choix de justice plus que douteux. Soldé par un échec, le jeune Ahmed qui est allé trop loin se voit privé de liberté et condamné à intégrer un centre fermé où les règles sont strictes mais le retour à la vie possible. Ce sont précisément les coulisses de ce centre et la découverte de l’autre et de soi qui marquent le film des célèbres frères. Très documenté, leur film aurait gagné à approfondir son sujet et enrichir sa narration, lui conférer un peu plus de dynamisme et raccourcir la distance entre le propos évoqué en surface et ses spectateurs. Suggérant la violence plus que l’étalant, le film entre pourtant peu à peu dans une spirale tendue où les non-dits cachent un drame latent. Lent comme souvent dans le cinéma des Dardenne, « Le jeune Ahmed » n’est peut-être pas leur meilleur métrage. La faute à un final trop expéditif et presqu’inachevé ? Au-delà de son portait sobre, le film a surtout le mérite d’(entre)ouvrir la porte d’un sujet délicat aux lendemains de nombreux attentats, événements qui ont provoqué une série d’amalgames et de préjugés tenaces que les frères ont judicieusement évités d’évoquer, préférant l’intime aux grands discours, un drame minimaliste, épuré et efficace, à la démonstration déshumanisée. Date de sortie en Belgique/France : 22 mai 2019 Durée du film : 1h24 Genre : Drame Résumé du film : Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à tourner. Note du film : 8/10 (par Véronique) Avis : Quel bonheur de retrouver Pedro Almodovar dans le cinéma qu’il lui sied le mieux. Celui des souvenirs, de ses émotions propres, celui qui se calque sur une vie qu’il a déjà mis en scène dans les touchants et émouvants « La mauvaise éducation » ou « La loi du désir ». Aussi flamboyant que « Volver », « Douleur et gloire » met en lumière deux comédiens qu’il affectionne et qui transcendent ses histoires originales par leur présence : Antonio Banderas et Penelope Cruz. Un film dense, intense et esthétiquement irréprochable, un de ceux qu’on se plait de contempler comme une œuvre d’art (cinématographique) signée par l’un des plus grands noms espagnols. Le miroir de l’âme Présenté à Cannes en Compétition officielle, « Douleur et gloire » est la sixième opportunité pour le cinéaste espagnol de soulever le petit écrin de la Palme d’Or tant convoitée. Après le remarquable « Tout sur ma mère », « Volver », « Etreintes brisées », « La Piel que habito » et « Julieta », Pedro Almodovar revient sur le devant d’une scène mythique au bord de la Méditerranée pour révéler une fiction (auto)biographique qui ne peut que plaire à ses fans de la première heure. Evoquant les épisodes de son enfance, ceux de son ascension, de ses premières amours et de son succès, son nouveau long-métrage puise bien évidemment dans les mémoires de cet incroyable artiste mais y injecte une belle dose de folie, d’éléments purement fictifs et dramaturgiques. S’il confie n’avoir jamais été addict à l’héroïne, le réalisateur a pourtant décidé d’utiliser la prise de drogue par son personnage principal comme prétexte aux songes d’une journée d’été passée aux côtés d’un comédien avec qui il partage une relative complicité. Humour, drame, mélancolie et charme font ainsi chavirer la frégate de Salvador, un metteur en scène populaire mais terriblement solitaire, un de ceux qui tente la traversée de la vie sans jamais parvenir à atteindre un rivage rassurant. Evoluant dans un appartement digne d’un musée contemporain impressionnant (une réplique parfaite de celui de Pedro Almodovar), notre héros cherche l’inspiration, le repos, le calme sans jamais parvenir à occulter un passé prégnant. Déjà évoquées dans d’autres œuvres de son créateur, ses racines, son enfance et l’importance de sa mère trouvent ici un nouvel écho percutant murmuré par un comédien trop absent et qui crève pourtant l’écran : Antonio Banderas. La démarche du comédien, sa coupe de cheveux, ses vêtements, son attitude générale ne sont pas sans nous rappeler celles d’un certain Pedro. « Toute ressemblance avec des personnes ayant existées n’est pas fortuite » disait l’adage… Avec ce nouveau métrage, nul doute que nous sommes ici dans un film testament, un petit bijou poli avec amour et livré avec une pudeur on ne peut plus touchante. Les couleurs chatoyantes de chacun de ses plans, la boucle temporelle ingénieuse dans laquelle il nous entraine font de ce « Dolor y gloria » l’un des meilleurs films du génie Almodovar depuis le « Volver » (sorti en 2006 !) On le mesure enfin pleinement après quelques films mineurs, celui qui aura 70 ans en septembre prochain n’a pas dit son dernier mot et n’ouvre qu’une porte vers cette belle mélancolie qui lui est chère et que nous ne nous lassons pas de découvrir dans des œuvres douces-(a)mères. Des personnages habités Si Antonio Banderas est à Pedro Almodovar ce qu’est Johnny Depp pour Tim Burton, il n’est pas le seul comédien fétiche du cinéaste de la nouvelle vague espagnole. Penelope Cruz est elle aussi une habituée et une actrice totalement transcendée lorsqu’il s’agit de se mettre au service des personnages du maître. Et parce qu’il aime profondément ses acteurs, Pedro Almodovar parvient à partager sa lumière sur chacun d’entre eux, à commencer par les « jeunes » acteurs Asier Flores (Salvador jeune) et César Vicente (le peintre en bâtiment) ou les charismatiques Leonardo Sbaraglia (comédien argentin magnétique) et Asier Etxeandia. Habités par leur histoire et par les rencontres avec notre cinéaste (pas si) fictif, les comédiens entrent tous dans la danse lente des souvenirs, des hasards de la vie, des déceptions et des espérances qui, non contents d’alimenter la plume d’un metteur en scène emblématique, subliment avec tendresse des instantanés de vie qui s’immortalisent de la plus belle des façons sur la pellicule. « Douleur et gloire », est un film magnifique, un de ceux qui prennent aux tripes et qui suspendent le temps un petit instant. Un long-métrage qui s’étale sur une toile qu’on ne quitte pas des yeux et qui nous font sortir de notre salle un petit peu plus heureux. Genre : Drame Durée du film : 1h52 Titre original : Dolor y gloria Résumé du film : C'est parti pour un road-movie dans la France d'aujourd'hui, à la rencontre des gilets jaunes ! Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent le pays: à chaque rond-point en jaune, c'est comme un paquet-surprise qu'on ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ? Des rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ? De l'art ou du désespoir ? Les deux compères nous offrent des tranches d'humanité, saisissent cet instant magique où des femmes et des hommes, d'habitude résignés, se dressent et se redressent, avec fierté, avec beauté, pour réclamer leur part de bonheur. Avis : Entre images d’archives télévisées et témoignages vérités, « J’veux du soleil », le nouveau documentaire de François Ruffin et Gilles Perret nous emmène sur les routes de France et plus précisément sur les ronds-points et aux péages de grandes étapes qui mènent du Nord au Sud de l’Hexagone. L’occasion de rencontrer Loïc, Marie, Corinne, Khaled, Natacha et bien d’autres qui, durant de longues semaines, ont fait vivre le mouvement des gilets jaunes. Caméra à l’épaule, les deux documentaristes décident de vérifier sur place ce que les gilets jaunes ont mis en place depuis de nombreux mois, dans leurs villes, leurs quartiers, leur état. D’Amiens à Dions, en passant par Mâcon, Annecy, Saint Julien du Serre, Loriol ou encore Corenc, les deux acolytes rencontrent des manifestants et leur donnent la parole (sans langue de bois), récoltant de nombreuses confidences faites face caméra. Au fil de cette grosse heure, on s’offusque de voir combien l’Etat français a pu fermer les yeux sur cette partie de la société qui a tout perdu, même leur dignité. Les témoignages (fragiles) de ces mères de famille, de ces intérimaires, de ces ouvriers ou de ces employés qui peinent à boucle leur fin de mois nous marquent au fer rouge. Et si un gilet jaune sommeille chez beaucoup d’entre nous, ces témoins privilégiés ont su le réveiller et le faire marcher… pour eux mais aussi pour tous les autres qui n’ont pas le courage ou l’opportunité de se mobiliser. Après trois semaines de rassemblement, ce sont des centaines de personnes qui ont, jour comme nuit, échangé, construit un avenir, réclamé la dignité qui leur a été enlevée. Ce droit de vivre, ils viennent le chercher dans le froid, durant des mois et des semaines, dans une relative organisation pacifiste stigmatisée par quelques médias et pas une frange de la classe politique. Niés par le Président, victimes des CRS, ces citoyens continuent pourtant de prendre la parole afin de lever un coin du voile sur une amère réalité. Les secrets, la honte et la colère de chacun ressort grâce à ce mouvement solidaire et ce qui a (trop) longtemps été caché apparait à la face du monde. La pénible survie des uns et les intimes convictions des autres, les lueurs d’espoir ou les déceptions grandissantes alimentent un documentaire où la fraternité qui s’organise autour des revendications occupe une place de choix. Les histoires, les vies et les instantanés livrés sans pudeur, sont ceux de n’importe qui… d’un peuple qui a mal au plus profond de sa démocratie et qui n’a besoin que d’une chose : être entendu et soutenu. A travers leur documentaire nécessaire, François Ruffin et Gilles Perret leur donnent la parole C’est au tour des spectateurs et des politiques de leur prêter leurs yeux et leurs oreilles et de leur permettre de croire que derrière les nuages se cache toujours un petit rayon de soleil. Date de sortie en Belgique : 15 mai 2019 Durée du film : 1h16 Genre : Documentaire Résumé du film : L'histoire se situe le premier jour de l’été et le dernier jour de Claire Darling. En tous cas, c’est bien ce dont elle est persuadée… Elle étale tous ses biens sur sa pelouse, de la pendule vestige de l'histoire de France à la multitude de lampes Tiffany. Tandis qu'une horde de curieux et de voisins s'arrache ces antiquités pour quelques centimes, chaque objet se fait l'écho de la vie tragique et flamboyante de Claire Darling. Note du film : 7/10 (par Véronique) Avis : Julie Bertuccelli nous propose depuis quelques années des documentaires et des fictions aux sujets variés mais avec une même constante : les présenter avec beaucoup d’humanité et une certaine sensibilité. Cette fois encore, la réalisatrice française nous propose un petit tour dans la vie de Claire Darling remplie de poésie. Quand le passé et le présent se fondent le temps d’un instant, on ne peut qu’apprécier l’exercice de style, et s’y perdre tendrement… Un trio de femmes exceptionnel Adapté du livre de Lynda Rutledge (« Le dernier vide-grenier de Faith Basse Darling »), le troisième long-métrage de Julie Bertuccelli nous raconte le dernier jour de la vie de Claire Darling, une vieille dame attachante qui vit entourée de nombreux objets accumulés au fil des années. Pour lâcher du lest dans son quotidien, pour libérer le poids du passé ravivé par ses nombreuses antiquités, Claire Darling organise un vide-grenier géant dans le jardin de sa belle propriété… L’occasion pour les curieux de faire de très bonnes affaires et aux précieux objets de trouver de nouveaux propriétaires. Interpellée par cette démarche étonnante, une brocanteuse du village (Laure Calamy) prévient Marie, la fille de Claire. Les deux femmes, qui ne se sont plus vues depuis de (trop) nombreuses années, vont peu à peu renouer un lien mais surtout faire table rase d’un passé qui les a fortement marquées. Réunissant à nouveau le duo mère/fille formé par Catherine Deneuve et Chiara Mastroiani, Julie Bertuccelli évoque les relations familiales compliquées, le poids des secrets, le besoin de se débarrasser des réminiscences des douleurs passées sans cesse ravivées par les Madeleines que sont les objets qui ont compté. Pour se faire, la cinéaste use de flashback qui, tels des fantômes, viennent prendre place dans un présent sur lequel se calque des moments issus du passé. Poétique et dramatique à la fois, cette vision onirique donne un relief à une histoire de famille qui pourrait sembler banale si la forme n’était pas à ce point si bien pensée. Alors que Catherine Deneuve trouve ici un rôle pudique et intense et sans aucun doute l’un des plus marquants de ces dernières années, Alice Taglioni offre elle aussi une prestation admirable en interprétant une Claire Darling jeune on ne peut plus crédible. Double presque parfait de la grande Catherine, l’actrice apporte un brin de gravité mais aussi de lumière dans une histoire familiale marquée par le deuil, sujet de prédilection de Julie Bertuccelli. La force du souvenir Avec ses petites touches fantaisistes et sa folie douce-amère, Julie Bertuccelli parvient à donner une belle originalité à une histoire qui se présenterait presque comme une comédie légère. Ses souvenirs joyeux ou dramatiques et les retrouvailles mélancoliques font de « La dernière folie de Claire Darling » un joli médium vers les souvenirs qui se ravivent et ouvrent la porte de notre réflexion sur la façon dont nous gérerions ce qui nous semble être le dernier jour de notre vie. Le vivrions-nous entourés de ce(ux) qui comptent ou voudrions-nous une totale liberté ? Partirions-nous l’esprit léger ou le cœur lourd ? Petite épopée fantastique sur le sens de notre vie, le scénario réécrit à quatre mains apporte une jolie délicatesse dans un film centré sur le pardon, la mort et la vieillesse. Date de sortie en Belgique : 8 mai 2019 Durée du film : 1h35 Genre : Comédie dramatique Résumé du film : Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même. Constatant qu’ils sont particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu unissent leurs forces dans une aventure palpitante pour résoudre cet insondable mystère. Note du film : 7/10 (par François) Avis : La folie Pokémon remonte à 1996. Le succès a été (et reste) fulgurant et couvre différents domaines : les jeux vidéo bien sûr, mais également le dessin animé ou encore un bon nombre de produits dérivés. « Pokémon détective Pikachu » est le quatrième film de la franchise à sortir sur nos écrans mais le premier à être réalisé avec des prises de vues réelles. Et il fallait du talent pour rendre crédible notre monde peuplé de Pokémon… le réalisateur Rob Letterman l’a fait ! Enquêtons sur ce tour de force ! Pokémon, attrapez-les tous…du regard ! N’appartenant pas à la génération Pokémon, nous nous sommes rendus en salle sans attente particulière mais avec une vraie curiosité. Nous trouvions la bande annonce prometteuse et le moins que l’on puisse dire, c’est que nous n’avons pas été déçus. Dès les premiers instants, nous trouvions nos repères dans un monde visuellement très risqué ! C’est qu’autant la cohabitation entre les humains et les Pokémon semble évidente dans l’histoire du film, autant le résultat à l’écran aurait pu en effrayer certains. Néanmoins, il suffit de regarder les premières images pour dissiper toute crainte. La transposition est très agréable et fonctionne pleinement ! Visuellement réussi, le film fait parfois penser à « Roger Rabbit » dans les relations réalistes qu’entretiennent les personnages « réels » et les Pokémon. Extrêmement bien réalisés, ceux-ci s’animent à l’écran et y apportent beaucoup de vie et de fantaisie. Notre regard est constamment sollicité et se ballade dans les différents plans afin d’apercevoir un maximum de ces créatures amusantes et attachantes. Pika Sherlock Bien qu’extrêmement classique, l’intrigue a le mérite d’être efficace et de commencer sans attendre. Afin de retrouver le policier Harry Goodman, son fils Tim (très spontané Justice Smith, vu dans « Jurassic World ») se lance à ses trousses en compagnie de Pikachu, son nouveau Pokémon de compagnie. Ensemble, ils mèneront l’enquête avec beaucoup d’humour ! D’ailleurs, le film -dans sa première partie- possède le charme des films des années 80-90 où des héros que tout oppose sont amenés à travailler ensemble dans l’esprit des « buddy movie ». Et cela fonctionne parfaitement ! Ce détective Pikachu possède une identité extrêmement forte. A l’image de la ville fictive où se déroule l’action (Ryme City), un soin tout particulier a été adressé aux lieux et aux décors. Visuellement très beau, la mégapole cosmopolite a des petits airs de New York et de Londres, mais aussi de Tokyo ! Cet ensemble très différent mais pourtant cohérent grouille de vie grâce à la cohabitation pacifique qu’entretiennent humains et Pokémon. Nous nous sommes beaucoup amusés de la scène avec le mime Pokémon, qui, à elle seule vaut le déplacement ! Hélas, le film, n’échappe pas à une seconde partie beaucoup plus convenue dont l’objectif est de nous en mettre plein la vue lorsque le rythme ne s’essouffle pas. La faute à cette volonté de tout vouloir expliquer à coup de flashback parfois inutiles et certainement trop redondants. Malgré quelques facilités afin de satisfaire un public jeune, cette adaptation grand public du célèbre jeu vidéo se veut extrêmement divertissante, bien réalisée et surtout attachante. Et c’est tout ce que nous pouvions espérer ! Date de sortie en Belgique/France : 8 mai 2019 Durée du film : 1h44 Genre : Aventure Résumé du film : Guatemala. Pablo, 40 ans, est un "homme comme il faut", religieux pratiquant, marié, père de deux enfants merveilleux. Quand il tombe amoureux de Francisco, sa famille et son Église décident de l’aider à se "soigner". Dieu aime peut- être les pécheurs, mais il déteste le péché. Note du film : 8/10 (par Véronique) Avis : « Temblores », c’est le deuxième film du réalisateur guatémaltèque Jayro Bustamante. C’est aussi la traduction latino des tremblements de terre qui frappent le pays mais aussi ceux qui déstabilisent la vie de Pablo. Ce sont les secousses qui effritent peu à peu la façade derrière laquelle ce bon père de famille s’est réfugié durant des années et qui laissent apparaître ce qu’il ressent au plus profond de son être. Une attirance pour un homme, Francisco, avec qui il partage l’amour passion et non l’amour raison prôné par sa famille et dans lequel il s’est engagé. Un interdit qu’il ne peut braver et qui sera sapé par l’autorité religieuse et la société bienpensante dans laquelle il évoluait jusqu’alors. Un film choc qui montre combien, aujourd’hui encore, les libertés individuelles peuvent être bafouées, jugées et dénoncées. Un film nécessaire et esthétiquement superbe. Un film sombre et anxiogène Pour qui n’aurait pas lu les quelques lignes du résumé, la surprise risque bien d’être de taille. En effet, les vingt premières minutes d’ouverture du film de Jayro Bustamante impressionnent autant qu’elles déstabilisent. Arrivé sous la pluie au volan de sa voiture, Pablo gagne la magnifique villa où vit sa petite famille. Mais dès que la porte d’entrée s’est refermée, c’est un poids, une atmosphère malsaine qui imprègne son domicile et notre découverte. Sa famille s’est réunie autour de son épouse, le visage fermé et grave, les traits impassibles, les mots fébriles et acérés à la fois. Quel drame s’est joué dans cette famille bien sous tous rapports ? Que reproche-t-on à Pablo, mal à l’aise devant ce conseil extraordinaire ? La vérité, c’est que Pablo aime un homme et bien plus que l’infidélité, c’est la honte qui secoue cette famille unie et interdite face à cet affront. Impensable, cette relation n’est pas seulement perçue comme toxique mais comme anormale, inhumaine, impensable. Prié de se ranger et de cesser cette folie, Pablo n’a d’autres choix que de fuir. Mais bien vite, ce père aimant se voit privé de ses enfants, l’amalgame entre homosexualité et pédophilie s’invitant dans les débats houleux du couple et le quarantenaire n’a pas d’autre choix s’il veut les resserrer dans ses bras, que suivre une thérapie menée par l’Eglise et retrouver la raison… Pesant, sombre et anxiogène, « Temblores » choisit de se fondre dans une réalisation intemporelle pour montrer à ses spectateurs combien notre société actuelle est finalement encore très archaïque dans ses propos. La photographie volontairement clair-obscur et les plans serrés accentuent le sentiment de carcan dans lequel Pablo se retrouve prisonnier. Si les spectateurs peuvent reprendre leur respiration et sortir la tête de l’eau, il n’en est pas de même pour notre héros aux côtés duquel on s’offusque et on souffre. Mené de main de maître par Juan Pablo Olyslager, le long-métrage à quelque chose de terrible et d’hypnotique à la fois. On cherche inlassablement une porte de sortie, un rai de lumière dans cette vie assombrie mais en vain… on sort de cette histoire le cœur serré et l’esprit marqué. Un drame sans mélo. Au-delà de son esthétisme de qualité et son histoire effroyablement documentée, ce qui fait de « Temblores » une vraie réussite, c’est sa capacité à ne jamais tomber dans le mélodrame uivant la même voie que « Boy Erased » de Joel Edgerton, le film de Jayro Bustamante évolue dans une certaine sobriété, ne tombant jamais dans le pathos malvenu et inapproprié. La dimension sociale de ce film presque documentaire déconcerte mais sublime le propos. Peut-on se sacrifier pour l’honneur des autres ? N’est-on pas, au XXIème siècle en droit d’aimer qui l’on souhaite ? Stigmatisé pour ce qu’il est et parce qu’il aime, Pablo est la preuve vivante que quelque soit sa classe et quelque soit sa place, l’individualité n’est acceptée que lorsqu’elle entre dans les bonnes cases, celles qui sont approuvées par la société. Troublant et suffocant, « Temblores » est un des films marquants de cette année, un de ceux qu’on n’est pas prêt d’oublier… Date de sortie en Belgique : 8 mai 2019 Date de sortie en France : 1 mai 2019 Durée du film : 1h47 Genre : Drame Résumé du film : Après avoir tenu des propos homophobes, Matthias Le Goff, vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner «Les Crevettes Pailletées», une équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel du monde. Le chemin parcouru sera l’occasion pour Matthias de découvrir un univers décalé qui va bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie. Note du film : 5/10 (par Véronique) Avis : Difficile de se prononcer sur le film « Les crevettes pailletées » tant rires et questionnement ont ponctué cette grosse heure trente de film totalement assumée. Tirée de l’expérience vécue par Cédric le Gallo, l’un des réalisateurs du film, l’histoire qui nous est contée nous semble totalement absurde et pourtant… Depuis 2012, Cédric le Gallo arpente les routes du monde entier aux côtés d’une équipe de water-polo gay, la pire au monde comme le montrent les archives du générique de fin. Quoi de plus normal dès lors que le cinéaste amateur prenne comme sujet central une expérience vécue de près. Dénonçant l’homophobie dans le sport, sujet encore tabou malgré une belle évolution dans le respect des libertés de chacun, « Les crevettes pailletées » se veut léger mais pas seulement. Derrière ses allures de comédie un peu lourdingue se cache un joli message de tolérance et de droit à la différence. Homo waterpolus Sportif de haut niveau au caractère bien trempé, Matthias Le Goff se voit condamner par sa fédération sportive à entrainer une équipe de water-polo gay. Si l’élément déclencheur est un peu grossier et la rencontre avec les fameuses Crevettes pailletées hyper clichée, on s’habitue peu à peu à l’univers déjanté mis en place par Cédric Le Gallo et Maxime Govare (« Toute première fois », « Daddy Cool »). Osé dans ses dialogues, le film ne s’adresse pas à tous les publics et encore moins aux jeunes spectateurs attirés par l’affiche colorée. Alignant à répétition les clichés et expressions peu distinguées, le long-métrage déçoit dans son approche trop crue et tellement stéréotypée. A en croire le point de vue présenté par les deux scénaristes/réalisateurs, les membres de l’équipe foncièrement gay ne se considèrent pas comme des sportifs (amateurs) très sérieux mais préfèrent s’exhiber, batifoler, mentir et s’adonner à une sexualité un peu dépravée plutôt que de s’entrainer. Néanmoins, si on décortique un peu les premiers aspects (parfois lourdingues) du film, on découvre que derrière cette comédie absurde se cache un message solidaire porté par une team subaquatique des plus sympathique. Assumant jusqu’au bout du slip leur rôle décalé, le casting se veut aussi hétéroclite que les caractères de nos différents protagonistes. En effet, outre le comédien belge Nicolas Gob, on retrouve Michaël Abiteboul et Alban Lenoir (déjà aperçu dans diverses réalisations françaises) mais aussi une panoplie de nouvelles têtes qui incarnent leurs personnages de façon attachante : David Baiot, Romain Lancry, Romain Brau, Roland Menou, Geoffrey Couët et enfin Pierre Samuel. Investis, les comédiens donnent vie à cette équipe de bras cassés aux parcours de vie délicats auxquels on s’attache et envers lesquels on ne peut que se prendre d’empathie. « Je préfère perdre avec mes amis que de gagner seul ». En confrontant un vice-champion à l’amateurisme, un héros taxé d’homophobie à un groupe de sportifs gay, le film amène la réflexion autour des ambitions et des priorités de chacun, du poids du regard des autres et de la difficulté d’exister avec sa propre sexualité. Si on prend la peine de regarder au-delà des apparences un peu pesantes et si on parvient à ne pas s’offusquer des quelques scènes un peu exagérées, on peut sans problème comprendre la démarche de ses réalisateurs. Mais malgré toutes les bonnes intentions proposées par l’équipe au grand complet, « Les crevettes pailletées » risque bien de laisser une partie de ses spectateurs dans les gradins et de foncer jusqu’aux Gay Games avec une légèreté une peu trop appuyée que pour être totalement apprécié. Date de sortie en Belgique/France : 8 mai 2019 Durée du film : 1h40 Genre : Comédie Résumé du film : A sa sortie de prison, Angel, 18 ans, retrouve sa jeune sœur Abby dans sa famille d’accueil à Philadelphie. Malgré leur profonde complicité, le drame qui les a séparées a laissé des traces. Avant de tourner la page, Angel sait qu’elle doit se confronter au passé et convainc Abby de l’accompagner dans son périple. Ensemble, elles prennent la route, sans mesurer ce que va provoquer chez elles ce retour aux sources. Note du film: 8,5/10 (par Véronique) Avis : Avec son émouvant film « Long way Home », Jordana Spiro a su mettre en lumière deux jeunes actrices de talent : Dominique Fishback et Tatum Marilyn Hall. Leurs sourires éclatants lors de la présentation du film étaient des petits soleils illuminant les visages de deux comédiennes capables de donner une intensité impressionnante à leurs personnages. Autre petit coup de cœur de cette compétition, le premier long-métrage de la réalisatrice new-yorkaise nous a noué la gorge d’émotion et bluffer par sa force d’interprétation. Durant une toute petite heure trente, nous suivons les errances de Angel, de sa sortie de prison pour détention d’arme à cette journée passée avec sa petite sœur Abigaïl, élevée dans une famille d’accueil où d’autres enfants perdus ont aussi trouvé un toit. Marquée par une enfance douloureuse et des violences morales et physiques, Angel cherche à se construire des repères et à remettre sa vie sur les rails mais son désir de venger la mort de sa mère, tuée par son père, semble plus forte que tous les projets qui s’offrent à elle. Malgré les mises en garde de son agent de probation (James McDaniel), Angel va prendre la tangente, et préférer la vendetta à la rédemption/reconstruction. Débrouillarde, solitaire et rebelle, la jeune femme tente de survivre comme elle peut, délaissée par ses amis pour qui la vie à continuer durant son absence. Mais elle peut compter sur l’amour inconditionnel de sa petite sœur de dix ans, Abby, extrêmement mature pour son jeune âge et tout aussi déterminée à ne pas se laisser faire. Ensemble, les deux sœurs se lancent dans un petit voyage qui les réunira et leur permettra d’échanger sur les émotions qu’elles gardent tout au fond d’elles depuis de trop nombreuses années. Jordana Spiro a mis longtemps pour mettre en scène son film, présenté au Festival de Sundance. Accueilli aussi chaleureusement que lors du Festival du Cinéma Américain de Deauville, « Long way Home » a en effet de nombreux arguments pour faire mouche. Une belle réalisation et une photographie appropriée, une histoire dense et deux comédiennes d’exception. Nous poursuivant des heures après sa projection, le film évoque non seulement une histoire de vengeance et l’amour sororal, mais aussi la survie d’adolescentes sans famille, si ce ne sont celles, nombreuses, qui les ont accueillies après de multiples reprises, le manque de repères et de schémas éducatifs (thème évoqué aussi dans « Friday’s Child » de A.J. Edwards présenté également cette année dans la compétition), ou encore l’accès aisé aux armes et ses dérives possibles. Si l’une est rongée par la vengeance et l’autre par le désir de vivre avec sa soeur, chacune de nos héroïnes voit la vie différemment, à son niveau, et cherchent des souvenirs communs, ceux qui rassurent ou qui reconnectent des vies passées loin l’une de l’autre. On croit à ce lien fort qui unit nos deux jeunes femmes, au point d’en oublier que ce ne sont que des rôles taillés pour un cinéma poignant, de ceux qui marqueront les esprits et viendront titiller nos émotions. « Long way Home » est un film indispensable, un long-métrage qui trouve toute sa place dans notre septième art et qui, on l’espère, trouvera sa voie vers une distribution plus large Date de sortie en Belgique: 8 mai 2019 Durée du film : 1h26 Genre : Drame Résumé du film : Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est palestinien et stagiaire sur le tournage de la série arabe à succès "Tel Aviv on Fire" ! Tous les matins, il traverse le même check-point pour aller travailler à Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter par Assi, un officier israélien, fan de la série, et pour s’en sortir, il prétend en être le scénariste. Pris à son propre piège, Salam va se voir imposer par Assi un nouveau scénario. Evidemment, rien ne se passera comme prévu. Note du film : 7/10 (par Véronique) Avis : Le conflit israélo-palestinien a déjà donné naissance à des films aux tons variés. Mais ce qui fonctionne le mieux pour évoquer la situation dans cette partie du Moyen-Orient, c’est incontestablement la comédie. Ludique et pédagogique, « Tel Aviv on fire » est une ouverture intéressante où la multiculturalité s’ancre dans son histoire principale autant que dans son casting. En effet, pour son deuxième long-métrage, Sameh Zoabi a fait appel à des acteurs palestiniens et israéliens, à la comédienne belge Lubna Azabal et injecte des dialogues en arabe. Illustrant à merveille le métissage et les tensions qui existent entre les deux communautés, « Tel Aviv on fire » à l’intelligence de reposer sur un sujet « léger » mais bien plus complexe qu’il n’y parait. Quand l’opéra soap s’invite au cinéma En s’ouvrant sur une version parodique d’un « Amour, gloire et beauté », « Tel Aviv on fire » (du nom de la série mise en scène dans le film), donne d’emblée le ton. Humour surréaliste, conflits d’intérêts et pression militaire vont s’inviter dans le scénario à double entrées du long-métrage récompensé à la Mostra de Venise (par le prix du meilleur acteur pour Kais Nashef), mais aussi au Festival d’Haïfa, de Saint-Jean-de-Luz et de la Comédie de Liège. Douce-amère, cette comédie met en abîme un conflit géopolitique à travers un média peu exploité au cinéma : le soap opéra. Dénigré par toute une frange de la population, ce genre est pourtant très apprécié dans une partie du Moyen-Orient. Le réalisateur explique d’ailleurs qu’il regardait un feuilleton avec sa mère quand l’idée lui est venue. « Je me suis mis à rire à un moment où je ne devais pas, c’était à cause des excès de mise en scène et du jeu des comédiens, ma mère, elle, a sorti son mouchoir et s’est mise à pleurer. Cette expérience m’a inspiré au moment d’écrire et de réaliser le film ». Et cela fonctionne ! En nous faisant suivre les pérégrinations d’un assistant de plateau devenu scénariste, Sameh Zoabi pointe du doigt l’absurdité de deux communautés qui, vivant à quelques kilomètres l’une de l’autre, continuent de s’opposer année après année. Salam et Assi, Doublepatte et Patachon Salam (Kais Nashef), le héros de « Tel Aviv on Fire » n’a, dans un premier temps, rien de folichon. Plutôt banal, cet habitant de Jérusalem est en standby dans sa vie amoureuse et professionnelle. Mais lorsqu’il accepte un poste d’assistant dans la boite télévisée de son oncle du côté de Ramallah (en Palestine), le jeune homme ne se doute pas que sa vie va non seulement évoluer mais qu’il est à deux doigts de provoquer un incident diplomatique télévisé. Traversant chaque jour le checkpoint du Commandant Assi (Yaniv Biton), Salam va se trouver confronté à un curieux dilemme : accepter de faire entrer les idées du militaire (dont la femme est fan de la série) dans ses scénarios ou poursuivre la ligne installée par la série et appréciée dans de nombreux foyers. La tension politique entre Israël et la Palestine peut-elle être attisée par « ses » écrits ? Salam, contraint de satisfaire le responsable du checkpoint, va le découvrir à ses dépens. Belle entrée en matière pour évoquer les tensions qui animent les communautés israélienne et palestinienne, « Tel Aviv on fire » croisent deux histoires de façon subtile tout en introduisant des thèmes plus personnels. Il évoque la liberté d’écriture, la difficulté de vivre à la frontière, de trouver l’inspiration et de contenter les aficionados d’une série kitsch et légère mais si importante pour toute une frange de la société. En quittant peu à peu la comédie pure pour entrer dans des sujets plus denses, « Tel Aviv on fire » parvient à négocier un virage en douceur et à surprendre ses spectateurs. Date de sortie en Belgique : 1er mai 2019 Durée du film : 1h37 Genre : Comédie Résumé du film : Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins... Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues. Les enfants ont grandi, d’autres sont nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités... Les séparations, les accidents de la vie... Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ? Note du film : 6/10 (par Véronique) Avis : Sixième long métrage de Guillaume Canet, « Nous finirons ensemble » est la suite directe des « Petits mouchoirs » sorti 9 ans plus tôt. Entre les deux, le réalisateur français s’est cherché dans un thriller (revisitant les « Liens du sang » de Jacques Maillot) intitulé « Blood Ties » et une comédie très « Rock’n Roll ». Fort de son succès d’antan (et pour renouer avec le succès), Guillaume Canet nous invite à retrouver sa bande de potes dans le bassin d’Arcachon. Ils ont changé, grandi, muri mais finalement, « Nous finirons ensemble » ne parvient pas à s’imposer comme un très bon film choral. Le délire entre amis a sans doute permis à cette joyeuse bande de passer quelques jours de tournage sympathique mais le résultat est on ne peut plus décevant et le surjeu des comédiens bien trop pesant… Max et la menace de la soixantaine Divorcé, en proie à des soucis financiers et irascible comme jamais, Max vient chercher un peu de tranquillité dans sa maison du Cap Ferret à l’aube de ses 60 ans. Alors qu’il négocie ce cap avec beaucoup de difficultés et qu’il s’apprête à mettre en vente ce petit coin de paradis où se sont construits de mémorables souvenirs, Max reçoit la visite de ses amis, qu’il n’a plus vu depuis un bout de temps. La tension avec Eric (Gilles Lellouche) est plus que palpable, Marie (Marion Cotillard) est dépassée par sa vie de mère célibataire, Vincent (Benoit Magimel) file le parfait amour avec Alex, un ancien danseur de ballet, Antoine (Laurent Lafitte) a toujours la naïveté d’un enfant dans un corps d’adulte et Isabelle (Pascale Arbillot) enchaine les plans Tinder en toute décontraction. On l’a très vite compris, les choses ont bien changé depuis l’enterrement de Ludo, toujours présent dans le cœur de cette joyeuse bande et les comparses de toujours se sont donnés le mot et ont libéré une semaine de leur vie chargée pour fêter leur ami Max chez qui ils ont toujours trouvé un refuge iodé. Mais comment peut-on faire face au passé et à ceux qui nous renvoient sans cesse à la vie qui s’est écoulée lorsque sa vie est au point mort ? Max, au bout du rouleau, va pourtant devoir faire avec ses coriaces invités et affronter quelques moments de vérité… Tout comme dans les « Petits mouchoirs », le personnage de François Cluzet se démarque du casting et tient clairement le haut du pavé. Dépressif, colérique et fier, Max vit des hauts et des bas, se réjouit de cette présence chaleureuse autant qu’il la rejette. Toujours ultra précis dans l’interprétation de ses émotions, le comédien retrouve un rôle qui lui sied à merveille. Pareil pour Laurent Lafitte qui n’a pas son pareil pour jouer un homme-enfant résolument optimiste et on ne peut plus naïf. Pour le reste, c’est tout autre chose. Aucun des acteurs ne semble pouvoir s’effacer derrière les traits de son personnage, surjouant comme au théâtre et tirant à lui la couverture sans craindre de ne découvrir les autres. Les sentiments sont à peine crédibles, l’histoire cousue de fil blanc, bref, on ne trouve aucun autre intérêt que celui de retrouver une sympathique bande de comédiens bien moins efficace que celle du Splendid. Nous finirons bien par nous en lasser… Le problème majeur du film est, comme bien souvent dans ceux de Guillaume Canet, sa longueur excessive. Si on ne doute pas une seule seconde que les rush sont nombreux et que le montage a été laborieux, on regrette à nouveau un manque de simplicité dans les récits originaux du comédien/réalisateur. Les fans de la première heure se délecteront des petits rebondissements, souriant à pleines dents face aux situations successives alors que les simples curieux attendront avec soulagement un épilogue larmoyant… et usant des mêmes ficelles que son opus précédent. Qu’est-ce qui a changé ces dix dernières années ? Peu de chose finalement… on retrouve exactement ce qui a fonctionné dans le premier volet et même si les destinées sont différentes, rien n’a véritablement évolué. « Nous finirons ensemble » avait-il un intérêt quelconque ? La réponse est plutôt mitigée. Oui, si nous voulions retrouver le casting de la première heure (augmentée par l’apparition de personnages somme toute totalement dispensables) et nous délecter d’une bande originale de qualité. Non car, même si c’est dans les vieilles marmites que l’on fait les meilleures soupes, on aurait aimé découvrir une gastronomie plus raffinée et ne pas suivre le même menu de plats réchauffés… Date de sortie en Belgique : 1er mai 2019 Durée du film : 2h15 Genre : Comédie Résumé du film : Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : « Le Palais idéal ». Note du film : 8/10 (par Véronique) Avis : Tous ceux qui se sont déjà rendus dans la Drôme et dans le petit village de Hauterives savent ce qu’est « Le Palais idéal ». Pour les autres, ce sont trois mots qui résonnent comme une invitation à découvrir un lieu apparemment incontournable. Et de fait ! Mais au-delà de l’incroyable architecture qui s’est installée sur les hauteurs de la vallée de la Galaure, c’est l’histoire d’un homme qui, jour après jour, nuit après nuit, a sculpté de ses mains et durant 33 ans, une œuvre inédite pour sa fille. Nils Tavernier nous conte cette aventure hors norme dans son dernier-long métrage « L’incroyable histoire du facteur Cheval » et vous propose de vous faire un joli petit voyage en compagnie d’un casting admirable. Une belle histoire d’amour(s) On ne saura jamais ce qui a animé durant tant d’années la volonté et la ténacité de Ferdinand Joseph Cheval. Mais ce qui crève l’écran, c’est l’amour pudique qui grandit peu à peu dans une famille régulièrement touché par le drame. Veuf et privé de son fils, Joseph se remarie avec Philomène, une jeune femme douce et rassurante. Avec elle, il s’ouvre peu à peu au monde et découvre le bonheur de la paternité lorsque nait la petite Alice. Celui qui n’a jamais su exprimer ses émotions, ses joies ou ses peines est transcendé par l’amour de ces deux femmes entrées à pas de loup de sa vie. Un amour moteur qui l’aide à parcourir la trentaine de kilomètres et qui l’emmène de villages en garrigue dans une nature qui l’apaise. Mais après avoir buté sur une pierre et évité une impressionnante chute, Joseph se met en tête de construire un palais à sa princesse… Sculptant de ses mains le ciment et imbriquant une multitude de petites pierres, Joseph va donner forme à un immense palais. Ne cessant jamais d’y ajouter des formes mythologiques, animales ou des citations, comblant chaque petit vide et augmentant sa taille année après année, Joseph construit une des plus impressionnantes œuvres naïves, classée depuis quelques années dans la liste des Monuments Historiques. Qu’importe les railleries du village, Joseph est fier de sa création, tout comme Alice et Philomène qui le soutiennent bon gré mal gré dans sa tâche. Introverti comme toujours, Joseph exprime dans ces formes tout l’amour qu’il n’a jamais su mettre en mots. Et les regards bienveillants et tendres de sa petite famille l’accompagnent à la lueur crépuscule ou d’une bougie vacillante. Véritable histoire d’amour sincère, « L’incroyable histoire du facteur Cheval » est un film solaire qui fait véritablement du bien et qui montre que la vie, c’est aussi savoir se contenter d’un rien. Jacques Gamblin et Laetitia Casta, un couplé idéal Touchant dans de nombreux rôles, Jacques Gamblin trouve ici un personnage qui lui sied à merveille et permet d’explorer une série d’émotions intériorisées qui touchent en plein cœur. Son regard, son mutisme et sa maladresse font vibrer notre corde sensible et ne cessent de nous emporter dans la valse silencieuse d’une partition jouée sans fausse note. Totalement habité par ce Joseph Cheval plus vrai que nature, il excelle dans l’incapacité d’exprimer les émotions de son personnage et nous bouleverse lorsqu’il hurle son malheur. On aime le voir vieillir, s’ouvrir à la vie, découvrir ses premiers sourires et applaudit sa performance toute en retenue et tellement bienvenue. Face à lui, une Laetitia Casta tout aussi admirable. Et pourtant, il ne doit pas être facile de vivre à côté de ce personnage « illuminé » mais tellement authentique. Elle accepte les maladresses et les folies de son époux, l’encourage et l’épaule sans jamais le juger. La comédienne est présente dans l’ombre mais parvient tout à fait à capter la lumière, lui conférant une place de choix dans cette histoire délicate… et dans sa carrière. A deux, ils parviennent à faire vivre un amour inconditionnel et sincère, à nous faire croire à ce couple qui traverse les épreuves main dans la main et qui se respecte tant. Excessivement touchants, ils font de « L’incroyable histoire du facteur Cheval », un film dont on se souviendra longtemps ! Date de sortie en Belgique : 1er mai 2019 Durée du film : 1h45 Genre : Drame Résumé du film : Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils à temps ? Note du film : 6/10 (par Véronique) Avis : Cinq ans après la première version longue des aventures de « Minuscule » sur nos grands écrans, Hélène Giraud et Thomas Szabo remettent le couvert et nous proposent de nous replonger dans l’univers microscopique de nos insectes préférés. Mais cette fois, ce n’est pas une lutte entre fourmis rouges et noires qui occupent le centre du récit mais un voyage lointain dans la faune et la flore guadeloupéenne. Un amour de coccinelle(s) Dans ce nouveau volet de « Minuscule », on retrouve nos héros de la première heure : la coccinelle devenue papa, la fourmi noire et l’araignée. Nos trois amis qui passaient un hiver pépère dans leur petite vallée se voient embarquer à l’autre bout du monde lorsque bébé coccinelle se retrouve piégée dans un colis à destination de la Guadeloupe. Son instinct paternel étant plus fort que tout, Coccinelle monte à bord du cargo pour sauver son rejeton. Et c’est là que commence la folle aventure de nos deux petites bêtes à bon-dieu. Alors que l’on préférait nettement la découverte de notre environnement et de notre microcosme local, « Minuscule 2 : les mandibules du bout du monde », s’ancre bien dans un univers plus tropical, où mante religieuse, mygale et autres espèces plus impressionnantes rencontrent nos deux héros du jour. Cette nouvelle approche permet alors de développer la psychologie de nos petits insectes et de leurs donner des émotions humaines, bien plus marquées que dans le long-métrage précédent. Mais à côté de cela, on regrette l’abondance de gags moins adaptés au sujet initial et clairement destinés à un jeune public amusé (on pense à l’araignée devenue capitaine d’un navire en partance pour les îles où elle et son amie la fourmi noire vont secourir nos deux coléoptères). Même s’ils n’ont rien perdu de leur créativité, le duo Giraud/Szabo négocie un nouveau tournant qui nous a paru un peu moins pertinent malgré quelques belles valeurs présentées à l’écran comme l’acceptation de l’autre, la solidarité face au danger, l’amour, la famille et l’unité Une animation augmentée Récompensé par le César du Meilleur Film d’Animation en 2014, « Minuscule » ne se cantonne pas dans son savoir-faire et ose proposer un univers scénaristique et esthétique différent dans son nouvel épisode cinématographique. En effet, en rencontrant les humains et en évoluant dans un village français ou guadeloupéen, nos petits insectes se trouvent confronter à un monde qu’ils connaissaient peu jusqu’ici. De ce fait, « Minuscule 2 » innove dans sa façon d’aborder l’animation et allie images de synthèse et prises de vue réelles. Si cela fonctionne sur l’écran, on s’étonne d’avoir opté pour ce choix d’intégrer des humains dans une histoire qui aurait très bien pu faire sans. La conception graphique est belle et soignée mais le bât blesse dans son récit un peu trop alambiqué où se mêlent différentes intrigues. Estampillé bleu blanc rouge de son générique de début à son clap de fin, « Minuscule 2 : les mandibules du bout du monde » est une suite sympathique (bien que compréhensible sans avoir vu le précédent film) qui plaira aux plus petits spectateurs. Un chouilla décevant, nous lui préférons nettement « La vallée des fourmis » et sa série télévisée mais admettons qu’au niveau graphique et esthétique, l’équipe de Hélène Giraud et Thomas Szabo continue à maintenir la barre très haut. Date de sortie en Belgique : 1er mai 2019 Durée du film : 1h32 Genre : Animation |