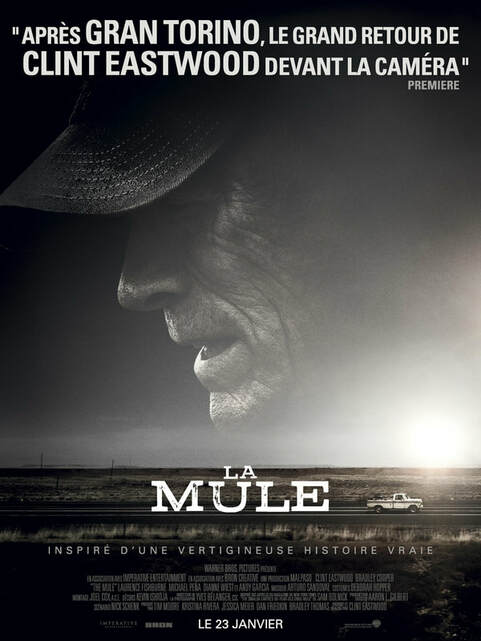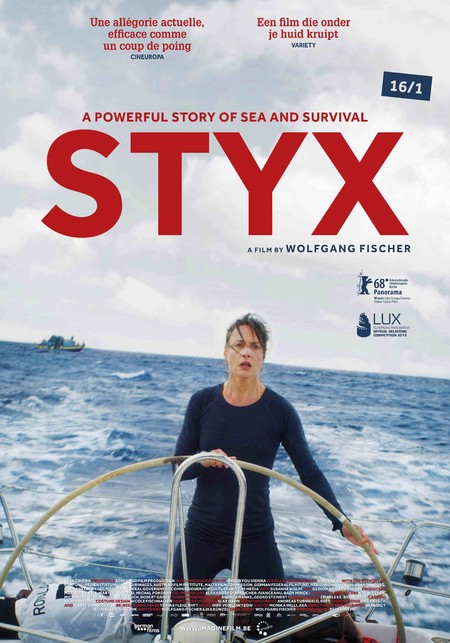|
Résumé du film : Un héritage attend, un pouvoir mortel s’éveille : le légendaire Super Saiyajin Broly est là ! Goku et ses amis feront face à leur plus dangereux défi à ce jour lorsqu’ils feront l’expérience de la puissance et de la force de Broly : seront-ils assez forts pour protéger leur maison ou élimineront-ils tout et tous ceux qui doivent affronter cette force inébranlable ? Note du film : 7/10 (par François) Avis : C’est fou ce que le temps passe ! La dernière fois que nous nous sommes aventuré au cinéma pour voir un épisode de Dragon Ball, c’était en 1995 pour le film « Dragon ball Z : Fusions » avec le grand méchant « Janemba ». En 2019, la célèbre franchise continue de déferler sur nos écrans avec encore plus de réussite ! Au moment où vous lisez ces lignes, le film a déjà remporté 98,8 millions de dollars dans le monde ! Pour autant, ces chiffres attestent-ils d’un film hautement qualitatif ou est-il la résultante d’un prodigieux bouche à oreille porté par les fans de Son Goku ? Nous sommes tenté de vous répondre que nous nous situons sans doute à la croisée de ces deux chemins. Une formule magique : KA ME HA ME HAAAAAAAAA Avis aux fans de Goku ! Beaucoup d’épisodes que vous avez pu voir dans le passé et mettant en scène Broly, un des méchants les plus charismatiques et puissants qui soit n’étaient pas « canon ». Cela veut dire que tout ce qui a été dit auparavant n’est pas reconnu officiellement par le créateur de la série Akira Toriyama. Ici, Broly est enfin adoubé, et il en va de même pour Baddack le père de Son Goku. Et c’est justement un élément qui pourrait interpeller les fans de la première heure car il leur faudra mettre de côté tout ce qu’ils savaient sur ces personnages. Heureusement, les points communs sont les plus nombreux mais quelques bonnes idées ont, hélas, été mises de côté pour les besoins du film. La grande force de ce « Dragon Ball Super: Broly » est à chercher du côté du scénario ! Quelle belle idée de porter à l’écran l’histoire des Saiyens de l’espace ! C’est, de notre point de vue, la mythologie la plus intéressante de la saga. Ce peuple de conquérants qui a dû ployer le genou devant la toute puissance du père de Freezer, le roi Zorg avant d’être décimé par Freezer en personne possède en elle les germes d’un véritable drame. Et que dire de l’histoire de Broly et de celle de son père Paragus qui ont dû fuir sur une planète hostile car rejetés par les leurs? Là encore, il y a quelque chose de terriblement universel là-dedans. Akira Toriyama parvient à rendre Broly humain et nous comprenons la violence qui est en lui de part les agissements de son père. Afin de contrôler la puissance exponentielle de Broly et ses sautes d’humeur, Paragus a placé, autour du cou de son fils, un puissant collier électrique...Glaçant. Des coups de crayons un peu brouillons Voilà la principale faiblesse de ce pourtant très sympathique film d’animation ! La qualité du dessin est très inégale. De somptueux paysages côtoient des personnages aux traits grossiers. Les mains par exemples ne sont pas toujours bien rendues. Ce constat est d’autant plus alarmant que les films précédents, ceux des années 90’, nous apparaissaient très beaux techniquement. Et que dire de l’utilisation des effets numériques qui bien que renforçant la profondeur de champ, apportent un résultat hybride assez étrange. Nous ne sommes donc pas convaincus par ce choix artistique qui dégrade assez rapidement le plaisir des yeux. Sur un scénario du génial créateur de la licence Akira Toriyama, « Dragon Ball Super » s’inscrit dans la ligne droite de la série en cours de diffusion et permet d’officialiser des personnages que les fans apprécient ! Quant aux autres, ils apprécieront l’action et les combats frénétiques de ce nouvel opus. Souffrant d’un dessin par moments faiblard, cette nouvelle itération de Son Goku et de ses amis est sauvée par sa belle histoire et ses combats frénétiques et c’est bien ce qu’on lui demande ! Date de sortie en Belgique : 25 janvier 2019 Durée du film : 1h40 Genre : Animation Titre original : ドラゴンボール超 ブロリー (Doragon bōru sūpā: Burorī)
0 Commentaires
Résumé du film : Ben est un charmant jeune homme de 19 ans mais son addiction à la drogue lui fait complètement perdre pied. Autorisé contre toute attente à quitter le centre de désintoxication pour rentrer dans sa famille durant les fêtes de fin d'année, sa mère Holly l'accueille les bras ouverts. Son amour pour Ben est inconditionnel mais elle apprend rapidement qu'il représente toujours un danger pour lui-même et sa famille. Pendant 24 heures tumultueuses, Holly met tout en œuvre pour éviter l'implosion de sa famille. Note du film : 6/10 (par Véronique) Avis : Julia Robert et Lucas Hedges réunis dans un long-métrage centré sur les relations familiales et le combat contre ses démons ? Comment refuser une telle invitation ? Le sourire le plus lumineux d’Hollywood et le jeune acteur montant ont assurément de nombreuses qualités pour faire de cette rencontre un joli moment de cinéma. Oui mais… « Ben is back » aurait sans aucun doute beaucoup plus marqué les consciences s’il n’était pas arrivé dans nos salles deux mois après le « Beautiful Boy » de Felix Van Groeningen. Ce n’est pas pur chauvinisme que l’on se permet la remarque mais bien parce que le long-métrage de Peter Hedges souffrira indéniablement de la comparaison avec le long métrage du réalisateur belge, film qui posait les mêmes cadres, les mêmes questions avec un peu plus de maîtrise et de conviction. Mais heureusement pour papa Hedges (Lucas est en effet le rejeton du réalisateur), il peut compter sur la force d’interprétation de son fiston (dans une retenue intentionnelle, à l’image de celle optée dans « Manchester by the sea ») mais aussi sur celle de Julia Roberts, taillée pour le rôle de cette mère courage et prête à tout pour sauver son fils, sa famille et son équilibre. Emouvante, admirable dans sa démarche, la comédienne crève l’écran, par son regard intense, ses sourires et ses larmes de joie mais aussi ses colères et ses désarmements. Il faut dire que rien ne semble être facile quand il s’agit d’accueillir Ben dans sa vie. Sorti de son centre de désintoxication pour passer Noël à la maison, le jeune homme met tout en œuvre pour que les retrouvailles se déroulent le mieux possible. Jusqu’à ce que les mauvaises fréquentations du passé apprennent son retour en ville et décident de ne semer le chaos dans la vie presque tranquille de la famille Burns. En tâchant de redonner une stabilité à la vie de son fils, de le sortir du cercle vicieux duquel il semble être prisonnier, Holly va découvrir avec horreur, ce qu’était le quotidien de Ben jusqu’à ce qu’il se reprenne en main. Interpellant dans ce qu’il dénonce le scénario de Peter Hedges aurait été plus réussi s’il avait su donner cette petite profondeur qu’on attend, en vain, tout au long de cette grosse heure trente. On aime découvrir les relations de cette famille à la fois méfiante et aimante, mener l’enquête au côté d’une Holly bien plus coriace qu’il n’y parait mais on regrette le survol général et le manque de densité des autres personnages, parfois caricaturaux. La demi-mesure de l’histoire, son classicisme et son mécanisme maintes fois vu ne seront malheureusement pas occultés par la puissance de jeu du tandem principal. Dénonçant la dérive d’une jeune société américaine de plus en plus addict aux fuites en avant, aux hallucinogènes qui ferment les yeux sur une réalité décevante et loin des idéaux qu’elle s’était fixée, « Ben is Back » est un divertissement correct et une semi-réussite. Un film que l’on risque d’oublier et qui aura souffert d’être sorti après un film similaire bien plus maîtrisé… Date de sortie en Belgique : 23 janvier 2019 Date de sortie en France : 16 janvier 2019 Durée du film : 1h43 Genre : Drame Résumé du film : Starr est témoin de la mort de son meilleur ami d’enfance, Khalil, tué par balles par un officier de police. Confrontée aux nombreuses pressions de sa communauté, Starr doit trouver sa voix et se battre pour ce qui est juste. Note du film : 7/10 (par Véronique) Avis : « The Hate U Give » ressemble à première vue à un teen movie et c’est bien le cas. Porté par Amandla Stenberg, que l’on a vue dans « Hunger Games », « Everything Everything » ou encore dans « Darkest Rebellion », il est pourtant bien plus que cela. Véritable plaidoyer sur les violences faites sur la communauté afro-américaine par une police œuvrant en toute impunité, le film de George Tilman Jr est sans aucun doute une des bonnes surprises de ce mois. Thug Life Très vite adapté à l’écran après le succès littéraire de « The Hate U Give » écrit et remanié par Angie Thomas des années après son premier jet, le film de George Tilman Jr a le mérite d’exposer un phénomène beaucoup trop présent encore de façon ludique voire presque pédagogique. S’il est vrai que nombreux sont les films à avoir déjà traité du sujet, à savoir les bavures policières commises sur des afro-américains, celui-ci a le mérite de se mettre au niveau de nos adolescents sans verser dans le manichéisme dérangeant ou la moralisation propagandiste. Inspiré du meurtre du jeune Oscar Grant, abattu par balle en 2009 par un policier blanc, la nouvelle (et ensuite le roman) d’Angie Thomas a su trouver les mots pour parler à un public large et parfois peu renseigné sur ce qui peut se passer de l’autre côté de notre planète, dans une société dite civilisée et où chaque citoyen disposerait des mêmes droits que ses congénères, une chimère ? C’est ce que met en avant, « The Hate U Give » de façon subtile. Tupas Shakur, le célèbre rappeur (2Pac) a écrit et chanté « The Hate U Give Little infants fucks everybody », des paroles qui clôtureront judicieusement le récit de plus de deux heures, de la vie que mènent Starr et sa famille dans un des ghettos de la ville d’Atlanta. Repris sous l’acronyme T.H.U.G (Life), les mêmes initiales que celles du titre du film, ce précepte suivrait le même code que celui instauré par les Black Panthers des années auparavant (mouvement évoqué dans le métrage) et aurait pour but de défendre et rappeler les droits de façon parfois extrême de la population afro-américaine. En septième position de leur programme (sept comme « Seven », le nom du fils aîné de Maverick, le père de Starr – rien n’est laissé au hasard), on peut lire : « Nous voulons un arrêt immédiat de la brutalité policière et des meurtres de Noirs », combat largement mis en avant dans le dernier film de George Tilman Jr. Mais comment rester pacifistes lorsqu’au cours d’un contrôle de routine, un adolescent arborant une brosse à cheveux se fait abattre sans sommation ? Comment rester insensibles face à l’absence de condamnation pour le policier – blanc- responsable de la perte de cette vie humaine ? Comment ne pas crier la haine qui emporte tout le quartier stigmatisé et où vivent des familles entières ? Sans tomber dans l’excès, la mièvrerie ou la dramatisation, « The Hate U Give » livre un film poignant et engagé qui saura émouvoir les adolescents et leurs parents et qui, on l'espère, ouvrira la porte d’une discussion sur les dérives d’une société américaine plus divisée que jamais. Fabuleux teenagers Au-delà de son scénario bien ficelé (même s’il est parfois prévisible), ce qui impressionne dans « The Hate U Give » c’est la maturité de ses comédiens qui, après des passages dans des sagas ou séries pour ados, parviennent à transcender leurs émotions et nous les livrer sans fioriture sur notre grand écran. On applaudit ainsi la prestation sans faille de Amandla Stenberg, cette Starr partagée entre deux milieux radicalement opposés. Celui de son ghetto où règne l’insécurité et celui de son école privée pour jeunes riches. Ballotée entre deux mondes dans lequel elle n’a pas tout à fait sa place, Starr s’est créé deux identités, deux personnalités qui ne se fondent jamais l’une dans l’autre au risque d’être démasquée et rejetée par chacune des communautés qu’elle a intégrées. Mais lorsqu’après une soirée bon enfant qui a dégénéré en quelques minutes à peine, la jeune femme assiste à la mort de son ami d’enfance, ce sont tous ses repères qui volent en éclats et avec eux, une stabilité qui se voit ébranlée. Faut-il se taire et continuer à avancer ou au contraire, prendre la parole et se faire le porte étendard d’une cause qui touche toute sa communauté ? Aux côtés de la jeune Amandla, on notera la présence de Algee Smith, le Khalil assassiné, Dominique Fishback (déjà bouleversante dans « Night Comes On »), Lamar Johnson, Sabrina Carpenter (de la série « Le monde de Riley »), le jeune mais déjà impressionnant TJ Wright et, the last but not least, K.J Apa (« Riverdale », « Mes vies de chien »), une série de jeunes acteurs investis dans leur rôle et véritables faire-valoir d'une histoire qui avait déjà tout pour séduire le grand public. Intelligent, bien amené et très correctement interprété « The Hate U Give » sort des standards pour adolescents et se démarque par le traitement de son sujet, sa lecture et sa narration universelle et essentielle. Date de sortie en Belgique/France : 23 janvier 2019 Durée du film : 2h13 Genre : Drame Résumé du film : Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est connue pour son odorat extraordinaire. C'est presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité d’un individu. Mais quand Vore, un homme d'apparence suspecte, passe devant elle, ses capacités sont mises à l'épreuve pour la première fois. Tina sait que Vore cache quelque chose, mais n’arrive pas à identifier quoi. Pire encore, elle ressent une étrange attirance pour lui... Note du film : 6/10 (par Véronique) Avis : Déstabilisant à plus d’un titre, « Border » est l’un de ces films qui ont besoin d’être décantés après leur vision. Surprenant dans sa direction scénaristique, ingénieux dans le mélange de genres thriller/horreur/fantastique et impressionnant dans son interprétation, le long métrage d’Ali Abbasi est parfois border line mais assume jusqu’au bout son univers particulier… Retour sur l’un des premiers ofni de l’année. Freaks show Lauréat du Prix Un Certain Regard du dernier Festival de Cannes, « Border » (« Gräns » dans sa version originale), nous conte l’histoire de Tina, une douanière disgracieuse mais porteuse d’un don particulier : celui de (re)sentir les choses et les émotions des gens. Flairant chaque coup louche, débusquant les secrets les plus intelligemment cachés, la jeune femme ne se trompe jamais. Intégrée dans le petit village où elle évolue, Tina est néanmoins l’objet de regards critiques, de réflexions antipathiques et d’un rejet latent, insidieusement dissimulé. Proche de la nature, animale ou environnementale, Tina se ressource dans ses contrées boisées, préférant la compagnie de la faune locale à celle de certains congénères, à commencer par son compagnon (plus proche du colocataire qu’autre chose) bien plus intéressé par ses combats de chiens que par la vie que mène la jeune femme. Forcément, les différences physiques de Tina et ses aptitudes l’enferment dans une certaine solitude. Jusqu’à ce Revo, un mystérieux jeune homme, et sorte d’alter ego, apparaisse dans sa vie. De passage à sa douane, cet homme au visage et comportements monstrueux va finir par s’installer aux limites de sa sphère intime et qui sait, y entrer et perturber l’équilibre que Tina avait peu à peu instauré. Les attitudes animales voire bestiales de Revo et Tina vont peu à peu se révéler au grand jour, déstabilisant celle qui ne s’est jamais interrogée sur ses origines et son étrange identité. L’histoire d’amour singulière qui va naître entre ces deux amoureux hors norme va d’ailleurs mettre en exergue une série de thématiques bien cachées dans la première partie du film : celle de l’acceptation de l’autre quel qu’il soit, l’abolition des différences, l’abstraction de l’apparence physique au profit de la beauté intérieure. Troisième sexe Si les paroles du groupe Indochine nous viennent à l’esprit (« Et on se prend la main, Une fille au masculin, Un garçon au féminin »… vous connaissez la chanson) c’est sans aucun doute parce que les révélations faites sur Tina et Revo piquent à vif et laissent une trace indélébile dans notre mémoire de cinéphile qui, à vrai dire, n’avait jamais rien vu de cet acabit-là auparavant. Basé sur une nouvelle de l’auteur John Ajvide Lindqvist (par ailleurs co-scénariste du film), le film offre une ambiance très particulière et joue avec les codes du thriller (grâce à une enquête glaçante sur laquelle travaille Tina), mais aussi ceux du fantastique et de l’absurde. Si Ali Abbasi se lance sur de trop nombreuses pistes et écarte celle de la quête d’identité un peu trop rapidement, il entretient l’art du suspense grâce à une tension croissante et des revirements de situation pour le moins impressionnants. Passant d’un genre à l’autre avec aisance, nous emmenant hors des sentiers battus ou sur de fausses pistes qui nous surprennent sans cesse, « Border » est un film qui ne pourra que diviser son public. En revanche, on ne peut que se mettre d’accord sur le travail colossal effectué par Eva Melander et Eero Milonoff, les deux comédiens principaux du film qui n’ont pas hésité à prendre une vingtaine de kilos et subir quatre heures de maquillage quotidien pour donner vie à leurs personnages difformes. Sorte de parabole sur l’acceptation de l’autre, le long-métrage assume totalement son côté décalé et sombre, dépasse les limites des codes cinématographiques et dérange ses spectateurs qui, il est vrai, sauront difficilement si le film leur a plu ou pas. Tentés par cette expérience ciné ? On serait curieux de savoir ce que vous en avez pensé… Date de sortie en Belgique : 23 janvier 2019 Durée du film : 1h50 Genre : Fantastique Titre original : Gräns Résumé du film : Prenez garde au Rat scélérat, le bandit le plus gourmand des alentours ! Sur sa fidèle monture, il vole tout ce qui se mange, même si ce n’est pas à son goût, jusqu’au jour où il croise plus rusé que lui... Un conte de cape et d’épée, de bandit et de biscuits... Par le réalisateur de “Monsieur Bout-de-Bois” et les producteurs d' “Un conte peut en cacher un autre”. Avis : Ponctuant chaque trimestre d’une belle sortie destinée au jeune public, « Le Parc distribution » nous propose à nouveau un recueil de petits films d’animations qui enchanteront les enfants de 3 ans et plus. Cette fois, c’est « Le Roi scélérat » qui occupe la plus grande part de cette séance de 40 minutes. Mais qui est-il ? Le roi Scélérat est sorti de l’imagination de Julia Donaldson et Axel Scheffler, deux auteurs de livres pour enfants et à qui on doit « Monsieur Bout-de-Bois » (que l’on a découvert il y a près de deux ans déjà). Aux commandes de cette nouvelle adaptation très réussie, on trouve le belge Jeroen Jaspaert qui, tout comme dans ses courts-métrages précédents, parvient à capter l’attention de son jeune public mais aussi celle des parents. Ce récit en rimes nous raconte l’histoire d’un rat gourmand, qui dépouille les voyageurs sans forcément trouver son bonheur. Qu’importe, le roi Scélérat confisque tout ce qu’il voit, amaigrissant la population alors qu’il devient lui de plus en plus gras. Durant une belle vingtaine de minutes, on rit de ce bandit foireux, on apprécie la voie finalement prise par celui-ci et on se dit que, décidément, les films d’animation pour enfants ont de belles qualités qui tiennent sur la durée. Comme toujours, le film principal est précédé d’autres courts-métrages. Ici, ils sont au nombre de deux : « Musique, musique », une réalisation néo- zélandaise de six minutes qui nous raconte la composition musicale faite par d’étranges oiseaux et « Une pêche fabuleuse », un court métrage suédois de dix minutes, très joliment illustré et évoquant l’histoire de Betty, petit chat blanc curieux qui collectionne les trouvailles faites au bout de sa ligne à défaut d’avoir trouvé de quoi se nourrir. Comme à chaque fois, nous conseillons aux parents en quête d’ouverture cinématographique pour leurs petits enfants de faire confiance aux réalisations de cet acabit et de se rendre dans les salles pour partager un petit moment ludique privilégié. Date de sortie en Belgique : 23 janvier 2018 Durée du film : 42 minutes Genre : Animation Résumé du film : À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui, en apparence, ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain. Extrêmement performant, il transporte des cargaisons de plus en plus importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un "supérieur" chargé de le surveiller. Mais ils ne sont pas les seuls à s'intéresser à lui : l'agent de la DEA Colin Bates est plus qu'intrigué par cette nouvelle "mule". Entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes du passé menaçant de le rattraper, Earl est désormais lancé dans une vertigineuse course contre la montre... Note du film : 8/10 (par Véronique) Avis : A 88 ans, Clint Eastwood n’a pas fini de nous étonner. Après un déraillement dispensable qui nous laissait craindre une difficile remontée en selle, le revoici devant et derrière la caméra d’un nouveau drame biographique de grande qualité : « La mule ». Papy Clint est de retour et fait redorer ses lettres de noblesse avec l’histoire incroyable et pourtant vraie de ce vieil Earl Stone. Une mule âgée et têtue. Inspiré de la vie de Léo Sharp (renommé ici Earl Stone pour les besoins du film), « La mule » nous conte les nombreux va-et-vient entrepris par un octogénaire, ancien vétéran de guerre (ici de celle du Vietnam alors que Léo Sharp avait pris les armes lors de la Seconde Guerre Mondiale) et passionné des hémérocalles. Exproprié de chez lui, désargenté et coupé de sa famille (qu’il a toujours laissée de côté au profit des compétitions florales et des récoltes et cultures de fleurs multicolores), le vieux Earl est contraint d’abandonner les terres qui lui étaient chères et de trouver refuge ailleurs, emmenant dans son ancien pick up quelques maigres souvenirs de sa vie d’antan. Fort heureusement pour lui, Earl fait la connaissance d’un jeune latino qui lui propose de devenir transporteur pour des amis à lui. Voyant là l’opportunité de se refaire financièrement, notre vieil américain accepte et se retrouve à sillonner les routes des USA du Sud au Nord sans savoir ce qu’il transporte vraiment. Faussement naïf, plus solide qu’il n’y parait, Earl va ainsi entrer en contact avec diverses branches d’un cartel qui fait frémir les membres de la DEA (le service de la police fédérale chargé du contrôle des drogues). Tournage en famille. Pour rendre ce fabuleux projet possible, Clint Eastwood a su s’entourer de nombreux collaborateurs avec qui il a déjà réalisé des merveilles par le passé. Ainsi, le scénario de « La Mule » est écrit par Nick Schenk, à qui on doit le mémorable « Gran Torino ». Pas étonnant dès lors que l’on retrouve cette patte qui nous a fait (sou)rire il y a dix ans de cela, cet humour grinçant et parfois politiquement incorrect qui amuse le public et colle si bien à la peau de feu Inspecteur Harry. Assagi, moins rustre que dans d’autres de ses rôles, Clint Eastwood fait ce qu’il sait faire de mieux, mais avec un peu plus de retenue. Lui qui continue d’impressionner son entourage par son énergie débordante et sa rage de vivre a dû se contenir ici et adopter les attitudes d’un vieux monsieur qui ne lui correspond pas tout à fait. Il confie d’ailleurs qu’il s’est inspiré du travail de son propre grand-père, éleveur de poulets. Ce « viejo » qu’il incarne à l’écran nous fait mal au cœur, nous touche par l’envie de recoller les morceaux, d’offrir du temps à ceux qu’il a trop longtemps négligé. Sa famille, exclusivement féminine, a fait sa route, le laissant sur celles qui l’emmenaient de concours en échanges de boutures, de bars en colloques horticoles. Et pour donner de la profondeur à la véracité des sentiments, Clint a demandé à sa fille Alison de tenir le rôle d’Iris, la fille unique de Earl. Dans les têtes connues du cinéma de Clint, on retrouve aussi celle de Bradley Cooper, son fabuleux tireur d’élite dans « American Sniper » (dont il a, pour la petite anecdote, produit le premier long-métrage, « A Star is born »). Chargé de traquer cette mule trop efficace, l’agent Bates aura bien du fil à retordre pour identifier et arrêter ce livreur de tous les records. Évoluant parallèlement dans un suspense faussement intenable, les deux personnages ont bien des choses en commun. D'ailleurs, les rares rencontres entre Bradley Cooper et Clint Eastwood apportent une belle humanité au film et montrent combien l’acteur réalisateur a bien fait de s’exposer à nouveau sous les objectifs de ses caméras. On the road again Ce qui étonne dans le dernier long-métrage de Clint Eastwood, c’est son histoire invraisemblable et pourtant vraie. Leo Sharp est en effet devenu la meilleure mule du Cartel de Sinaloa à la fin des années 80 alors qu’il était âgé de 90 ans ! Lui qui n’avait jamais été condamné par la justice, qui n’a reçu aucune contravention ni aucun procès pour excès de vitesse, transportait des centaines de kilos de drogue du Texas à l’Illinois sans se faire pincer par les forces de l’ordre. Bien sûr, pour donner un certain modernisme à l’histoire, Nick Schenk a transposé les faits à notre époque, s’amusant de certaines de nos manies et addictions. Mais ce qui fait ressortir le film du lot, c’est le message livré en substance, de façon parfois peu subtile, celui de l’importance de la famille et des moments précieux que l’on ne peut revivre une fois révolus. Quels souvenirs garderons-nous au crépuscule de notre vie ? Quel temps aura été le plus précieux : celui consacré à notre passion, à notre travail ou celui passé en famille ? Prétexte bien ancré dans le scénario, ce sentiment rayonne à mesure que l'histoire avance et prend une place considérable dans le coeur de son personnage principal comme dans celui des spectateurs. Marqué par les événements familiaux auxquels il n’avait jamais pris part, le personnage de Earl évolue à tout point de vue. On le voit au fil des (presque) deux heures de film, ce petit vieux paumé et accablé par la vieillesse devient la star du cartel et cela, on le mesure tant dans ses attitudes que dans les surnoms dont il est affublé : de viejo (petit vieux), il devient abuelito (le grand père) pour finir par être le « caïd » de la bande. Mieux, il devient le sauveur du club de vétérans de son quartier et le grand-père généreux ne lésinant devant rien pour faire, enfin, le bonheur de sa famille... Sous sa facture classique et sa maîtrise presque ordinaire, « La mule » révèle des valeurs sûres et une histoire qui parle à bon nombre d’entre nous. On se prend de sympathie pour ce Earl foireux et aventureux, on s’amuse des entourloupes dont il use (et abuse) et on se dit que décidément, Clint Eastwood a bien fait de revenir à ce qu’il sait faire de mieux et nous fait largement oublier le naufrage dans lequel il s’était enlisé l’an dernier. Date de sortie en Belgique/France : 23 janvier 2019 Durée du film : 1h57 Genre : Drame Titre original : The mule Résumé du film : Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la maladie et la mort tous les jours dans son service de pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée dans une unité voisine, la frontière entre l’intime et le professionnel se brouille. L’univers de Simon, ses certitudes et ses convictions vacillent... Note du film : 8/10 (par François) Avis : Réanimations, doutes, espoirs et rythme infernal constituent le quotidien de Simon, médecin spécialisé en pneumologie. A travers lui, nous côtoyons les différents services d’un hôpital qui voit passer de nombreuses vies. Ainsi, le dernier film de David Roux nous permet d’entrer avec beaucoup de pudeur dans ce tourbillon qui risque de ne pas vous laisser indifférents. Récit d’une belle surprise ! L’ordre des médecins ou l’anti-« urgences » Pétri de qualités, « L’ordre des médecins » se veut réaliste avant tout ! Fuyant volontairement le côté tape à l’œil recherché par d’autres productions (vous avez dit « Urgences » ?), le film du réalisateur se veut minutieux dans la justesse de sa reconstitution. D’ailleurs, quand on sait que le frère du réalisateur est lui-même pneumologue en soins intensifs et qu’il a ouvert les portes de son service, on se dit qu’on ne risque pas de trouver d’incohérences. En à peine 1h30, le réalisateur parvient brillamment à nous faire respirer le climat d’une salle d’opération ou d’une réunion multidisciplinaire. Même les moments de détente lors des pauses des médecins et des infirmières sont des moments de vie précieux car ils sonnent comme une bulle d’oxygène dans un univers anxiogène qui poursuit longtemps encore les médecins et le corps hospitalier. Plus qu’un film, un cheminement intérieur Pour son réalisateur, ce projet n’a pas dû être évident tant son sujet le touche personnellement. Inspiré de la période où sa mère était malade, « L’ordre des médecins » intègre des moments précis de sa vie, mais aussi ses ressentis et opinions quant au rôle de son frère. Le réalisateur se souvient : « "Alors qu’il faisait ça tous les jours, tout d’un coup, dans cette situation, avec notre mère si mal en point, ce n’était plus pareil. Il y avait là, dans ce choc entre le professionnel et l’intime, quelque chose d’abyssal. Je me suis dit que c’était peut-être la matière pour un film ». Cette expérience libératrice repose sur les épaules larges de Jérémie Renier qui livre ici une solide performance. D’ailleurs, il retrouve la comédienne Zita Hanrot, qu’il a mis en scène dans « Carnivores ». Présenté par moments tel un huit clos hospitalier, le film de David Roux n’en oublie pas de développer chacun de ses personnages avec beaucoup d’adresse. Les relations du héros avec sa famille sont à la fois belles, empruntes de pudeur et complexes, à l’image de celles que nous rencontrons tous. Jamais moralisateur, le film nous donne à voir ces récits de vie et le courage qui permettent aux protagonistes de continuer à avancer. Quant au personnage de Simon, le fait de passer la majorité de son temps à l’hôpital lui laisse peu d’espace pour aménager sa vie privée. Alors, quand en plus de cela, sa maman (Marthe Keller) se retrouve hospitalisée, c’est son monde et celui de sa famille qui s’écroulent. À l’image des thèmes traités dans son film, le tour de force du réalisateur est de nous faire croire qu’il parvient à doter sa caméra d’une personnalité propre. Celle-ci, avec le concours d’une photographie irréprochable, se veut distante par moment et carrée dans ses plans ; mais aussi proche et intime de ses sujets le reste du temps. Même l’expérience sonore est bien sentie et la formidable musique jouée au synthétiseur apporte beaucoup de vérité aux scènes filmées. Nous ne pouvons taire le formidable travail du compositeur Jonathan Fitoussi A la lecture de ces quelques lignes, il nous apparait évident que « L’ordre des médecins » est bien plus qu’un film médical. Il s’agit d’un film sur la famille porté par de brillants comédiens et par un réalisateur qui a parfaitement su retranscrire un cheminement intérieur. Nous, on salue le résultat et on vous invite à arpenter visuellement les couloirs de cet hôpital plus vrai que nature. Date de sortie en Belgique/France : 23 janvier 2019 Durée du film : 1h33 Genre : Drame Résumé du film : « Peterloo » est un portrait épique des événements entourant le tristement célèbre massacre de 1819, où un rassemblement pacifique prodémocratique à St Peter's Field à Manchester s’est transformé en un des épisodes les plus sanglants et les plus tristement célèbres de toute l'histoire britannique. Le massacre a vu les forces du gouvernement britannique charger dans une foule de plus de 60.000 personnes, qui s'étaient rassemblées pour exiger des réformes politiques et protester contre les niveaux croissants de pauvreté. Note du film : 6/10 (par Véronique) Avis : Quatre ans après « Mr Turner » (qui retraçait la vie du célèbre peintre britannique) Mike Leigh s’attaque à une autre période historique, celle du début du XIXème siècle dans une Angleterre en proie au changement. Ainsi, avec « Peterloo », le réalisateur britannique se penche sur un des plus grands massacres jamais perpétrés sur son sol national. Né de la contraction de Waterloo et St Peter’s Field, place de la ville de Manchester, ce mot résonne dans les livres d’Histoire comme l’une des plus grosses bavures commises par les magistrats et militaires anglais. Totalement méconnu pour notre part, cet événement glaçant montre comment la démagogie et les jeux de pouvoir peuvent avoir des incidences dramatiques sur une population pacifiste qui n’avait qu’un seul but : être entendue. Si son propos fait indéniablement l’écho de notre actualité (où, aujourd’hui encore, nous assistons impuissants à des affrontements entre manifestants et force de l’ordre), le film ne parvient pas totalement à nous sentir concernés et finit même, par sa longueur, à nous perdre sur son chemin trop longuement installé. Un petit bout d’histoire. Nous voilà quelques années au lendemain de la victoire des alliés à la Bataille de Waterloo. Le premier ministre britannique, heureux du succès de ses troupes, incite la chambre à honorer le Duc de Wellington en le gratifiant d’une somme de 750 000 livres ! Coûteuses, ces guerres ont certes rempli la bourse de certains hauts gradés de l’armée mais à considérablement vidées celles de la population locale. Alors que la famine pointe le bout de son nez, et la pénurie de maïs et de blé fait monter en flèche le prix des denrées, la grogne commence à se répandre et à se faire insistante. Taxée et victime des Corn Laws (entendons par ici le gel des importations des céréales d’autres pays voisins) la population meurt de faim. Le travail se fait rare, les salaires ne cessent de baisser et aucune voix n’est prêtée au peuple pour faire entendre sa détresse. Pire, survivant comme il peut, le peuple de la rue s’adonne à des petits larcins qui sont injustement condamné par une Cour partiale, beaucoup trop stricte et surtout sourde d’oreille. Épuisés, exaspérés, blessés, les ouvriers, les paysans ou encore les manouvriers se réunissent dans des salles clandestines pour débattre et demander une réforme : celle qui permettra d’élire les représentants du peuple de Manchester à la Chambre et de relayer la détresse dont il est depuis trop longtemps la victime. Ne voyant pas cela d’un très bon œil, les magistrats et autres politiques décident de tuer l’idée dans l’œuf et d'empêcher cette demande d’aboutir. S’ensuivent des interprétations, des tractations politiques et militaires, des démarches démagogiques, des rumeurs infondées qui peu à peu, vont effrayer les plus nantis. Menée par John Knight (Philip Jackson), récupérée par l’Orateur et propriétaire terrien Henry Hunt (Rory Kinnear), cette démarche pacifique va toucher toute la population de Manchester, des hommes aux femmes (désireuses d’apporter leur soutien au droit de vote de leurs époux) et finir par prendre une ampleur considérable et devenir une révolte silencieuse des plus inquiétante… Des fresques animées. Témoins de cette colère qui grandit peu à peu, spectateurs des réunions de débats et des amicales des syndicats, nous comprenons combien le peuple a besoin de crier haut et fort qu’il n’est plus possible ni décent de vivre dans des conditions si précaires. Les prémices de la révolution industrielle, la propagation de celle menée en France quelques décennies plus tôt, la cicatrice béante laissée par les batailles auxquelles ont pris part les jeunes soldats, marquent toute une série de personnage que l’on suivra au fil de ces deux heures. Espérant voir naître l’espoir dans leurs yeux, nous avançons confiants vers le final dramatique d’une marche pacifique qui n’aurait jamais dû se terminer en bain de sang. En nous faisons entrer dans les coulisses des lieux de réunions, en nous mettant face aux débats publiques ou intimistes organisés dans les deux camps, nous nous imprégnons peu à peu d’un climat, parfois oppressant et trouvons une bouffée d'oxygène dans des chants de tristesse ou des musiques d'allégresse. Nous partageant en permanence entre petit peuple et aristocratie, nous assistons incrédules au contraste qui oppose le peuple uni, parlant d’une même voix et les blessures d’ego d’hommes de pouvoir incapables de se mettre d’accord, chacun criant plus fort pour être entendu… et on comprend que deux siècles plus tard, rien n’a véritablement changé non plus. Côté technique, on admire le travail colossal effectué pour retranscrire la réalité de l’époque, le souci des détails apporté aux décors et aux costumes, la photographie soignée et la lumière ou l’obscurité utilisées à bon escient. Mais on déplore la longueur excessive de cette trame, les trop nombreuses discussions, les dialogues excessivement bavards et les redites dispensables. On se perd dans de magnifiques tableaux, proches des fresques populaires que l’on aime contempler dans les musées… mais la visite est longue et le temps pèse sur nos épaules, nous faisant avancer à pas lourds de pièce en pièce, nous donnant presque l’envie d’accélérer le mouvement pour en finir au plus vite. En définitive, si le film trouvera très certainement ses faveurs outre-Manche, nous peinons à savoir à quel public « Peterloo » est destiné. Aux férus d’Histoire, aux amateurs d’épopées et de fresques animées ? Très certainement. Bien que l’on reconnaisse les qualités de sa photographie et celles de sa reconstitution d’époque, nous regrettons que le dernier long-métrage de Mike Leigh ne soit plus direct et percutant et mette tant de temps à nous emmener vers son dénouement. Date de sortie en Belgique : 16 janvier 2019 Durée du film : 2h34 Genre : Historique Résumé du film : Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d'une riche famille de Mumbai. En apparence la vie du jeune homme semble parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent qu'il a renoncé à ses rêves. Elle, elle n'a rien, mais ses espoirs et sa détermination la guident obstinément. Deux mondes que tout oppose vont cohabiter, se découvrir, s'effleurer… Note du film : 7/10 (par Véronique) Avis : Combien de réalisations indiennes parviennent jusque dans nos salles chaque année ? Combien connaissons-nous de réalisateurs ou de comédiens asiatiques ? La réponse commune à ces deux questions est : bien trop peu. Et pourtant, la plupart des longs-métrages qui remontent la route de la soie jusque dans nos contrées sont des petits bonheurs qu’il serait dommage d’esquiver. « Sir » fait partie de ceux-là, de ces films positifs et lumineux remplis d’espoir, de beaux sentiments et d’une douceur qui fait du bien. Ratna à la ville Jeune villageoise venue s’installer dans la ville, Ratna est une domestique douce et discrète, toujours disponible pour Aschwin, un riche entrepreneur dont le mariage vient d’être annulé. Anéanti par l’annonce de l’infidélité de sa fiancée, il revient dans l’appartement urbain, errant dans l’ombre des murs qui abritaient autrefois son histoire d’amour. Mais Ratna a elle aussi le cœur lourd. Celle qui a pour rêve de devenir designer de mode, n’est plus que le reflet d’elle-même ; veuve à 19 ans, elle a dû quitter le village où tout lui était interdit pour gagner la ville et un souffle de vie. Economisant chaque roupille pour financer les études de sa sœur, la jeune femme entretient l’espoir de voir sa vie prendre un autre tournant. Engagée en plus de ses heures chez un petit tailleur du coin, elle espère concrétiser son souhait et approcher d’un peu plus rêve le monde de la mode. Positive, présente pour tous plus que pour elle-même, Ratna a malgré tout beaucoup de difficultés à avancer et à sortir du rôle dans lequel elle est cantonnée. Dormant et mangeant à même le sol, calquant ses horaires de travail sur ceux de son maître, régulièrement rappelée à sa vie de domestique par l’entourage d’Ashwin, la jeune indienne a parfaitement conscience de son rang et de la chance qu’elle possède d’avoir pu allumer une petite lueur d’espoir dans son triste horizon... Une douce romance On s’en doute, « Sir » ne serait pas la jolie romance dramatique annoncée si ces deux âmes en peine que sont Ashwin et Ratna ne partageaient rien de plus que cette relation de maître et domestique. Sans révéler les tenants et les aboutissants de l’intrigue, on peut dire que le premier long-métrage de fiction de Rohena Gera est un juste équilibre de sentiments positifs, de hauts et de bas qui mettront en scène, de façon on ne peut plus délicate, un amour pudique et respectueux du statut de chacun. Inspiré de la vie de sa nounou, le scénario original de la réalisatrice est certes un peu convenu, mais écrit avec cœur et amour pour les personnages qu’il met en scène. Présentant certains us et coutume propres à la société indienne, la difficulté de s’affranchir des castes abolies mais toujours palpables, l’histoire ne verse pas dans la dramaturgie ni dans l’épanchements des sentiments, que du contraire. Tout est subtil et doux, et on entre à pas feutrés dans l’appartement moderne de Mumbai où les traditions sont toujours très respectées. Et que serait cette histoire sans la présence lumineuse Tillotama Shome, comédienne indienne d’une élégance rare. Portant l’histoire de son personnage avec une vérité d’interprétation qui ne peut que nous toucher, on se surprend à être séduit à notre tour par ses rares sourires et sa joie de vivre. Vivek Gomber, lui, est plus en retrait, mais donne le change à sa partenaire de jeu avec autant de conviction. La rencontre de leurs deux univers, leurs dialogues en hindi ou en anglais, l’évolution de l’histoire et les petites attentions que chacun porte à l’autre font de Ratna et Ashwin deux personnages attachants que l’on ne lâche qu’une fois la dernière page de l’histoire de « Sir » tournée. Car oui, on peut le dire, ce « Monsieur » peu ordinaire est un petit bonheur cinéphile qui se déguste avec délicatesse et qu’on ne peut donc que recommander pour son infinie tendresse. Date de sortie en Belgique : 16 janvier 2019 Durée du film : 1h35 Genre : Drame Résumé du film : Paris 1979, au cœur des années Palace. Haut lieu de la nuit où se retrouvent artistes, créatures et personnalités, guidés par une envie de liberté. Rose, une jeune fille de 16 ans issue de la DASS, et son fiancé Michel, 22 ans, jeune peintre désargenté, vivent leur première grande et innocente histoire d’amour. De fêtes en fêtes, ils vivent au jour le jour, au gré des rencontres improbables de la nuit. Lors d’une soirée, Rose et Michel font la connaissance de Lucille et Hubert, de riches oisifs, qui vont les prendre sous leur aile et bousculer leur existence. Note du film : 4/10 (par Véronique) Avis : Inspiré de fragments de sa vie exaltée au cœur des années 80, « Une jeunesse dorée » de Eva Ionesco a une patte visuelle et artistique intéressante : les décors du Palace d’une époque révolue, les costumes haut en couleur et sa bande originale stylée nous plongent quelques années en arrière et ce, dès les premières minutes du film. Mais c’est à peu près tout. Si on comprend le besoin de la réalisatrice de poursuivre le récit de son adolescence tumultueuse, (commencé avec « My little Princess ») on ne cerne pas vraiment les motivations de proposer le résultat final à un grand public trop peu concerné par son sujet. Beau mais terriblement creux, artificiel dans ses dialogues, son jeu et sa mise en scène, « Une jeune dorée » ne brille pas plus qu’un vieux chandelier en laiton à qui il faudrait redonner un sacré coup de polish. Faussement inventif, le film d’Eva Ionesco (que l’on pourrait renommer « une jeune dépravée ») manque d’un peu de génie pour être comparé une pâle copie d’un Godard déjà dépassé. Long, lassant et ennuyant, « Une jeunesse dorée » est sans aucun doute l’un des films dispensables de l’année, pire l’un des plus soporifiques même. Et pourtant, ce n’est pas faute de lui avoir laissé sa chance. Curieux de connaître les motivations de la réalisatrice, nous nous sommes penchés sur son parcours et avons compris les raisons qui l’ont poussée à livrer un tel métrage. Posant nue pour sa mère (la photographe Irina Ionesco) dès son plus jeune âge, placée à la DDASS puis dans une maison de redressement, la jeune femme, qui a aussi tourné dans des films érotiques à l’adolescence, a connu les soirées sexe, drogue et décadence organisées au Palace, haut lieu festif où toute la jet set parisienne se réunissait jusqu’aux premières lueurs de l’aube. N’existant que par la beauté de leurs corps, leurs soirées de débauche et les relations ambivalentes qui s’installent entre les artistes de tous âges, nombreux sont les jeunes paumés qui, à défaut de percer dans les arts qui les font rêver, vivent d’illusion et de rapports ambivalents et parfois toxiques, anesthésiés de toute réalité et de véritables ambitions. Si on a vite fait le tour du propos du film d’Eva Ionesco, on se demande toujours ce que sont allés faire là Isabelle Huppert et Melvil Poupaud, si ce n’est donné un minimum d’épaisseur à cette biscotte cinématographique trop friable. Face à eux, les jeunes Galatéa Bellugi (« Keeper »), Lukas Ionesco, le fils de Eva et Alain-Fabien Delon, trois belles gueules qui tentent le tout pour le tout pour sauver le film du naufrage mais qui ne parviennent qu’à préparer, minute après minute, les canots de sauvetage. Amour libre, passage à l’âge adulte, tourmente d’adulescents en quête de repères, voilà ce que l’on trouve dans la trop théâtrale et inconsistante « jeunesse dorée » de Eva Ionesco. Un long-métrage vite vu, vite oublié qui ne mérite franchement pas la dépense de vos précieux deniers. Date de sortie en Belgique/France : 16 janvier 2019 Durée du film : 1h52 Genre : Drame Résumé du film : Rike, quarante ans, est médecin urgentiste. Pour ses vacances, elle a planifié un voyage en solitaire pour rejoindre l’île de l’Ascension depuis Gibraltar. Seule au milieu de l’Atlantique, après quelques jours de traversée, une tempête violente heurte son vaisseau. Le lendemain matin, l’océan change de visage et transforme son périple en un défi sans précédent… Note du film : 7/10 (par Véronique) Avis : A la vue de l’affiche ou de la bande annonce de « Styx », beaucoup penseraient qu’il s’agit d’un énième film de survie en mer, genre très populaire ces dernières années et qui a déjà vu naître des métrages tels que « All is lost », « En solitaire » ou encore « Le jour de mon retour ». Mais le film de Wolfgang Fischer est bien plus que cela. S’il met en effet en avant le voyage en solitaire de Rike (formidable Susanne Wolff), « Styx » est avant tout une fable intelligente sur un sujet bien trop préoccupant aujourd’hui encore : celui du sort des migrants et de l’immobilisme de l’Europe face à leur tragique destin. Dans la mythologie grecque, le Styx est l’un des fleuves qui mènent aux enfers. Pas étonnant donc que le réalisateur autrichien ait choisi de donner ce nom à son long-métrage tant on peut mesurer, à coups d’actualité, que nos mers et nos océans sont devenus, pour bon nombre de migrants désespérés, un point de non-retour ou pire, l’entrée vers des situations cauchemardesques dans lesquelles l’humanité fait la sourde oreille face à leur détresse. Dans le même ordre d’idée, Fischer a d’ailleurs choisi de faire débuter le voyage de Rike à Gibraltar, lieu symbolique et maigre séparation entre l’Afrique et l’Europe. A la croisée du film d’action et du drame psychologique, son nouveau long-métrage (salué lors de son passage à la Berlinale l’an dernier) parvient subtilement à soulever les consciences et à nous présenter une triste réalité. Celle de quelques impuissants, déterminés à sauver une partie de notre humanité alors que d’autres se complaisent à trouver des solutions pour ne pas à devoir y faire face. The life of Rike Seule sur son bateau, alors qu’elle s’offre un voyage vers l’île de l’Ascension où Darwin (père de l’idée de la « sélection naturelle », n’est-ce pas une autre symbolique en soi ?), Rike vogue sur des espaces de liberté (chers à son besoin de calme et de ressource), elle qui passe ses jours à sauver des vies dans l’espace étriqué d’une ambulance toujours speedée. Lorsqu’elle fait face à sa première tempête, la jeune femme, forte de caractère, décide de s’armer de courage et de la traverser sans broncher. Et même si le calme vient après les orages, c’est une autre tourmente qui l’attend, celle d’un sauvetage impossible ou en tout cas, compliqué par les autorités lâches et démissionnaires. Agrippée à sa radio, lançant de nombreux messages de secours, l’urgentiste constate, avec le plus grand des désarrois, que personne ne semble se préoccuper du sort des enfants abandonnés sur ce bateau de pêcheur dérivant en pleine mer. Limitée dans ses marges de manœuvre autant que dans ses ressources, la jeune femme ne va pourtant rien lâcher et ne cessera d’entretenir l’espoir que quelque part, quelqu’un entendra son appel. Si, « Styx » n’est pas un film bavard, il n’empêche en rien la compréhension des messages diffusés durant cette petite heure trente. Documentaire dans sa forme, terriblement touchant dans son fond, le film prend le temps de nous faire ressentir le confort et la protection européenne du petit voilier avant de nous plonger dans un interminable suspense. Le jeu de Susanne Wolff y est d’ailleurs pour beaucoup. Ne prononçant que quelques répliques en anglais, la comédienne parvient, dans ses silences et ses actes, à nous faire ressentir la détermination et détresse de son personnage, ses notes d’espoir mais aussi sa terrible désillusion face à une inaction condamnable. A l’image des bras affaiblis du petit mauritanien sauvé de justesse par notre héroïne, les nôtres nous en tombent devant la lâcheté des gardes côtes. Leur discours ankylosé montre combien la survie d’une allemande prime sur celle de tant de vies sacrifiées, laissées à la dérive d’un monde qui ne veut pas s’en soucier ou qui ferme tout simplement les yeux sur une dure et triste réalité. Percutant, « Styx » nous met bien sûr mal à l’aise et constitue, à notre sens, un film nécessaire qui, à l’image de « Fuocoammare », éveillera les consciences et se fera le porte étendard d’un appel qui ne devrait jamais rester sans réponse. Date de sortie en Belgique : 16 janvier 2019 Date de sortie en France : 27 mars 2019 Durée du film : 1h34 Genre : Drame Résumé du film : L’histoire vraie de Colette débute lorsque la simple fille de la campagne, jeune mariée du célèbre écrivain, mais indigent, Henri 'Willy' Gauthier-Villars, fait son entrée dans la haute société parisienne dans les années 1900. S’ennuyant dans sa nouvelle existence, elle rédige des journaux regorgeant de ses fantasmes sexuels, qui sont finalement publiés comme la série de nouvelles Claudine sous le nom de Willy. Les récits sensuels cartonnent, et Willy et Colette deviennent le couple le plus connu de France. Jusqu’à ce que Willy finisse par la trahir. Note du film : 6/10 (par Véronique) Avis : S’inscrivant dans la lignée des biopics consacrés aux écrivains féminins les plus célèbres (« Becoming Astrid », « Mary Shelley » ou encore « La douleur »), « Colette » déçoit sur bien des plans. Davantage axé sur la vie sulfureuse de la romancière française, le sujet du film de Wash Westmoreland (« Still Alice ») ne semble qu’être un prétexte pour présenter la révolution d’une époque, les fondements d’un féminisme et d’une liberté sexuelle assumée par des femmes de plus en plus indépendantes. Si on comprend l’angle choisit par le scénariste et réalisateur anglais, on reste néanmoins perplexe sur les extraits de vie choisis et l’omission volontaire de tout un pan de sa vie familiale et artistique. Avec sa mise en scène très conventionnelle, cette version cinématographique de « Colette » ne se démarque pas des autres films du genre. Mettant en scène Keira Knightley (qui, avouons-le, ne nous a que très rarement convaincu dans ses rôles jusqu'ici) et le performant Dominic West, l’histoire, toute aussi classique, suit une linéarité convenue. Ne ressemblant en rien au personnage qu’elle incarne, Keira Knightley entre dans la peau de la romancière à succès avec aisance et nous emporte dans les différentes (re)sentiments qui auraient pu être les siens. De sa vie à la campagne, dans la demeure familiale à ses représentations orientales dirigées par Georges Wague, nous suivons les pas, d’abord incertains, de Colette dans la capitale française, après son mariage avec Willy, critique littéraire, romancier et directeur d’une maison d’éditions. Habitué à employer des nègres pour élargir son répertoire, l’époux de Sidonie-Gabrielle Colette décèle en elle un certain talent et décide d’orienter ses écrits et de les publier sous son nom. Très vite, tout Paris s’arrache la collection des Claudine, condensé des souvenirs de la jeune femme, saupoudré d’une sensualité inédite à l’époque. Fréquentant les salons littéraires, vivant pleinement de leur succès, le couple Willy-Colette finit par se détacher peu à peu et ne partager que leurs partenaires sexuels qui alimentent leurs romans de pseudo-fiction rédigés à quatre mains (ou presque). Libertine et déterminée à sortir de son rôle de femme de, Colette entretient une relation avec Missy de Morny, fille du célèbre Duc. Cette rencontre salvatrice va être déterminante dans les choix d’avenir de l’écrivaine. Ses représentations théâtrales dans les music-halls de la capitale et de province, son gout de la provocation et son envie de signer ses écrits de son propre nom montreront combien la jeune femme n’a jamais envisagé de rester dans l’ombre de ce Willy, aussi séducteur que manipulateur. Mettant en avant les premières années de sa vie d’adulte et de femme mariée, « Colette » se limite donc à une époque durant laquelle la native de Saint-Sauveur devient une artiste parisienne. Se désintéressant totalement de l’après « Willy », le film de Wash Westmoreland laisse perplexe. Bien sûr la reconstitution de ce Paris du début XXème est totalement réussie, ses décors et ses costumes très travaillés, mais il n’empêche que « Colette » manque d’âme, de profondeur, de quoi s’accrocher durant ces presque deux heures. L’anticonformisme de cette grande dame de la littérature se heurte à un long-métrage d’un classicisme ordinaire, et ça n’en est que désolant. Alors oui, on rit de la dédramatisation de certaines situations, on apprécie la grandeur de caractère de Colette, ses expressions sans langue de bois mais il nous manque un je ne sais quoi d’audace pour faire de cette fiction un film détonnant. Moderne dans son traitement, plaçant la Femme au centre de toutes les attentions, « Colette » ouvre une porte sur la biographie de cette personnalité hors-norme, qui aurait sans doute mérité, un film qui le serait tout autant. Date de sortie en Belgique/France : 16 janvier 2019 Durée du film : 1h51 Genre : Biopic Résumé du film : En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité. Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils considéraient comme des différences insurmontables, pour découvrir leur humanité commune. Note du film : 8/10 (par Véronique) Avis : Présenté en avant-première dans de nombreux festivals et lauréat de trois Golden Globes le week-end dernier, « Green Book » est un film drôle et tendre, mené par un tandem de comédiens admirables : Viggo Mortensen et Mahershala Ali. Plébiscité là où il a déjà été présenté, le film de Peter Farrelly a su toucher le cœur du public et de la critique. Et ça tombe plutôt bien car ce feel good buddy movie a de sacrés bons arguments pour attirer vos faveurs en ce mois de janvier. Retour sur ce petit coup de cœur de ce début d’année. En voiture Simone ! Peter Farrelly. Voilà un nom qui résonne chez bon nombre de spectateurs. Souvent associé à celui de son frère Bobby, Peter a marqué la comédie américaine de ses vingt dernières années avec des films mémorables tels que « Mary à tout Prix », « Fous d’Irène » ou encore « Dumb et Dumber ». Nul doute donc que son dernier film en solo allait nous faire passer deux heures délicieuses en compagnie d’un tandem de choix : le caméléon et toujours impeccable Viggo Mortensen et l’oscarisé Mahershala Ali. Alors que le premier ébloui par la maîtrise de son accent et les attitudes brutes de son personnage, le second se distingue par sa classe et son maintient gracieux donnant de l’épaisseur à son rôle taillé sur mesure. Mais comment ces deux êtres que tout oppose de prime abord vont-ils parvenir à collaborer sur cette tournée ? Comment Tony va-t-il dépasser les a priori qu’il semble entretenir depuis des années ? C’est ce que nous allons découvrir au fil d’un road trip peu ordinaire. Après une entretenue pour le moins étonnante (autant qu’amusante), nos deux futurs complices arpentent, durant près de deux mois, les routes du grand Sud dans une très belle voiture couleur menthe à l’eau. Et pourtant, c’était loin d’être une évidence tant le (faux) départ était loin d’être envisageable. Le Docteur Don Shirley, véritable pianiste virtuose, élégant et distingué, conduit dans le fin fond de l’Amérique sudiste par un italo-américain rustre, raciste sur les bords et infantile? Cela paraissait impensable et pourtant… Basée sur des faits réels, l’histoire que va nous conter Farrelly et son duo de scénaristes (Brian Hayes Currie et Nick Vallelonga, le fils du vrai Tony « Lip ») rentrerait pile poil dans son registre déjanté s’il n’y avait pas insufflé un brin de sensibilisation à un sujet encore trop actuel dans cette Amérique qui se veut moderne et « libre ». Sois Black et tais-toi. Le « Green book » du titre du film est le nom du guide utilisé par les gens de couleurs durant près de trente ans. Le but de ce petit livret ? Présenter les différents établissements de l’Horeca acceptant les voyageurs de diverses origines. Américain reconnu pour son talent de pianiste, le Docteur Shirley n’a pour autant aucune faveur et fait l’objet d’humiliations et remarques déplacées, dont Tony est le témoin privilégié. Interdit de fréquenter les toilettes d’un lieu qu’il a honoré de sa présence, maltraité physiquement et moralement pour avoir été au mauvais endroit au mauvais moment, arrêté pour sa couleur de peau, … l’artiste fait l’objet de nombreuses discriminations qui heurtent mais reflètent une dure réalité, celle qui a été la sienne, et celle de nombreux autres afro-américains, durant de nombreuses années. De la plus petite remarque anodine à l’acte le plus honteux, rien ne laisse les spectateurs indifférents et pris de compassion pour ce pianiste de renom. Ces électrochocs, nous ne serons pas les seuls à les mesurer : Tony va les vivre au plus près, mais restera bien souvent impuissant. Grandissant à travers l’humanité dont fait preuve Don Shirley, il modifiera son regard dédaigneux, malgré les maladresses (amusantes d’un certain point de vue) qui seront les siennes tout au long des mois passés aux côtés de son boss. Mais peut-être est-ce finalement plus facile pour lui, fils de migrant sans argent et habitant dans un ghetto new-yorkais, de comprendre ce qu’il ressent ? A l’image de leur première rencontre (dans le penthouse du Carnegie Théâtre où vit le Dr Shirley), le film nous fait vaciller entre rires et émotions, entre palabres franchement amusantes et silences qui en disent longs. On garde en tête quelques répliques déchirantes ou quelques scènes cocasses qui prêtent à sourire, et jamais on ne se lasse. Assumant clairement son rôle de divertissement feel good, « Green Book » pourrait passer pour un film sympathique tout public mais il est bien plus que cela. Evoquant le racisme sous toute ses formes (insidieuses ou affichées), le film a le mérite d’offrir plusieurs lectures sans tomber dans le moralisme de bas étage. A l’instar de « La couleur des sentiments » (auquel on ne peut que penser au vu des situations dénoncées), le long-métrage soulève avec subtilités la condition des populations de couleur dans les années 60, où le racisme faisait encore rage. Plus subtil que ses autres longs-métrages, plus calme et posé, « Green Book » de Peter Farrellu est sans aucun doute le film de la maturité, celui qui démontrera qu’il est tout à fait possible de réaliser un budy movie biographique frais et ludique sans tomber dans les habituels clichés. S’il reste conformiste dans sa réalisation et léger dans son ton, le long-métrage n’en reste pas moins un film abouti et réussi. Remplissant le contrat explicite de divertir son public tout en le sensibilisant à l’acquisition difficile des droits civiques, « Green Book » vaut amplement le détour par vos salles et récoltera peut-être quelques autres statuettes dans les cérémonies prestigieuses à venir, qui sait ? Date de sortie en Belgique : 30 janvier 2019 Date de sortie en France : 23 janvier 2019 Durée du film : 2h10 Genre : Comédie dramatique Résumé du film : La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour Adonis Creed. Entre ses obligations personnelles et son entraînement pour son prochain grand match, il est à la croisée des chemins. Et l'enjeu du combat est d'autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut compter sur la présence de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il comprendra ce qui vaut la peine de se battre et découvrira qu'il n'y a rien de plus important que les valeurs familiales. Note du film : 7,5/10 (par François) Avis : Souvenez-vous, c’était en 1985 ! Cette année-là, Apollo Creed trouvait la mort sur le ring. Tombé sous les coups répétés du surhomme Ivan Drago. Trente ans après ce drame, un manager sportif voit là une opportunité de proposer un match de boxe entre les fils de ces célèbres boxeurs. Boxeurs de légende et côtes cassées « Creed II » c’est avant tout la réunion entre deux acteurs qui semblent s’apprécier. Après tout, c’est la cinquième fois que Sylvester Stallone et Dolph Lundgren se retrouvent depuis « Rocky IV ». Déjà sur le plateau de la saga « Expendables », ils avaient l’air de s’amuser comme larrons en foire. Bien sûr, ici, ce sont les ennemis d’hier qui se retrouvent pour se battre au présent. La première force du film, c’est assurément son casting qui ne souffre d’aucun défaut. Bien sûr l’acteur, le producteur et scénariste Sylvester Stallone n’a plus rien à prouver. Il en va de même pour l’excellent Dolph Lundgren. A eux deux, ils assurent le spectacle ; mais ils ne sont pas les seuls. Comme leurs ainés avant eux, Michael B Jordan s’est remis à l’entrainement afin de gagner en crédibilité. Coach personnel, chorégraphe sportif et alimentation spécifique lui ont permis de tenir la distance face à l’impressionnant Florian Munteanu et ce n’était pas une mince affaire ! Véritable poids lourd amateur dans la vie, Florian a remporté soixante-huit matchs, perdu dix autres et comptabilise six matchs nuls. Quand on sait que les producteurs du film l’ont repéré grâce à ses vidéos, on se dit que l’histoire ressemble à celle d’un conte de fées. Bercé dans son enfance par la célèbre saga, Florian exulte : « C'était totalement surréaliste de passer une audition via Skype avec Stallone, qui était l'un de mes héros quand j'étais gamin. (…)"J'ai reçu un appel de mon agent le 23 décembre au soir, mais mes parents dormaient déjà. Du coup, le lendemain, j'avais un super cadeau de Noël pour mes parents : je leur ai appris que j'avais décroché le rôle ! » Face à la détermination du boxeur, il ne fallait pas que Michael B Jordan plaisante avec son entrainement et le résultat à l’écran en vaut la chandelle ! Ca bouge, ça esquive et ça cogne sec dans ce film de tout de même 2h10. A ce niveau, ce nouveau Creed remplit parfaitement son contrat : l’action est percutante mais toujours bien lisible. La caméra de Steven Caple Jr suit avec brio les mouvements des boxeurs et le dynamisme omniprésent. Les phases d’entrainements sont également jouissives et on peut faire confiance au coach Rocky pour varier celles-ci comme lui seul a le secret ! Une mécanique éprouvée mais efficace Alors bien sûr, quand on va voir un Rocky au cinéma, on sait exactement ce que l’on va y trouver. Une fois de plus, la surprise n’est pas de mise. Le schéma narratif est calqué sur le quatrième épisode avec une modernisation bien sentie. Hormis quelques longueurs, nous avons éprouvé beaucoup de plaisir à suivre les aventures sur le ring du fils d’Apollo. Aussi, ne cherchez pas de twists surprenants car vous risqueriez être déçus. Toutefois, cette nouvelle cuvée possède en elle une justesse émotionnelle qui n’est pas feinte. On sent beaucoup de sincérité dans ce film. Evidemment, les fans de la première heure seront ravis de voir ces vieilles figurent qu’ils ont aimées (et que nous aimons encore !). L’ensemble nous parait presque familier et le spectateur devrait être content de pouvoir se reposer sur ses certitudes qui s’avéreront une fois encore exactes. Creed II sonne comme la dernière danse De l’aveu même de Sly, « Creed II » risque d’être le dernier film à voir apparaitre le personnage mythique de Rocky Balboa. La relève étant bien assurée par l’acteur Michael B Jordan. Ce film est en quelque sorte un chant du cygne pour l’acteur qui dira devant l’ensemble de son équipe: « Je voudrais juste remercier chaque personne dans le monde ayant pris la famille Rocky dans son cœur durant plus de 40 ans. Créer et interpréter ce personnage si important a été mon ultime privilège. Malheureusement, toutes les choses ont une fin. Ne lâchez pas, je vous aime, vous qui avez été si bons et généreux, et Rocky vous aime également. C'est probablement mon dernier tour de piste car il est arrivé ce que je pensais, quelque chose que je n'avais jamais imaginé". "Je pensais que c'en était fini de Rocky en 2006, avec Rocky Balboa. Et ça m'allait très bien." Puis, s'adressant à Michael B. Jordan :"Et soudain, ce jeune homme s'est présenté et toute l'histoire a changé. Il y a eu une nouvelle génération. De nouveaux problèmes. De nouvelles aventures. Je ne pourrais pas être plus heureux de prendre du recul, car mon histoire a été racontée, car il y a un tout nouveau monde qui s'ouvre pour ce public, cette génération. À toi de prendre la relève, désormais." Pour toutes ces raisons, « Creed II » est plus qu’un film de boxe, c’est un film sur la filiation. Et à la lumière de la dernière scène et de la déclaration de Sylvester Stallone, on poursuivra la réflexion en se disant qu’il va même bien au-delà pour nous parler de réconciliation. Jamais un chant de cygne n’avait été aussi mélodieux. Date de sortie en Belgique/France : 9 janvier 2018 Durée du film : 2h10 Genre : Action Résumé du film : Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux courses de canards et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée. Abigail va y voir l’opportunité de renouer avec ses racines aristocratiques. Alors que les enjeux politiques de la guerre absorbent Sarah, Abigail quant à elle parvient à gagner la confiance de la reine et devient sa nouvelle confidente. Cette amitié naissante donne à la jeune femme l’occasion de satisfaire ses ambitions, et elle ne laissera ni homme, ni femme, ni politique, ni même un lapin se mettre en travers de son chemin. Note du film : 8/10 (par Véronique) Avis : Avec ses douze nominations aux BAFTA 2019, son Grand Prix du Jury à la dernière Mostra de Venise et son Golden Globe de la meilleure actrice décerné à Olivia Colman, « La favorite » démarre l’année cinématographique d’une bien belle façon. C’est que Yorgos Lanthimos n’a jamais fait dans la demi-mesure et que cette fois encore, le réalisateur grec parvient à réussir un bel exercice de style : concilier Histoire et modernisme. Cynique, sombre, malsain mais aussi terriblement drôle, son dernier long-métrage parvient à réaliser le sans-faute en termes de mise en scène. Bienvenue à la Cour d’Angleterre et dans tout ce qu’elle a de singulière. Arnaques, crimes et botanique Un an et des poussières après sa « Mise à mort du cerf sacré », Yorgos Lanthimos revient plus déterminé que jamais à nous faire vivre une satire affutée mettant en lumière la cupidité et la soif de pouvoir de deux femmes qui n’ont qu’un désir : s’attirer les faveurs d’une Reine, lunatique et complètement écrasée sous le poids de ses responsabilités. Pour se faire, le réalisateur grec ponctue son récit de dialogues tranchants, de répliques cinglantes, de jeux d’influence et de complots sur l’oreiller, ceux menés par deux femmes de caractère : Lady Sarah Marlborough et sa cousine désargentée Abigail. Découpée en huit chapitres (dont les titres rappellent quelques répliques phares de chacun d’entre eux), l’intrigue se situe au XVIIIème siècle, à la Cour de la Reine Anne Stuart. Souffrant de la maladie de la goutte, la Reine se coupe du monde, ne prenant aucun plaisir à participer aux soirées festives organisées au Palais et balayant d’un cri strident, toute tentative d’activité enjouée. Souvent isolée dans ses appartements, totalement détachée des préoccupations politiques qui devraient la concerner, elle a, pour seule compagnie, celle de l’influente (et manipulatrice) femme du Duc de Marlborough et celle ses dix sept lapins, chacun représentant un enfant qu’elle a perdu. Fort heureusement pour elle, la jolie Abigail, bien décidée à prendre sa part du gâteau, va entrer dans sa vie et rendre le sourire à cette Reine solitaire et bipolaire. La soulageant de ses maux grâce à ses remèdes végétaux, la douce future courtisane s’approche dangereusement de la souveraine par l’entremise de sa cousine Sarah, favorite de la Reine et conseillère attitrée du monarque. De l’ombre à la lumière, il n’y a qu’un pas et l’intelligente Abigail le sautera. Des femmes d’influence Si l’histoire est plutôt classique et le jeu de pouvoir, de manipulations et d’évictions déjà vu, l’originalité du film de Yorgos Lanthimos est à chercher dans sa mise en scène extravagante. Mêlant humour et drame politique, il revisite le genre des films d’époque pour offrir un résultat quelque peu rock and roll. Les décors, grandioses, respectent l’époque mais à bien y réfléchir, nombreux sont les anachronismes et libertés prises pour décaler le ton et faire de « La favorite » un objet cinématographique loin de toute reconstitution strictement historique. Les danses modernes auxquelles s’adonnent les courtisans, Abigail et la Reine, les robes baroques aux matières et motifs géométriques modernes, le ton décomplexé et les joutes verbales des trois héroïnes, tout concorde pour faire de ce drame ironique et cruel un film à part. Si la distance entre le spectateur et le récit se fait sentir à diverses reprises (notamment par un traitement d’images parfois brut ou au contraire très courbe, comme si on observait les scènes à travers l’œil d’un judas), le plaisir est total. Pour dénoncer les méthodes utilisées pour accéder à ses objectifs, Yorgos Lanthimos met en avant trois comédiennes de talent : Emma Stone (aussi étonnante et concluante que dans « Battle of the sexes »), Rachel Weisz (à qui les films d’époque vont formidablement bien- on pense à « My cousin Rachel ») et Olivia Colman ( future Elisabeth II dans la suite de « The Crown »). Singulier dans sa forme plus que dans son fond, « The favourite » en version originale, révolutionne véritablement le genre et permet à trois comédiennes de renom de montrer l’étendue de leur talent dans une comédie dramatique girl power, cruelle et méchante qui fera assurément le bonheur de ses spectateurs. A bon entendeur… Date de sortie en Belgique : 9 janvier 2019 Date de sortie en France : 6 février 2019 Durée du film : 2h Genre : Film historique Titre original : The Favourite Résumé du film : Peu de temps après les événements relatés dans Split, David Dunn - l’homme incassable - poursuit sa traque de La Bête, surnom donné à Kevin Crumb depuis qu’on le sait capable d’endosser 23 personnalités différentes. De son côté, le mystérieux homme souffrant du syndrome des os de verre Elijah Price suscite à nouveau l’intérêt des forces de l’ordre en affirmant détenir des informations capitales sur les deux hommes… Note du film : 6/10 (par Véronique) Avis : Suite directe de « Split » que M Night Shyamalan nous a livré il y a près de deux ans déjà, « Glass » est l’occasion de retrouver trois personnages emblématiques de son univers original : David Dunn, Elijah Price (Mister Glass) et Kevin Wendell Crumb (toujours habité par 24 personnalités). Décevant à plus d’un titre, le nouveau volet de son triptyque débuté en 2000, déconcerte et laisse un réel goût de trop peu… comme son prédécesseur. Nous qui nous enthousiasmions de voir David Dunn affronter la Horde, nous avons plutôt été refroidi par ce nouveau long-métrage un peu plat et surtout particulièrement creux. Triptyque en sol mineur Nous l’écrivions déjà à l’époque de la sortie de « Split » : M Night Shyamalan est un formidable faiseur rempli de génie mais bien souvent, il n’exploite qu’en demi-teinte un sujet qui aurait pu l’être de façon plus profonde. Ici encore, on admire sa réalisation au cordeau, sa capacité à créer un réel suspense et à gérer des twists comme personne mais le rythme lent de sa première partie et l’installation de ses intentions desservent beaucoup trop ce qui aurait pu être un épilogue époustouflant. Et pourtant, nous y croyions tant la première mission de David Dunn laissait présager du meilleur. Réunissant le casting initial (mais 18 ans plus vieux que dans les premières aventures du formidable « Incassable »), le sauvetage de quatre pom -poms girl dans une briqueterie abandonnée donnait le ton… avant de ne devenir qu’un murmure presqu’inaudible Le père et le fils Dunn (Bruce Willis et Spencer Treat Clark) évoluant côte à côte des années après les premières mésaventures du gardien de stade, Elijah Price (Samuel L Jackson), expert-manipulateur et Kevin (toujours magistral James McAvoy) dans un seul et même long-métrage, ça laissait songeur. Mais après un effet de surprise savamment orchestré (on se rappelle la scène post-générique de « Split ») et de belles promesses d’un combat manichéen, il n’en est rien. Enfermés dans un hôpital psychiatrique, nos trois (anti)-héros sont la proie d’expériences mais surtout de questionnements menés par le Docteur Ellie Staple (Sarah Paulson) sur ce qu’ils sont vraiment ou du moins, croient être. Quand M Night Shyamalan fait voler son univers en éclats. Versant davantage dans la fable fantastique que dans le thriller à proprement parler, « Glass » fait voler en éclats toutes les représentations que nous avions jusque-là. Optant pour une direction inattendue, rendant vulnérables ceux qui ont passionné les spectateurs, le nouveau film de N Shyamalan est travaillé jusque dans ses moindres détails. On en veut pour preuve les univers visuels et colorés propres à chaque personnage principal. David Dunn et son poncho de pluie vert, Elijah Price et son manteau violet ou Kevin et ses survêtements jaunes se dissocient autant dans la colorimétrie que dans leur histoire singulière. Mais qui connait un tant soit peu l’univers du réalisateur indo-européen (qui s’accorde d’ailleurs un caméo plus appuyé que d’ordinaire) sait qu’il n’est pas avare en histoires à tiroirs et que tout prend sens une fois que l’histoire touche à sa fin. Plantant à nouveau son décor dans la ville de Philadelphie, le metteur en scène choisit de s’ancrer dans la modernité et nous entraîne dans une nouvelle intrigue originale où la thématique de l’identité, la prise de conscience de ses pouvoirs (et ses limites) et celle de la prédestination tiennent une place de choix. Par contre, on déplore l’usage d’artifices déjà vus et ne créant plus la surprise, la minimisation de l’importance de chaque personnage emblématique, la récupération du casting secondaire en tant que faire-valoir dispensable (ou risible) et l’angle choisit pour ce « Glass » en verre mercuré. Sacrifiant les trois super-héros que l’on a aimé accompagner sur l’autel classique d’une saga qu’on n’avait pas vu arriver (avant ce « Split » lui aussi sous-exploité), M Night Shyamalan perd son inventivité et tout ce qui nous a jadis fait vibrer, faisant de ce nouvel opus un produit marketé, certes de qualité, mais en deçà de ce qu’on était en droit d'espérer. Date de sortie en Belgique/France : 16 janvier 2019 Durée du film : 2h12 Genre : Thriller fantastique Résumé du film : Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles »? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie ... Note du film : 7,5/10 (par Véronique) Avis : Bouleversant à plus d’un titre, « Les Chatouilles » de Andréa Bescond et Eric Métayer n’a rien d’une comédie française légère où on passe l’heure trente à s’amuser. Traitant de la pédophile, leur premier long-métrage a le mérite de traiter un sujet grave avec une certaine légèreté, notamment grâce à une mise en scène inventive et créative que l’on ne peut qu’approuver. Ma vie ma bataille Odette est une petite fille de huit ans. Seule enfant d'un couple de restaurateurs, elle aime dessiner, danser, et évoluer dans l’innocence de l’enfance jusqu’à ce que l’ami de la famille, Gilbert, s’adonne à des chatouilles pour le moins douteuses. Prisonnière d’un jeu malsain qu’elle n’a pas choisi de mener, la fillette s’enferme dans un mutisme et subit à chaque rencontre, les attouchements honteux d’un homme qu’elle ne connait que trop bien. Mais comment sortir toute cette rage qui nous habite quand on est si petite ? La gamine va donc vivre sa passion à fond, celle de la danse pour laquelle elle semble avoir un don. Refuge épanouissant ou moyen d’expression, ses cours sont l’occasion de s’évader de ce qui la tourmente ou de trouver une certaine liberté, une bouffée d’air frais dans une enfance qui devient de plus en plus anxiogène. Mais le carcan dans lequel est pris cette petite fille ne trouve que peu d’ouverture tant il semble difficile de dire à qui que ce soit, ce qu’elle a vécu trop longtemps déjà. Sa mère, froide et distante, est capable des plus belles attentions comme des phrases les plus cinglantes. Peu encourageante, extrêmement exigeante, elle charge sa fille unique d’une pression et d’une autorité maternelle permanentes, heureusement contrebalancées par la complicité d’un père attentionné. La justesse de jeu de Karin Viard et de Clovis Cornillac (qui nous réconcilie ici avec sa performance d’acteur) force notre respect et nous fait vivre une palette d’émotions large allant de la colère à la tristesse; c'est que nous sommes marqués par la culpabilité de ce père laissant sa fille dans une famille d’accueil pour qu’elle réalise son rêve, mal à l’aise lors des réunions familiales qui semblent devoir toujours tourner au drame, mais on est aussi cueilli par les larmes partagées lorsque le poids du secret est enfin levé. Au fil du récit, on comprend qu’il s’en est fallu de peu pour que la jeune femme sorte la tête de l’eau, submergée par l'alcoolisme, la drogue, la détérioration de son corps mais surtout de sa vie sociale et amoureuse. Ce n’est d’ailleurs pas par hasard si Andréa Bescond a choisi de porter le nom d’Odette dans sa pseudo-fiction, celui du cygne blanc du « Lac des cygnes » du grand Tchaïkovski, un cygne majestueux qui se meurt… L’art de la scène s’invite sur nos écrans Inventif et créatif, le choix de la mise en scène de l’histoire d’Andréa Bescond réussit le difficile tour de force de donner de la légèreté dans un sujet aussi grave que celui abordé. Cernant les contours de son passé grâce à une thérapie qu’elle mène des années plus tard, nous assistons à des flashbacks étonnants, parfaitement intégrés à un récit fluide et dynamique. Suivant les pas de cette adulte meurtrie par des actes qui glacent le sang, nous comprenons que tous les souvenirs ne sont pas ceux de la jeune fille. Au contraire, ces cassures temporelles se situent entre fantasme et réalité, entre révélations et manipulations des vestiges d’une enfance profondément marquée. Ainsi, certains protagonistes entrent véritablement dans les souvenirs décrits à la psy (formidable Carole Franck), rendant drôle des situations parfois douloureuses. Souvent, la douceur de l’enfance est entrecoupée par les actes délictueux (et trash bien que fort heureusement suggérés), les musiques enjouées et moments de répit interrompus par la présence imposante de ce Gilbert qu’on voudrait voir disparaître. C’est d’ailleurs Pierre Deladonchamps, révélation française de ces dernières années qui tient le rôle ultra-délicat du prédateur manipulateur. Extraordinaire tant il est glaçant, il démontre une fois de plus toute l’étendue de son formidable talent d’interprète. Mais celle qui transcende l’écran, c’est Andréa Bescond elle-même, véritable femme-orchestre de ce projet. Se donnant corps et âme, elle nous épate par la maîtrise de son jeu d’actrice et par sa force de caractère, nous fait rire autant qu’elle nous noue la gorge par un récit qu’elle a déjà porté sur scène depuis un petit temps. Entourée par son compagnon Eric Métayer, l’actrice réalisatrice a su nous toucher au cœur avec cette Danse de la colère (sous-titre de sa pièce qui lui a valu d’être récompensée par un Molière en 2016) que l’on partage avec rage dès les premières minutes du film. Entre irritation et tendresse, humour et délicatesse, notre ascenseur émotionnel n’a pas fini de nous balader et ce, jusqu’à un final coup de poing qui nous cloue au sol après un uppercut bien amené. Expiant sa douleur et nous livrant son récit avec beaucoup de rigueur, « Les chatouilles » d’Andréa Bescond et Eric Métayer est une belle réussite cinématographique, l’une de celles qui nous aura durablement marquée en ce début d’année. Date de sortie en Belgique : 9 janvier 2019 Durée du film : 1h43 Genre : Drame/Comédie Résumé du film : Asuncion, Paraguay. Chela, riche héritière, a mené la grande vie pendant 30 ans avec Chiquita. Mais au bord de la faillite, elle doit vendre tous ses biens et regarde Chiquita, accusée de fraude, partir en prison. Alors qu’elle n’a pas conduit depuis des années, Chela accepte de faire le taxi pour un groupe de riches femmes âgées de son quartier et fait la rencontre de la jeune et charmante Angy. A ses côtés, Chela prend confiance en elle et cherche à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Note du film : 7/10 (par Véronique) Avis : Premier film du réalisateur (et scénariste) paraguayen Marcelo Martinesi, « Les héritières » est un film pudique sur le déclin d’une classe privilégiée qui découvre la réalité et la dureté d’une vie qu’elle n’a jamais côtoyée. Parle avec elle(s) Mettant en lumière l’histoire de Chela et Chiquita (dont on sait peu de choses dans le premier volet de son récit), le film garde une sobriété de réalisation et de sentiments appréciables. Spectateurs de la décadence de deux femmes qui, jadis, s’accordaient le luxe de vivre de leur art ou de leurs sorties, nous comprenons bien vite que les lendemains sont de plus en plus difficiles à assurer et que seule la vente de biens chers à leurs deux familles permettra à ces deux sexuagénaires de caractère de (sur)vivre. Liquidant peu à peu leurs souvenirs, leurs biens les plus précieux, leurs meubles conservés et entretenus avec soin par un personnel de moins en moins présent, Chela et Chiqui font le vide autour d’elles bien que cette dernière mette un point d’honneur à entretenir les liens amicaux qui se tissaient jadis avec leurs pairs. Mais la préoccupation du qu’en dira-t-ton et la situation déclinante de sa vie assène des coups de poignards dans le cœur de Chela, bientôt seule à supporter la vie austère du quotidien dans un appartement sombre où le soleil ne réchauffe plus les cœurs. En effet, Chiqui, accusée de fraude fiscale, part purger sa peine dans la prison voisine où le bruit permanent et la solidarité féminine mise en place est l’exact opposé du silence pesant de l’appartement désespérément vide de vie et de richesses exposées autrefois. Contrainte à sortir la tête de l’eau (et de sa chambre dans laquelle elle aimait trouver refuge), Chela va prendre le volant de la Mercédès verte, dernière trace d’un héritage familial dilapidé, et jouer la chauffeuse de taxi pour sa voisine argentée. Privée de privilèges et sans le sous, Chela garde pourtant sa fierté et refuse toute compassion, déterminée à mériter ses précieux guaranis, gage d’une course menée avec délicatesse dans les rues de la ville paraguayenne que la taxi driver connait bien. Peu à peu, la solitude de Chela sera rompue par les trajets effectués avec plaisir pour les vieilles riches du quartier mais aussi par la présence d’une Angy sensuelle et affirmée, que Chela se met à admirer. Les silences pesants des débuts, les intrusions d’acheteuses venues s’emparer des richesses du couple font peu à peu place à la joie de vivre, aux sourires et au désir de liberté, d’autonomie que Chela semblait avoir oubliées. L’action prenant le dessus sur l’immobilisme et la nonchalance de cette nouvelle vie, notre héritière désargentée n’en oublierait-elle pas cette Chiqui sacrifiée et emprisonnée à quelques pas de là ? Une simplicité assumée Epuré, le film de Marcelo Martinessi va à l’essentiel et ne s’encombre pas de dialogues pesants, de psychologie appuyée et de scènes dispensables maladroites. Que du contraire. Les silences de l’appartement urbain, son obscurité, les rituels quotidiens, seuls rattachements à ce passé qui s’échappe peu à peu au profit d’un regain de vie, suffisent à eux-mêmes et permettent à Ana Brun de crever l’écran et de nous faire part des sentiments de son héroïne avec une authenticité bouleversante. Proposée essentiellement en huit-clos, l’intrigue dépasse le cadre restreint d’une salle à manger vidée de son ameublement ou celui d’une voiture où la vie s’invite au fil des courses et nous emporte dans le tourbillon de l’avenir de deux femmes que tout opposait. Auréolé du prix d’interprétation féminine au dernier festival de Berlin et du prix de la critique, « Les héritières » ouvre la voie d’un cinéma paraguayen encore trop méconnu (mais aussi efficace que celui de ses pays voisins qui, année après année, nous offrent des films forts et parfaitement maîtrisés dans leur propos) et qui, par ce premier essai, se transforme en film réussi et mémorable à plus d’un titre. Date de sortie en Belgique : 9 janvier 2019 Durée du film : 1h32 Genre : Drame Titre original : Las herederas Résumé du film : Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis ! Note du film: 8/10 (par Véronique) Avis : Il y a deux ans, Louis-Julien Petit offrait à Isabelle Ajdani le rôle de « Carole Matthieu », médecin du travail déterminée à dénoncer les conditions de travail d’employés dans une centrale d’appel. Dans sa première comédie « Discount », il nous montrait comment des employés de supermarché avaient mis en place un système B à l’arrivée des caisses automatiques qui menaçaient leur emploi. Pas étonnant donc que son dernier long-métrage soit consacré à la défense du petit peuple, à ces êtres invisibles qui passent leur journée dans des centres et les nuits dans la rue. Extrêmement touchant, s’adressant à notre cœur avec beaucoup de pudeur, « Les invisibles » est un film coup de poing qui poursuit et marque ses spectateurs durablement. Racontant le combat des assistantes sociales de « L’envol », centre d’accueil de jour pour femmes SDF, « Les invisibles » n’a rien d’affligeant, que du contraire. Sans verser dans le misérabilisme, le film de Louis-Julien Petit donne la parole à ces femmes démunies qui ont tout perdu, jusqu’à leur confiance en elles. Basé sur le livre « Sur la route des invisibles » de Claire Lajeunie, le scénario s’appuie sur l’histoire d’une dizaine de femmes, venues trouver refuge dans un centre du Nord de la France où le ciel est souvent gris mais l’accueil toujours chaleureux. Faisant exploser en éclats les stéréotypes et les caricatures des sans abris, le film nous fait passer du rire aux larmes durant près d’une heure et demi, sans que jamais nous ne trouvions le temps long. Servie par un casting irréprochable, l’histoire de ces femmes qui combattent pour la réinsertion des unes et le maintient du centre de l’autre est remplie de valeurs honorables comme l’espoir, l’entraide, le dévouement et l’envie d’aller de l’avant. Pour donner vie à ces femmes plus vraies que nature, on peut compter sur une série de comédiennes professionnelles parmi lesquelles Audrey Lamy, Noémie Lvovsky, Corinne Masiero ou encore Deborah Lukumuena. Les femmes qu’elles accueillent les bras ouverts sont elles, interprétées par des actrices débutantes passées elle-même par la case « sans-abri », leur conférant une authenticité et une profondeur inégalables. Si Sarah Suco rejoint le casting des indigentes, elle n’est pas la seule à mettre son expérience cinématographique au service des seconds rôles : Pablo Pauly et Brigitte Sy rejoignent cette aventure humaine avec une conviction indéniable. Des ateliers thérapeutiques aux projets de sauvegarde d’un centre menacé, des expulsions scandaleuses aux habitudes rythmant le quotidien d’âmes en peine, nous vibrons au son de la corde sensible que Louis-Julien Petit a accordé avec subtilité. Nous donnant une belle leçon d’humilité et de solidarité, « Les invisibles » est un film sur la France d’en bas qui, entourée de personnes d’une humanité sans limites, relèvera la tête et marchera fièrement sur des matelas. Un must see qui s’adresse directement à notre cœur et que l’on vous invite à découvrir lors de sa sortie en salles en janvier prochain. Date de sortie en Belgique/France : 9 janvier 2019 Durée du film : 1h22 Genre : Comédie Résumé du film : Ce qui avait commencé comme une amitié improbable entre un jeune Viking et un redoutable dragon Furie Nocturne est devenu une trilogie épique retraçant leurs vies. Dans ce nouveau chapitre, Harold et Krokmou vont enfin découvrir leurs véritables destinées: être le chef de Berk au côté d’Astrid et, en tant que dragon, être le leader de son espèce. Alors qu’ils réalisent leurs rêves de vivre en paix entre Vikings et dragons, une sombre menace planant sur le village et l’apparition d’une femelle Furie Nocturne vont mettre à mal leurs liens d’amitié comme jamais auparavant. Harold et Krokmou doivent alors quitter le seul foyer qu'ils aient connu et voyager dans un monde que l'on croit n'exister que dans les mythes. Le dragon et le cavalier se battront ensemble pour protéger tout ce qu'ils ont appris à chérir. Note du film : 7/10 (par Véronique) Avis : Débutée en 2010, la saga « Dragons » n’a jamais cessé d’évoluer avec son jeune public. En effet, dans le premier épisode, le petit Harold était parvenu à capturer un dragon furie, à la dresser et en faire son principal allié, malgré les réticences de son père, chef du village viking de Beurk. Dans « Dragons 2 », la paisible ville de Beurk, où cohabitent à présent humains et dragons était la proie d’une menace menée par Drago Poinsanklant. Déterminé à le sauver, Harold et Krokmou étaient partis en mission et avaient retrouvé en route Valka, la mère du jeune héros alors que son père mourrait tragiquement. Dans ce dernier opus, Dean Deblois, l’instigateur de la trilogie animée, nous fait entrer de plain pied dans l’univers que nous avions quitté quatre ans auparavant. Harold, amoureux d’Astrid, est devenu le chef du village et continue à sauver les dragons. Mais Beurk, lieu idyllique pour vikings et créatures ancestrales, est de plus en plus peuplé. Aussi, lorsqu’une nouvelle menace plane sur ses terres, le jeune héros part à la recherche d’un refuge pour tous ses proches. Mais c’était sans compter sur la ténacité de Grimmel de vouloir anéantir tous les dragons de la terre et le coup de foudre de Krokmou pour une autre furie dragon. Comme toujours, l’imagerie de ce nouveau « Dragons » est soigné aux petits oignons. Coloré, dynamique et enjoué, le film entraînera petits et grands dans de nouvelles aventures passionnantes. Loin de n’être qu’une quête de paradis perdu, « Dragons 3 : le monde caché » est aussi l’occasion d’évoquer des thématiques plus terre à terre comme l’importance de l’amitié et de la famille, l'amour, l’entraide ou encore le respect et la protection des espèces animales. Touchant et drôle, le nouveau long-métrage du canadien Dean Deblois parvient à garder l’équilibre entre épopée chevaleresque et féerie, ne nous faisons pas une seule seconde regretter notre déplacement. Clôturant à merveille cette trilogie animée, « Dragons 3 : le monde caché » s’adresse essentiellement aux petits de 5 à 10 ans mais satisfera aussi les plus grands. En ajoutant une belle dose de 3D dans ses techniques d’animation, le nouveau-né des studios Dreamworks nous en met plein les mirettes, nous faisant voler dans les airs, mordre le fer, plonger dans les cascades les plus reculées avec un plaisir certain. Vous aimez les premiers épisodes de la saga « Dragons » ? Ce troisième numéro s’inscrit dans la lignée avec la même qualité scénaristique et visuelle. Krokmou, Tempête, Harold et compagnie vous attendent pour un nouveau et dernier tour, et il serait dommage de manquer le départ. Date de sortie en Belgique : 30 janvier 2019 Date de sortie en France : 6 février 2019 Durée du film : 1h44 Genre : Animation Titre original : How To Train Your Dragon: The Hidden World Résumé du film : Quelque part en Amérique latine. Le vieux gardien de la morgue se souvient de chaque détail de sa vie sauf des noms, y compris du sien. A la suite d’une manifestation qui a tourné au massacre, les miliciens investissent la morgue pour se débarrasser des civils qu’ils ont abattus. Après leur départ, le vieil homme découvre le corps oublié d’une jeune femme… Note du film : 7/10 (par Véronique) Avis : Premier long métrage du réalisateur iranien Alireza Khatami, « Les versets de l’oubli » est un film métaphorique qui se mérite. Derrière ses apparences mornes et lentes, se cache une histoire étonnante remplie de poésie qui nous poursuit encore une fois le dernier plan fixe terminé, celui du regard de ce héros anonyme abandonné. Le souvenir de l’oubli Employé à la morgue d’une ville chilienne, notre héros sans nom ne se rappelle ni du sien, ni de celui des nombreuses personnes qu’il a côtoyées toutes ces longues années. Et pourtant, sa mémoire ne semble pas tant lui faire défaut car il retient par cœur les lettres qu’il a écrites pour un compagnon de cellule, le nombre de personnes enterrées dans son cimetière, des anecdotes du quotidien ou encore le nombre de dimanche où une vieille dame est venue poussée la grille du lieu de recueillement. Est-ce si important d’avoir oublié un patronyme ? Le véritable oubli ne réside-t-il pas dans la perte de mémoire de ce qu’on a oublié ? Les deux protagonistes principaux tiennent un très bel échange à ce propos : si on a oublié quelque chose, c’est que quelque part, on ne l’a pas totalement oublié puisqu’on sait qu’on l’a perdu… Mais quand on ne se rappelle plus de ce qu’on a oublié, il est dès lors impossible de s’en souvenir… et cela marque véritablement la fin, la mort des choses ou des gens que l’on a aimés. Ce que nous rappelle aussi Alireza Khatami en substance, c’est qu’il ne faut pas oublier les héros, les militants, tous ceux qui, anonymement ou de façon reconnue ont fait avancer les choses, chacun à leur petite échelle, pour perpétuer la mémoire ou contrer les décisions politiques unilatérales. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que notre gardien se bat pour offrir des obsèques décentes à cette jeune manifestante oubliée dans un des tiroirs de la morgue. Sans mémoire, sans trace, sans nom, difficile de savoir qui est cette brune mais qu’importe, en l’enterrant dignement, on perpétue sa mémoire… « Les versets de l’oubli » n’est-il pas aussi un moyen de montrer que le passé est toujours ancré dans notre présent ? Que les coups d’œil jetés dans le rétroviseur et le poids de nos souvenirs nous font aller de l’avant ? L’Histoire ne se répète-t-elle pas inlassablement ? Les citoyens lambdas ne doivent-ils pas se battre pour garder le cap malgré des bureaucraties manipulées ? Voilà autant de questions qui nous viennent à l’esprit lorsqu’on se plonge dans ce premier long métrage de Khatami. Des questionnements qui restent sans réponse mais qui méritent d’être soulevés et qui sont illustrés d’une bien belle façon. La beauté de la poésie Parfois sans queue ni tête, l’intrigue du film n’est toutefois pas dénuée d’intérêt, que du contraire. Le mystère qui plane tout au long de son heure trente nous imprègne et nous entraîne dans des méandres allégoriques qu’on se plait à découvrir : une main géante émergeant du désert, la survie d’un héros qui aurait dû périr à différentes reprises, ou la présence des baleines échouées sur la plage ou nageant dans les cieux. Dans le film, on apprend en effet que des cétacés se sont échoués au large et que l’un des survivants, continue de sillonner le rivage, accompagnant les autres par amour, ne pouvant les abandonner à leur triste sort. Ce n’est pas anodin si le symbole de la baleine est présent à différents moments du film, dans le ciel gris de notre héros, sur les murs de la maison de la vieille dame qu’il accompagne ou à l’oreille de cette jeune femme sans identité qu’il retrouve dans le tiroir de la morgue où il travaille sans relâche... Interpellant et éclairant nos interprétations, ce signe nous permet de mesurer les intentions profondes du réalisateur sans obtenir toutefois d’entières réponses. C’est ce choix qui perdra certains spectateurs en chemin alors qu’il attisera l’intérêt des autres. A ces symboles, Alireza Khatami ajoute une photographie exemplaire et sublime les nuits denses ou les recherches à la lueur d’une flamme qui vacille. Il inscrit sur la pellicule des visages, morts ou vivants, et expriment toute une série de sentiments : ceux du taiseux gardien de morgue, excellent et touchant Juan Margallo ou de cette vieille dame qui arpente les rues en pente ou les allées du cimetière (Itziar Aizpuru) à la recherche d’un être aimé. Si le surréalisme occupe une place de choix dans « Les versets de l’oubli », le jeune cinéaste chilien n’en oublie pas pour autant l’espoir et la drôlerie. On s’amuse de la complicité qui réside entre le gardien de la morgue solitaire et le fossoyeur, (Tomás Del Estal) incorrigible dragueur de veuves et conteurs d’histoires. Film sur la mort, dans tout ce qu’elle a de révélateur et non de dramatique, « Los versos del olvido », en version originale, pose les jalons d’un cinéma poétique comme on les aime, un de ceux qu’on se plait de découvrir et qui prête à réfléchir. Date de sortie en Belgique : 2 janvier 2018 Durée du film : 1h41 Genre : Drame Titre original : Los versos del olvido |
|